Verbaliser c'est guérir ! Soyez accompagné !
Qu’est-ce que l’entretien psychologique ?
C’est une technique qui n’utilise pas d’outils particuliers (technique d'entretien dite "à mains nues") reposant sur la communication, verbale mais également non-verbale. C’est une méthode très complexe, selon Perron, qui affirme que ce n’est que par sa pratique qu’on l’apprend. Cette méthode exige d'excellentes capacités d'analyse.
Elle vise la compréhension du fonctionnement psychique en se centrant sur le discours, le vécu et la relation. La situation d’entretien est une situation d’interaction (au moins deux personnes). Les personnes sont en situation active puisqu’elles vont construire ensemble cette situation d’entretien. Il est par conséquent important que le patient coopère. Dans le cas inverse, les données que l'on peut tirer du discours et de l'attitude du patient devront être sujettes à une extrême prudence.
Discours orienté ou libre
L’entretien peut être directif, semi-directif ou non-directif, caractéristique dépendant principalement du degré d’implication du thérapeute, de son cadre théorique ou de ses habitudes. On peut poser des questions directes ou indirectes. Dans l’entretien directif, le psychologue pose régulièrement des questions, alors que les réponses apportées par le sujet lors de l’entretien semi-directif seront plus libres. Dans l’entretien non-directif, le thérapeute amorce seulement le discours, écoute et observe le patient en intervenant le moins possible, de manière à laisser la pensée de celui-ci le plus libre possible.
Quel que soit le type d’entretien utilisé, le thérapeute va essayer de favoriser la verbalisation pour obtenir des informations sur la problématique du patient. La manière dont est conduit l’entretien dépend beaucoup de la personne : parfois, certaines personnes sont obligées de venir, mais ne demandent rien (par exemple, entretien sur décision judiciaire) ou ne peuvent s'exprimer normalement (par exemple, les sujets autistes ont du mal à verbaliser). Les caractéristiques individuelles du patient vont par conséquent obliger le thérapeute à adapter sa méthode pour que l’entretien devienne possible. Par ailleurs, les caractéristiques de l’entretien peuvent être modifiées selon l’âge de l’interlocuteur.
Présence d'objectifs
Si l’entretien ressemble à une situation de conversation, il en diffère sur plusieurs points, et notamment, sur l'aspect important qu'il s’agisse d'une technique professionnelle, qui répond à des objectifs. Il peut donc être nécessaire de définir un cadre à l’entretien (passer un contrat avec le sujet) dans lequel on doit définir les objectifs, puis définir la manière avec laquelle le psychologue va travailler au cours de cet entretien. Généralement, le psychologue évoque sa manière d’interpréter, d’observer, etc, au patient, afin que le travail soit actif des deux côtés. Les objectifs doivent d’ailleurs être les mêmes des deux côtés, au possible.
La relation Patient-Thérapeute
Au cours d’un entretien psychologique, la nature de la relation qui s’installe entre le thérapeute et le sujet est basée sur la confiance, le respect et l’empathie.
Le patient doit se sentir à l’aise, savoir que l’entretien est un moment privilégié pour qu’il puisse exprimer sa souffrance, ses problèmes et ses différences. Il doit savoir que le thérapeute est là pour l’écouter. La mise en confiance s'accompagne d'un code déontologique et du fait que le thérapeute est tenu au secret professionnel.
Le respect de la personne qui vient consulter est de rigueur : le thérapeute n’est pas là pour juger, il doit respecter le contenu du discours.
L’empathie, selon la définition qu'en donne Rogers, est la capacité d’un individu à se mettre à la place de l’autre, essayer de comprendre la situation, du point de vue de l’autre. Il faut essayer de comprendre l’attitude, les comportements ou les émotions d’autres personnes.
Le thérapeute est un interlocuteur vivant au cours de l’entretien, il participe à ce qui est dit, est bienveillant et neutre (aucun jugement). Il a forcément un avis, mais le contrôle.
Comment se déroule l'entretien ?
Pour qu’une relation patient-thérapeute fonctionne, il faut savoir comment on peut aider le patient à exprimer sa souffrance, il existe pour cela plusieurs techniques. Des stratégies d’interventions facilitent le discours, en fonction de la nature de ces interventions (des questions, du matériel informatif, des dessins ou encore des tests à interpréter).
On peut poser des questions ouvertes (réponses libres) ou fermées (réponses par oui ou par non). L’une des angoisses courantes est le silence qui peut arriver de la part du thérapeute autant que de la part du patient, ce qui ne doit pourtant pas forcément être angoissant : il peut falloir du temps pour réfléchir.
La manière dont on communique a une forte influence sur le déroulement de l’entretien, et il est donc nécessaire de ne pas confondre communication et langage.
Le plus important, c’est que de respecter tout ce qui est verbalisé par le patient, sans aucun jugement. La parole est libre, et c’est ce qui fait la force de la relation thérapeutique.
Parce que vous avez des impératifs en journée, parce que vous avez un agenda bien chargé, les RDV se font par visio à partir de 19h jusqu'à 22h.
Contactez-moi pour prendre un RDV (en visio)
06 13 68 38 65
ds2c.analyse.comportementale@gmail.com
Témoignages :
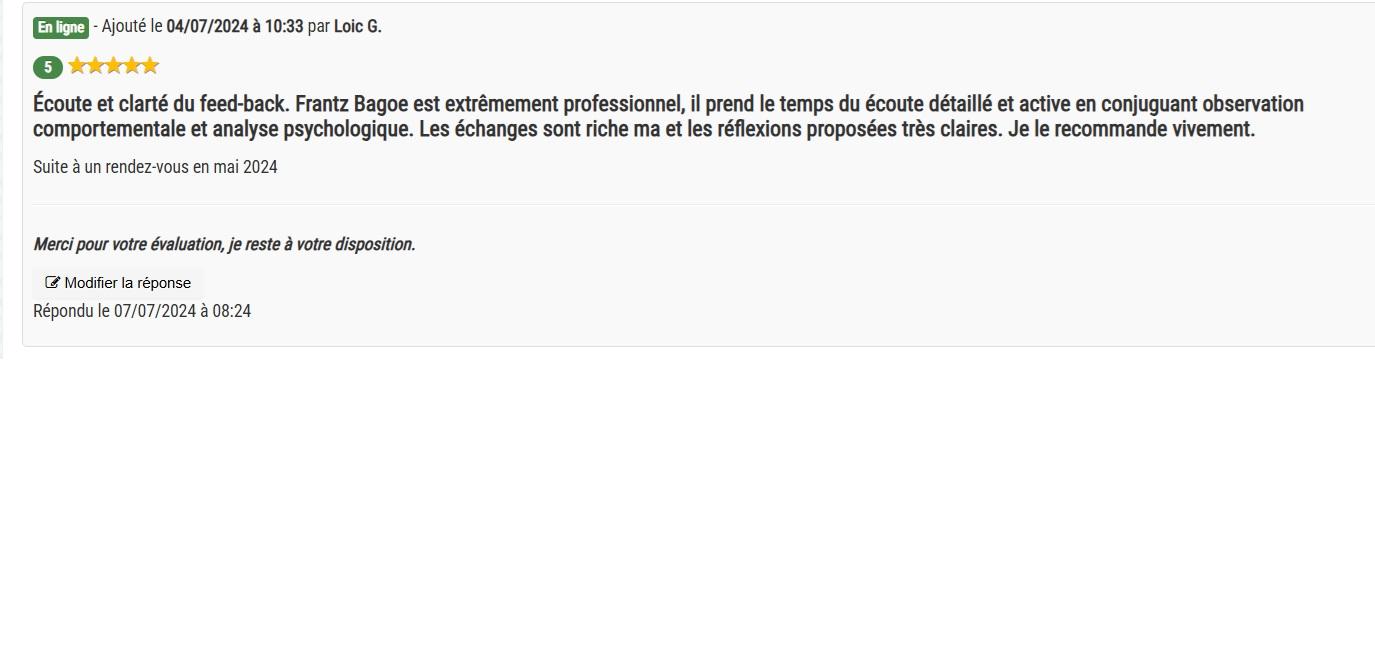
Exemple d'une prise en charge :
Contexte : Accompagnement psychologique et éducatif d’une famille recomposée composée de deux adultes et de quatre enfants issus de unions précédentes (2 garçons du côté du père, 2 filles du côté de la mère). Depuis quelques mois, des tensions et des dysfonctionnements relationnels affectent les interactions intrafamiliales.
Objectifs de l’intervention
1. Évaluer les dynamiques relationnelles en place au sein de la famille recomposée.
2. Comprendre les profils caractérologiques et les comportements associés de chaque membre.
3. Identifier les sources de conflits, de malentendus ou de déséquilibres.
4. Restaurer une communication saine et fonctionnelle entre les membres.
5. Mettre en place des règles communes, claires et adaptées.
6. Renforcer la cohésion familiale tout en respectant les individualités et les liens d’origine.
Méthodologie et déroulement
1. Phase d’évaluation initiale (2 à 3 séances)
Entretiens individuels avec chaque membre (enfants et adultes).
Entretiens en sous-groupes (parent et ses enfants / beaux-parents et enfants non biologiques).
Séance d’observation familiale globale (conflits, alliances, interactions non verbales).
Outils utilisés
Analyse des styles comportementaux (renforcements, évitements, hostilité passive, etc.).
Repérage des traits caractériels dominants (émotivité, activité, résonance des habitudes).
Grilles d’observation des dynamiques familiales et de communication.
2. Restitution et diagnostic partagé (1 séance)
Retour aux deux adultes sur les dynamiques observées.
Identification des principaux leviers de tension :
Conflits de loyauté.
Place ambiguë du beau-parent.
Comparaison ou rivalité entre enfants.
Règlements flous ou perçus comme injustes.
Besoins non exprimés ou non entendus.
3. Mise en place d’un cadre structurant (3 à 5 séances)
Co-construction avec la famille de :
Règles de vie communes.
Espace personnel pour chaque enfant.
Rituels familiaux (temps de parole, repas partagés, etc.).
Travail spécifique avec les adultes :
Cohérence éducative.
Gestion des conflits.
Reconnaissance des émotions et validation affective.
4. Séances psychoéducatives ciblées (en parallèle, selon besoin)
Avec les enfants/adolescents :
Apprendre à exprimer les émotions.
Développer l’écoute active.
Travailler l’acceptation de l’autre et la gestion de la frustration.
Avec les adultes :
Apprendre à arbitrer sans favoritisme.
Reconnaître les automatismes comportementaux liés à leur propre histoire.
5. Consolidation et suivi (1 séance mensuelle pendant 3 mois)
Évaluation des ajustements.
Valorisation des efforts.
Anticipation des rechutes.
Maintien de la communication fonctionnelle et bienveillante.
Principes éthiques et cadres de travail
Neutralité bienveillante envers chaque membre.
Non-jugement face aux conflits ou comportements.
Cadre confidentiel respectant la vie privée de tous.
Respect des rythmes de chacun, en particulier des enfants.
Conclusion et bénéfices attendus
Apaisement du climat familial.
Meilleure compréhension mutuelle entre enfants et adultes.
Redéfinition des rôles et des places dans la famille recomposée.
Amélioration durable des comportements et des liens affectifs.
Émergence d’une culture familiale commune, équilibrée et fonctionnelle.