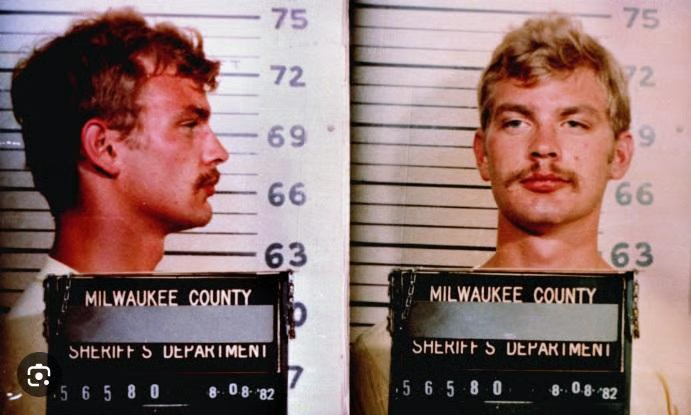Echec épistémologique d'un champ athéorique
Le fantasme classificatoire
La criminologie moderne, particulièrement anglo-saxonne, s'est évertuée depuis quarante ans à catégoriser les tueurs en série avec l'espoir naïf qu'une bonne taxonomie révélerait la nature profonde du phénomène.
Trois approches dominent : Holmes & DeBurger (1988), David Canter (années 1990), et la position évolutive du FBI. Chacune échoue différemment, et cet échec nous renseigne davantage sur les limites de la pensée classificatoire que sur l'objet étudié.
Holmes & DeBurger : la tentation phénoménologique
Ronald Holmes et James DeBurger proposent en 1988 une typologie quadripartite basée sur la « motivation inférée du tueur :
- Le Visionnaire tue sous l'impulsion de voix, d'hallucinations, d'injonctions divines ou démoniaques. Break psychotique patent, structure délirantielle. Désorganisation comportementale majeure.
- Le Missionnaire possède une pseudo-rationalité : éliminer les prostituées, les homosexuels, les "parasites sociaux". Pas de psychose, mais rigidité idéologique extrême. L'acte est "nécessaire", pas jouissif.
- L'Hédoniste tue pour le plaisir, subdivisé en trois sous-types :
- Lust : gratification sexuelle directe
- Thrill : excitation, frisson, chasse
- Comfort : gain matériel (assurances, héritages)
- Le Dominateur cherche le contrôle absolu sur sa victime. Torture prolongée, humiliation, réduction à l'objet. La mort n'est que l'aboutissement regrettable de la domination totale.
Critique structurale
Ce modèle souffre d'un vice circulaire fondamental : on infère la motivation du comportement observé, puis on classe selon cette motivation inférée. Le raisonnement se mord la queue. Comment distinguer empiriquement un hédoniste-thrill d'un dominateur ? Les deux torturent, les deux prolongent, les deux jouissent du contrôle.
L'échantillon (110 cas environ) ne permet aucune validation statistique robuste. Plus grave : les catégories se chevauchent constamment. Un dominateur EST nécessairement hédoniste. Un missionnaire peut éprouver du thrill. La typologie ne découpe pas le réel, elle le quadrille arbitrairement.
Biais rétrospectif massif
Connaissant l'issue et les déclarations post-capture, on "trouve" facilement la motivation. Mais ce modèle n'a aucun pouvoir prédictif prospectif. C'est de l'herméneutique criminologique déguisée en science.
Plasticité ignorée
Un même individu peut passer d'un registre à l'autre selon les opportunités, l'évolution de sa pathologie, les contingences situationnelles. BTK était missionnaire au début (éliminer des familles "idéales" par jalousie), hédoniste-lust ensuite, dominateur toujours. Quelle est sa "vraie" catégorie ?
Intérêt résiduel
Utile comme heuristique grossière pour initier une réflexion, rien de plus. En pédagogie, peut-être. En investigation, dangereux : risque de biais de confirmation ("il doit être visionnaire, cherchons des signes de psychose").
David Canter : le behaviorisme statistique
David Canter, psychologue environnemental britannique, adopte une approche radicalement différente dans les années 1990. Pas de spéculation motivationnelle. Uniquement des variables comportementales observables, analysées statistiquement sur 100 tueurs britanniques via Smallest Space Analysis (analyse multidimensionnelle).
Les dimensions canteriennes
Canter refuse les types discrets. Il propose des continuums :
- Dimension 1 : Expressif vs Instrumental
- Expressif : violence excessive, mutilations, rage manifeste, désorganisation émotionnelle, overkill, acharnement post-mortem. Le crime exprime un affect débordant.
- Instrumental : violence minimale nécessaire, planification, froideur, dissimulation du corps, nettoyage de la scène. Le crime est un moyen, pas une fin émotionnelle.
- Dimension 2 : Conservateur vs Explorateur (cognitive)
- Conservateur : zone géographique restreinte, routines rigides, victimes du voisinage, territorialité, faible mobilité.
- Explorateur : mobilité élevée, adaptation, nouveaux territoires, victimes éloignées du domicile, flexibilité opportuniste.
Ces dimensions sont « orthogonales » : on peut être expressif-conservateur (rage locale) ou instrumental-explorateur (tueur itinérant froid).
Forces méthodologiques
Empirisme rigoureux. Données observables, reproductibles, mesurables. Pas d'inférence psychologique hasardeuse. Le modèle est prédictif pour le Geographic Profiling : un conservateur-expressif opérera probablement près de chez lui dans un rayon de 2-3 km.
Compatible avec une épistémologie behavioriste stricte : si on ne peut pas l'observer sur la scène de crime, on ne le modélise pas.
Limites épistémologiques
- Réductionnisme statistique : la singularité du cas disparaît dans les moyennes. Un tueur n'est jamais réductible à ses coordonnées sur deux axes.
- Athéorique : Canter décrit des patterns sans les expliquer. POURQUOI existe-t-il des expressifs et des instrumentaux ? Quelle étiologie développementale ? Quelle économie pulsionnelle ? Silence total.
- Culturellement situé : échantillon britannique, contexte légal et social spécifique. La généralisation aux USA ou ailleurs reste douteuse.
En termes Le-Senniens, Canter cherche les "caractères" (au sens caractérologie) mais sans théorie de la personnalité. C'est de la cartographie sans géologie. On sait où sont les montagnes, pas pourquoi elles sont là.
Le FBI : de l'enthousiasme typologique au pragmatisme radical
Phase 1 (1970s-80s) : l'âge d'or des profilers
Robert Ressler, John Douglas, Roy Hazelwood du Behavioral Science Unit lancent le Criminal Personality Research Project. Ils interviewent 36 tueurs en série (Bundy, Kemper, Gacy...) et forgent la dichotomie célèbre :
- Organisé : QI élevé, planification, contrôle de la scène, dissimulation du corps, socialement compétent, suit l'affaire dans les médias.
- Désorganisé : QI faible, impulsif, scène chaotique, corps abandonné, isolement social, pas de suivi médiatique.
Opérationnel, médiatique, séduisant. Adopté massivement par les départements de police. Un succès de communication criminologique.
Phase 2 (1990s) : la critique empirique
David Canter démontre que 75% des scènes de crime présentent des éléments des DEUX catégories. La dichotomie ne reflète pas un "type" de tueur mais plutôt :
- L'évolution dans la série (début désorganisé, apprentissage, devenir organisé)
- Les variations situationnelles (victime résiste = désorganisation)
- La séquence temporelle (planification organisée, exécution émotionnelle désorganisée)
Exemple paradigmatique : BTK (Dennis Rader). Planification obsessionnelle (organisé), mais lors du passage à l'acte, perte de contrôle émotionnelle, jouissance prolongée, désordre (désorganisé). Quelle est sa "vraie" nature ?
La dichotomie est un artefact classificatoire qui simplifie abusivement une réalité continue et contextuelle.
Phase 3 (2005-aujourd'hui) : l'abandon des typologies
En 2005, Robert Morton et Mark Hilts publient pour le FBI un rapport sévère : les typologies sont "artificielles et contre-productives". Position officielle actuelle du BAU (Behavioral Analysis Unit) :
- Principes directeurs
- Refus des catégories a priori. Chaque cas est analysé inductivement, sans grille préétablie.
- Focus sur les comportements observables uniquement :
- Modus operandi (MO) : techniques utilisées, évoluent avec l'expérience
- Signature : éléments psychologiquement nécessaires, stables, liés à la gratification
- Contrôle de la victime (verbal, physique, chimique)
- Niveau de risque pris
- Temps passé sur la scène
- Comportement post-offense
- Pas de profil psychologique spéculatif. Trop aléatoire, juridiquement fragile, scientifiquement invérifiable.
- Pragmatisme investigatif : ce qui n'aide pas à identifier ou capturer le suspect est écarté.
Lecture Watzlawickienne : les typologies créent ce qu'elles décrivent
Le FBI a compris, probablement sans le conceptualiser ainsi, un principe constructiviste fondamental : les classifications ne décrivent pas une réalité préexistante, elles la construisent.
- Effets circulaires observés
- Les interrogatoires biaisés ("Vous êtes organisé, n'est-ce pas ?") obtiennent des réponses conformes.
- Les médias reproduisent les catégories, créant des scripts culturels.
- Les criminels eux-mêmes se catégorisent, adoptent l'identité proposée, agissent en conséquence (effet copycat raffiné).
- Les enquêteurs cherchent des indices confirmant leur hypothèse typologique initiale (biais de confirmation).
- La prophétie autoréalisatrice en action. Les tueurs "organisés" existent parce qu'on a inventé cette catégorie et qu'elle circule dans l'imaginaire collectif.
- Le FBI a fait son épistémologie pragmatique à la Peirce : si ça n'a pas d'effet pratique différentiel, c'est une distinction vide. Et les typologies n'en avaient plus.
Constat d'échec : l'absence criante de théorie
Ces trois approches partagent un vide théorique abyssal concernant :
- L'étiologie développementale : Que s'est-il passé dans l'enfance, l'adolescence ? Quelle trajectoire d'attachement ? Quels traumas séquentiels ? Quelle construction de la mentalisation ? Bergeret aurait des choses à dire sur les états-limites et les structures psychotiques, mais personne ne l'invite dans ce champ.
- La neurobiologie : Anomalies préfrontales, dysrégulation sérotoninergique, hypersensibilité amygdalienne, déficit d'empathie cognitive vs affective. Données massives ignorées.
- L'économie pulsionnelle : Quel rapport à la pulsion de mort ? Quelle défaillance du Surmoi ? Quelle jouissance spécifique ? Le meurtre en série n'est pas un comportement, c'est une solution psychique à une problématique interne. Personne ne le traite comme tel.
- La fonction adaptative darwinienne : pourquoi ce répertoire comportemental existe-t-il dans l'espèce humaine ? Quelle pression de sélection, quelle niche écologique, quelle stratégie reproductive aberrante ?
On cartographie des surfaces sans explorer les profondeurs. C'est de la criminologie plate.
Vers une approche intégrative
Les taxonomies ont échoué parce qu'elles confondent « description » et « explication ». Holmes & DeBurger spéculent sans rigueur. Canter mesure sans théoriser. Le FBI observe sans interpréter.
Une approche authentiquement scientifique devrait :
1. Ancrer l'analyse dans une théorie développementale robuste (attachement, trauma, construction de la personnalité).
2. Intégrer les données neurobiologiques disponibles, sans réductionnisme.
3. Penser la fonction adaptative du comportement, même aberrant, dans une perspective évolutionniste.
4. Reconnaître la construction sociale du phénomène (Watzlawick) sans tomber dans le relativisme.
5. Accepter la singularité irréductible de chaque cas, tout en cherchant des patterns généralisables.
Ce champ reste un désert théorique. Les tueurs en série continuent d'être traités comme des curiosités à classer plutôt que comme des révélateurs de processus psychopathologiques fondamentaux.
Le prochain article abordera précisément ce qui manque : l'angle darwinien. Pourquoi l'évolution a-t-elle permis qu'existe dans le répertoire comportemental humain cette capacité au meurtre en série ? Quelle est sa fonction, son coût, sa niche écologique ? Qu'est-ce que cela révèle de notre espèce ?
Sources :
Holmes, R. M., & DeBurger, J. (1988). Serial Murder. Sage Publications.
Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Douglas, J. E. (1988). Sexual Homicide: Patterns and Motives. Lexington Books.
Canter, D., & Wentink, N. (2004). "An empirical test of Holmes and Holmes's serial murder typology". Criminal Justice and Behavior, 31(4), 489-515.
Canter, D. (1994). Criminal Shadows. HarperCollins. (Vulgarisation de ses travaux)
Canter, D., & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology : Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Wiley.
Morton, R. J., & Hilts, M. A. (Eds.). (2005). Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators. Behavioral Analysis Unit, FBI.
Raine, A., Buchsbaum, M., & LaCasse, L. (1997). "Brain abnormalities in murderers indicated by positron emission tomography". Biological Psychiatry, 42(6), 495-508.
Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence : The Biological Roots of Crime. Pantheon. (Synthèse accessible)
Cleckley, H. (1941). The Mask of Sanity. Mosby.