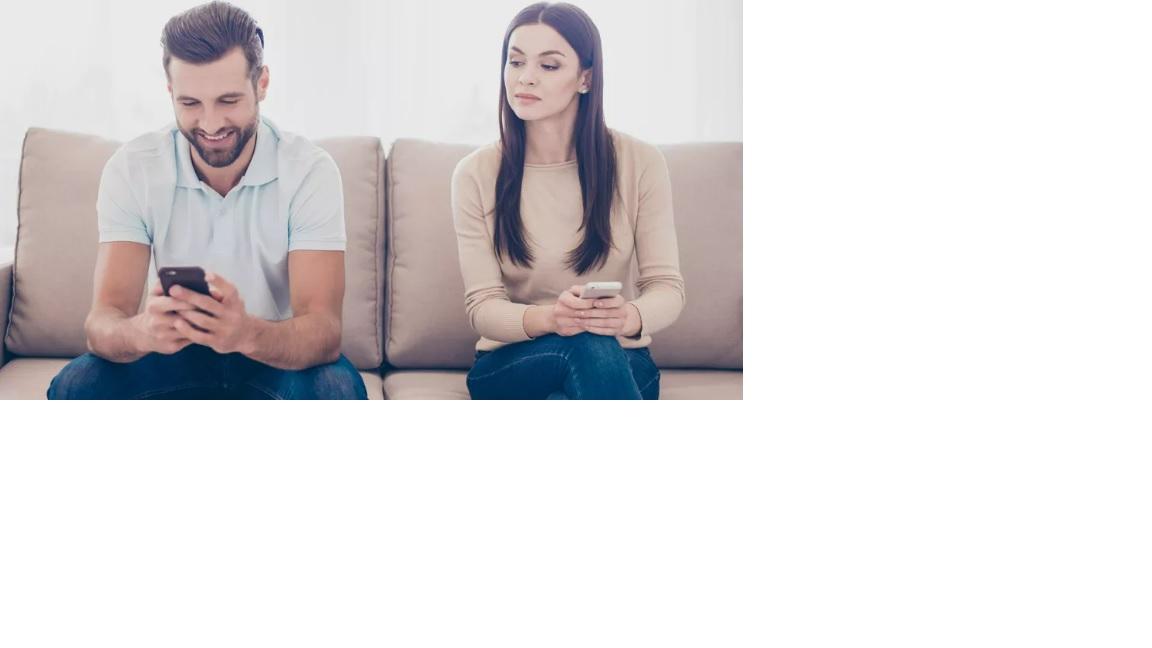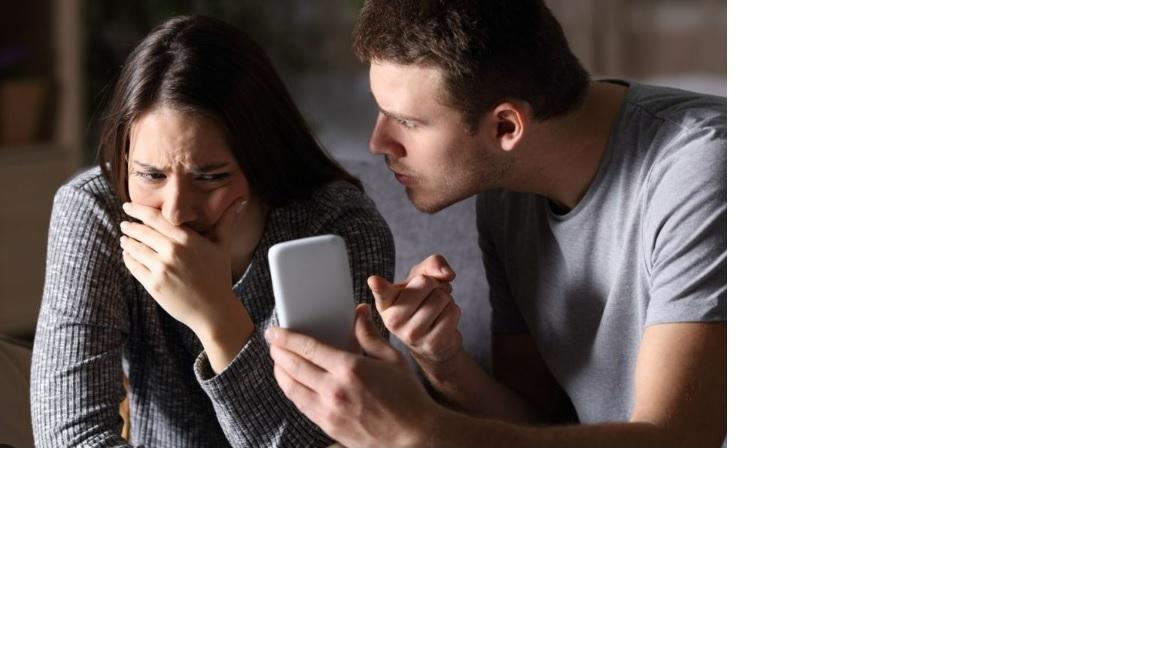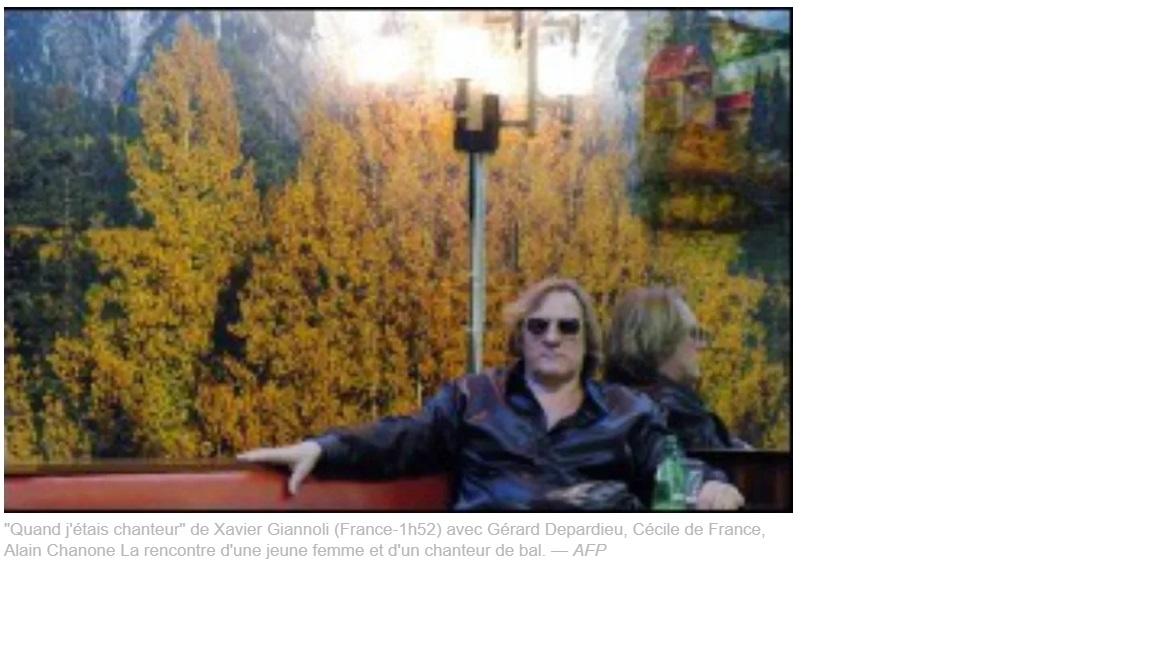stratégie de communication
Prédire un crime ? Pourquoi c'est impossible (et pourquoi c'est important de le dire)
Le 14/12/2025
« Comment a-t-on pu laisser faire ? Les signes étaient là ! »
Après chaque fait divers, la même ritournelle. Mais la vérité est inconfortable : prédire un crime est impossible. Pas faute de moyens ou de vigilance, mais pour des raisons épistémologiques fondamentales.
Dans cet article, j'explique :
• Pourquoi le biais rétrospectif nous trompe
• Pourquoi facteurs de risque ≠ certitude
• Pourquoi les algorithmes prédictifs sont une impasse
• Ce qu'on peut faire (vraiment) : comprendre, pas prédire
Humilité épistémologique ≠ impuissance. C'est une exigence éthique et scientifique.
Après chaque fait divers tragique, la même ritournelle médiatique : « Les signes étaient là », « On aurait dû voir venir », « Comment a-t-on pu laisser faire ? ». Voisins, collègues, proches défilent pour témoigner : « Il était bizarre, renfermé, il avait un regard étrange. » Les experts s'enchaînent sur les plateaux : « Tous les ingrédients du passage à l'acte étaient réunis. »
Et immanquablement, la question surgit : pourquoi n'a-t-on pas pu prédire ce crime ?
La réponse est simple, mais inconfortable : parce que c'est impossible.
Non pas faute de moyens, de vigilance ou de compétence. Mais parce que la prédiction individuelle d'un passage à l'acte criminel se heurte à des limites épistémologiques fondamentales que ni l'intelligence artificielle, ni les grilles de risque les plus sophistiquées, ni l'expertise la plus pointue ne peuvent surmonter.
Voici pourquoi.
Le piège du biais rétrospectif : après coup, tout semble évident
Reprenons un cas médiatisé : Jonathan Daval, qui tue son épouse Alexia en octobre 2017. Après le crime, les médias reconstituent son parcours. On repère des « signes » : discours incohérents sur son parcours professionnel, relation fusionnelle avec Alexia, isolement social relatif. Les commentateurs concluent : « C'était prévisible, tous les signes étaient là. »
Mais avant le crime, ces mêmes signes n'étaient ni visibles, ni significatifs.
Des millions de personnes mentent sur leur CV, ont des relations fusionnelles, vivent de manière discrète, sans jamais tuer leur conjoint. Avant le passage à l'acte, ces comportements sont noyés dans le bruit de fond de la vie ordinaire. Ils ne deviennent des « signes avant-coureurs » qu'après coup, parce qu'on les relit à travers le prisme du crime commis.
C'est le biais rétrospectif (hindsight bias), décrit par les psychologues Fischhoff et Beyth dans les années 1970 : notre tendance à surestimer a posteriori la prévisibilité d'un événement. Une fois qu'un événement s'est produit, nous reconstruisons le passé de manière à le rendre « évident », « inévitable ». On se dit : « J'aurais dû le voir. »
Mais non. Avant, vous ne pouviez pas le voir. Personne ne pouvait.
Facteurs de risque ≠ certitude : la confusion dangereuse
« Oui, mais il présentait des facteurs de risque ! Structure de personnalité fragile, antécédents traumatiques, contexte relationnel toxique... »
Certes. Mais identifier des facteurs de risque n'est pas prédire un passage à l'acte.
Prenons un exemple médical, plus facile à objectiver : un homme de 60 ans, fumeur, hypertendu, diabétique, présente un risque élevé d'infarctus. Le médecin prescrit un traitement préventif, recommande l'arrêt du tabac, l'exercice physique. Mais il ne peut pas prédire si ce patient précis fera un infarctus, quand, ni avec quelle gravité.
Certains patients à risque très élevé ne font jamais d'infarctus. D'autres, à risque faible, en font un à 45 ans. Les facteurs de risque augmentent la probabilité en population (« Sur 100 fumeurs hypertendus diabétiques, 30 feront un infarctus dans les 10 ans »), mais ne permettent pas de prédire individuellement.
Idem pour le passage à l'acte criminel.
Des milliers de personnes cumulent des facteurs de risque (structure de personnalité limite ou psychotique, antécédents de violence, contexte familial toxique, consommation d'alcool, isolement social) sans jamais tuer. La majorité des sujets présentant ce profil ne passent jamais à l'acte homicidaire. Ils souffrent (dépressions, addictions, tentatives de suicide, relations chaotiques), mais ils ne tuent pas.
Alors, qu'est-ce qui distingue ceux qui passent à l'acte de ceux qui ne passent pas ?
Des micro-variables impossibles à mesurer avant le passage à l'acte : seuil individuel de saturation pulsionnelle, intensité émotionnelle du moment précis, séquence interactionnelle exacte, parole prononcée ou tue, présence ou absence d'un tiers, état de fatigue, taux d'alcoolémie à cet instant-là, signification subjective d'un événement banal pour autrui mais déclencheur pour ce sujet-là.
Ces variables ne sont pas accessibles à l'observation externe. On ne dispose pas d'un « refoulomètre » qui indiquerait : « Attention, saturation à 95 %, passage à l'acte imminent. »
Le fantasme de l'algorithme salvateur : « L'IA va tout résoudre »
Face à cette impuissance prédictive, une tentation techniciste : « Avec l'intelligence artificielle, on va enfin pouvoir repérer les futurs criminels. Des algorithmes analyseront des milliers de données (historique judiciaire, posts sur les réseaux sociaux, géolocalisation, consommation de contenus violents), identifieront les profils à risque, alerteront les autorités. »
Ce fantasme est doublement problématique.
1. Techniquement, ça ne marche pas.
Les algorithmes prédictifs fonctionnent sur des corrélations statistiques en population. Ils peuvent dire : « Les personnes ayant ce profil (antécédents judiciaires + consommation de contenus violents + isolement social) ont un risque accru de passage à l'acte. » Mais ils ne peuvent pas dire : « Cette personne précise va commettre un crime. »
Résultat : des taux de faux positifs massifs. Si on enfermait préventivement tous les individus qu'un algorithme désigne comme « à risque », on incarcérerait des milliers d'innocents pour quelques criminels potentiels.
Scénario dystopique, éthiquement inacceptable, juridiquement impossible (on ne punit pas un crime non commis).
2. Éthiquement, c'est inacceptable.
Même si un algorithme était performant (supposons, par hypothèse absurde, 90 % de justesse), cela impliquerait une surveillance généralisée, une collecte massive de données intimes, une présomption de culpabilité fondée sur des « profils ». C'est Minority Report, pas une société démocratique.
Pire : cette surveillance ciblerait prioritairement les populations déjà marginalisées (jeunes des quartiers populaires, personnes avec antécédents psychiatriques, migrants), renforçant les discriminations existantes.
Le fantasme de l'algorithme salvateur est une impasse technique ET éthique.
Ce qu'on peut faire (vraiment) : comprendre, pas prédire
Reconnaître qu'on ne peut pas prédire individuellement, ce n'est pas renoncer à toute action. C'est simplement orienter nos efforts vers ce qui est possible, utile, éthique.
1. Analyser a posteriori pour comprendre
Après un crime, l'analyse comportementale permet de donner du sens : pourquoi ce sujet-là, avec cette histoire-là, dans ce contexte-là, a basculé dans l'acte ? Cette compréhension aide les proches de la victime à sortir de la sidération (« Pourquoi nous ? »), aide le criminel lui-même à élaborer psychiquement son acte (s'il en est capable), aide les professionnels (psychiatres, magistrats) à adapter les prises en charge.
Exemple : le modèle DS2C (que je développe dans mes travaux) articule quatre niveaux d'analyse — phylogenèse (substrat pulsionnel universel), tempérament (modalité individuelle de réactivité), structure de personnalité (névrose, psychose, limite), situation (contexte déclencheur) — pour comprendre a posteriori comment le passage à l'acte s'inscrit dans une logique structurelle et situationnelle cohérente.
Mais cette intelligibilité après coup ne signifie pas qu'on aurait pu prédire avant.
2. Identifier des facteurs de risque en population (pas en individu)
On peut repérer des populations vulnérables (femmes victimes de violences conjugales, personnes isolées avec troubles psychiatriques non suivis, adolescents en rupture familiale et scolaire) et proposer des interventions préventives :
Dispositifs d'écoute et d'hébergement d'urgence pour les victimes de violences conjugales.
Accès facilité aux soins psychiatriques pour les personnes en souffrance psychique.
Accompagnement social des jeunes en rupture.
Ces interventions ne prédisent pas qui va tuer, mais elles réduisent globalement le risque en sortant les sujets de l'isolement, en leur offrant des alternatives symboliques au passage à l'acte.
3. Former les professionnels à repérer les signes de vulnérabilité (pas de dangerosité)
Un médecin, un psychologue, un travailleur social, un enseignant peuvent repérer des signes de souffrance psychique : isolement croissant, discours suicidaire, consommation excessive d'alcool, violence verbale récurrente. Ces signes n'annoncent pas un crime, mais ils signalent une détresse qui nécessite une prise en charge.
L'objectif n'est pas de surveiller des « futurs criminels », mais d'accompagner des personnes en souffrance.
Pourquoi cette humilité est importante (éthiquement et scientifiquement) ?
Reconnaître qu'on ne peut pas prédire, c'est :
1. Respecter la complexité humaine. L'être humain n'est pas une machine dont on pourrait anticiper le comportement en connaissant tous les paramètres. Il reste un sujet, partiellement opaque à lui-même et aux autres, capable de surprise, de changement, de contradiction.
2. Éviter les dérives sécuritaires. Le fantasme prédictif nourrit des politiques de surveillance généralisée, de fichage préventif, de présomption de culpabilité. C'est une pente dangereuse pour les libertés publiques.
3. Préserver la rigueur scientifique. Affirmer qu'on peut prédire (sans en avoir les moyens réels), c'est tromper le public, les décideurs, les magistrats. C'est produire de fausses certitudes qui, lorsqu'elles échouent (un sujet évalué comme « non dangereux » récidive, ou inversement), discréditent toute l'expertise.
L'humilité épistémologique n'est pas une faiblesse, c'est une exigence éthique et scientifique.
Expliquer, ne pas prophétiser
Non, on ne peut pas prédire qui va commettre un crime. Ni avec des grilles de risque, ni avec des algorithmes, ni avec l'expertise la plus pointue. Les facteurs de risque existent, ils orientent la vigilance, mais ils ne désignent pas des futurs coupables.
Ce qu'on peut faire :
Comprendre a posteriori pour donner du sens, orienter les prises en charge, améliorer les pratiques.
Identifier des populations vulnérables (pas des individus dangereux) et proposer des interventions préventives.
Former les professionnels à repérer la souffrance psychique (pas la dangerosité future).
Ce qu'on ne peut pas faire :
Prédire individuellement qui va passer à l'acte.
Éliminer l'incertitude radicale qui traverse toute existence humaine.
Remplacer le jugement clinique par un algorithme omniscient.
Le passage à l'acte reste, in fine, un acte humain singulier, jamais totalement réductible à ses déterminants. Assumer cette limite, c'est préserver à la fois la rigueur scientifique et le respect de la dignité humaine.
Pour aller plus loin :
Si vous souhaitez approfondir ces questions (analyse structurelle du passage à l'acte, limites de l'expertise, enjeux éthiques de la prédiction), n'hésitez pas à me contacter ou à consulter mes travaux sur le modèle DS2C (Décrypter les Stratégies Comportementales de Communication).
Frantz BAGOE – DS2C
Analyste comportemental spécialisé dans l'analyse du passage à l'acte criminel.
Affaire Marc Demeulemeester
Le 11/12/2025
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/EYfCXITEy_Y
1. DÉCRYPTER : Observer et évaluer (selon les éléments disponibles)
1.1 Anamnèse
Histoire personnelle : Informations limitées. Homme de 45-46 ans, habitant de Gonnehem, compagnon de Sabine, mère d'Antoine. Aucune information disponible sur son enfance, ses relations parentales précoces, ses éventuels traumatismes. Cette absence d'information est un angle mort majeur de l'analyse.
Il semble qu’il a été élevé par sa mère et sa grand-mère, donc absence du père. Il semble également qu’il était sans emploi, ce qui suggère qu’il se sentait dévalorisé et laissé seul face à sa relation avec son beau-fils.
Enfin, Sabine aurait été sa première relation, d’où une idéalisation qui explique l’envoi de lettres à Sabine lorsqu’il était incarcéré.
Relation avec Antoine : Relation conflictuelle chronique avec son beau-fils, tensions qualifiées d'"invivables" selon l’enquête de la gendarmerie. Il réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser de l'adolescent qu'il ne supportait plus. La nature précise de ces conflits n'est pas documentée dans les sources disponibles.
Événements marquants :
Mise en couple avec Sabine, la mère d'Antoine (date inconnue)
28 janvier 2015 : passage à l'acte (meurtre d'Antoine)
Date indéterminée : gifle reçue d’Antoine alors que Marc Demeulemeester tentait de s’interposer lors d’une dispute entre Antoine et sa sœur
Janvier 2015 - mars 2016 : 13 mois de dissimulation active, participation aux recherches
1er mars 2016 : aveux après interrogatoire prolongé
Première tentative de suicide quelques jours après les aveux (prison de Sequedin)
Juin 2016 : participation à une reconstitution, état de fatigue noté par son avocate
12 août 2016 : suicide réussi (prison de Charleville-Mézières)
1.2 Tempérament (Le Senne) - Hypothèses
Émotivité : Difficile à évaluer avec certitude. Ses apparitions médiatiques montraient peu d'émotions visibles compte tenu de la situation, émotions rares et très contenues. Cela peut indiquer :
Soit une non-émotivité (nE) constitutionnelle
Soit une émotivité (E) massivement contrôlée, refoulée
Son suicide suggère plutôt une émotivité présente mais non-exprimée.
Hypothèse : Émotif (E), mais avec un contrôle défensif massif.
Activité : Très actif dans l'organisation des recherches, prise en charge des battues, présence médiatique volontaire. Cette hyperactivité post-acte suggère un tempérament Actif (A). Mais cette activité est-elle constitutionnelle ou défensive (contrer l'angoisse par l'action) ? Probablement les deux.
Retentissement : Il réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser d'Antoine. Cette rumination prolongée avant le passage à l'acte suggère un retentissement Secondaire (S). Les affects s'accumulent, persistent, ne se déchargent pas immédiatement.
Hypothèse tempéramentale : Passionné (Émotif, Actif, Secondaire) ou Sentimental (Émotif, non-Actif, Secondaire) avec passages à l'action défensifs. Le Passionné rumine longuement, planifie, puis passe à l'acte de manière organisée. Cela correspond au profil : préméditation de plusieurs mois, passage à l'acte méthodique (étranglement durant le sommeil), dissimulation élaborée (lestage du corps, visites régulières pour ajouter des parpaings).
1.3 Structure de personnalité (Bergeret) - Analyse
Hypothèse structurelle : Structure limite avec traits névrotiques.
Arguments pour la structure limite :
Clivage : La dissimulation pendant 13 mois révèle un clivage massif. Il participe activement aux recherches, s'affiche dans les médias comme le beau-père inquiet, organise des battues. Ce n'est pas du simple mensonge stratégique, c'est une coexistence de deux réalités : une partie de lui sait qu'il a tué Antoine, une autre partie joue le rôle du beau-père aimant et inquiet. Ce clivage est caractéristique de la structure limite.
Impossibilité de tolérer l'autre : Les tensions étaient invivables, il ne supportait plus cet adolescent (enfant roi). Cette intolérance absolue suggère un échec de l'ambivalence. Dans une structure névrotique, on peut détester quelqu'un tout en continuant à vivre avec (refoulement, formation réactionnelle). Dans une structure limite, l'objet devient soit tout bon (idéalisé), soit tout mauvais (persécuteur). Antoine était probablement perçu comme l'objet persécuteur qu'il fallait éliminer.
Passage à l'acte prémédité mais non psychotique : Le passage à l'acte est méthodique, organisé, lucide. Ce n'est pas une décharge désorganisée psychotique. Mais ce n'est pas non plus une décompensation névrotique brutale. C'est un passage à l'acte limite : planifié pour "résoudre" une situation relationnelle devenue intolérable.
Arguments pour des traits névrotiques :
Culpabilité post-acte : Son avocate indiquait qu'il regrettait le mal causé, qu'il assumait ses actes et était prêt à en répondre devant la justice. Cette culpabilité suggère un Surmoi actif, une capacité de reconnaître le mal fait à autrui. C'est plus névrotique que limite pur.
Suicide : Signalé comme fragile psychiquement, suivi par un psychiatre, première tentative de suicide quelques jours après les aveux, suicide réussi 5 mois après. Le suicide peut être interprété comme une autopunition (culpabilité névrotique) ou comme une impossibilité de tolérer la réalité de l'incarcération et du jugement à venir (effondrement limite).
Hypothèse finale : Structure limite avec surinvestissement névrotique du contrôle. Il tente de maintenir une façade névrotique (contrôle, dissimulation, rationalisation), mais la structure sous-jacente est limite (clivage, intolérance de l'autre, passage à l'acte pour "résoudre" une impasse relationnelle).
1.4 Indices comportementaux
Dans ses interventions médiatiques, Marc Demeulemeester était flou sur le contexte de la disparition, montrait peu d'émotions, utilisait un langage distancier et des pronoms dilutifs comme "on".
Cependant son corps ne trompe pas, je constate des items gestuels sur son visage qui illustrent une tension accumulée, une fuite émotionnelle mais également une satisfaction à réussir à berner tout le monde.
Ces indices révèlent :
Contrôle défensif massif : Tentative consciente de ne rien révéler qui pourrait trahir sa culpabilité. Mais aussi contrôle inconscient : le clivage permet de jouer le rôle sans affect authentique.
Dissociation partielle : L'utilisation du "on" au lieu du "je" suggère une mise à distance. "On n'a aucune idée" plutôt que "Je n'ai aucune idée". Cette dilution pronominale traduit une difficulté à s'impliquer subjectivement dans le discours.
Absence d'affect congruent : Les émotions montrées étaient rares et très contenues compte tenu de la situation. Un beau-père dont le fils a disparu devrait manifester une détresse intense, visible, voire débordante. L'absence d'affect congruent est un indice fort (mais pas une preuve) de dissimulation.
2. STRATÉGIES : Comprendre la dynamique psychique
2.1 Mécanismes de défense en action
Le clivage : Mécanisme dominant. Marc clive entre deux réalités inconciliables :
Réalité 1 : "J'ai tué Antoine, je l'ai jeté dans le canal, je dois empêcher qu'on le retrouve."
Réalité 2 : "Antoine a disparu, je suis inquiet, je fais tout pour le retrouver."
Ces deux réalités coexistent sans se rencontrer pendant 13 mois. Ce n'est pas du simple mensonge conscient. C'est un clivage actif : une partie du Moi sait, une autre partie ne sait pas (ou fait comme si elle ne savait pas).
Le contrôle omnipotent : Il retournait régulièrement sur les lieux pour ajouter des parpaings et empêcher le corps de remonter à la surface. Cette tentative de contrôle total révèle une angoisse massive : si le corps remonte, tout s'effondre, notamment sa relation avec Sabine. Il doit maîtriser la situation, contrôler chaque variable. Ce contrôle omnipotent est typique des structures limites.
La rationalisation : La préméditation de plusieurs mois suggère une tentative de rationaliser l'acte. "Antoine est invivable, je ne peux plus le supporter, la seule solution est de m'en débarrasser." Cette rationalisation permet de transformer un désir meurtrier inacceptable en "solution logique" à un problème relationnel.
L'acting out post-acte : La participation active aux recherches, les apparitions médiatiques, l'organisation des battues constituent un acting out massif. Marc ne se contente pas de se taire (dissimulation passive). Il s'affiche publiquement, joue le rôle du beau-père inquiet, du sauveur, adresse un message à la société : "Regardez comme je cherche Antoine, je ne peux pas être le coupable." C'est une mise en scène destinée à tromper, mais aussi à convaincre une partie de lui-même qu'il n'a pas tué.
2.2 Patterns relationnels
Pattern de contrôle rigide : La relation avec Antoine était probablement marquée par une tentative de contrôle de la part de Marc. Un adolescent de 15 ans s'oppose naturellement à l'autorité parentale. Si Marc ne tolérait aucune opposition, aucune autonomie, les conflits devaient être permanents.
Complémentarité rigide beau-père/beau-fils : Marc a probablement tenté d'imposer une complémentarité rigide : "Je suis l'autorité (beau-père), tu es le subordonné (beau-fils)". Mais Antoine, adolescent en quête d'autonomie, résistait à cette complémentarité. Cette résistance était vécue par Marc comme une menace insupportable.
Triangulation mère/beau-père/fils : Quelle était la position de la mère d'Antoine dans ce système ? Soutenait-elle son fils contre Marc ? Soutenait-elle Marc contre son fils ? Était-elle prise dans une double contrainte (loyauté envers son fils vs loyauté envers son compagnon) ? Cette dimension n'est pas documentée dans les sources, mais elle est cruciale pour comprendre la dynamique familiale.
2.3 Dynamique pulsionnelle
Agressivité accumulée : Marc réfléchissait depuis plusieurs mois à la manière de se débarrasser d'Antoine. Cette rumination prolongée révèle une agressivité qui s'accumule, qui ne se décharge pas immédiatement (retentissement secondaire), qui devient obsédante. L'agressivité n'est pas refoulée (elle est consciente), mais elle ne peut être exprimée directement (inhibition de l'action violente immédiate).
Passage de la rumination à la planification : À un moment donné, certainement que la gifle reçue est l’élément déclencheur, Marc bascule de la rumination ("je ne supporte plus cet adolescent") à la planification ("comment puis-je m'en débarrasser ?"). Ce basculement révèle un échec de la régulation symbolique. Au lieu de chercher des solutions relationnelles (dialogue avec Antoine, médiation familiale, thérapie, séparation du couple), il cherche une solution définitive : l'élimination physique.
Déshumanisation de l'objet : Pour pouvoir tuer, Marc a probablement dû déshumaniser Antoine. Ne plus le percevoir comme un sujet adolescent avec ses désirs, ses peurs, ses besoins, mais comme un objet encombrant, nuisible, qu'il faut éliminer. Cette déshumanisation est caractéristique des passages à l'acte limites : l'objet persécuteur n'est plus un humain, c'est une menace à détruire.
2.4 Fragilités structurelles identifiées
Intolérance à la frustration : Marc ne pouvait tolérer qu'Antoine lui résiste, s'oppose, existe comme sujet autonome. Cette intolérance révèle une fragilité narcissique massive. Pour un sujet névrotique, l'opposition adolescente est frustrante mais tolérable. Pour un sujet limite, elle devient une menace existentielle.
Incapacité à se séparer symboliquement : Face à une relation invivable, un sujet bien régulé cherche des solutions : médiation, séparation du couple, placement de l'adolescent chez son père biologique. Marc n'a envisagé qu'une seule solution : l'élimination physique. Cette incapacité à se séparer symboliquement (par la parole, la négociation, la rupture relationnelle) révèle une défaillance limite.
Absence d'élaboration de la culpabilité avant l'acte : Un sujet névrotique qui rumine un meurtre pendant des mois serait envahi par la culpabilité avant même de passer à l'acte. Cette culpabilité anticipée empêcherait généralement le passage à l'acte. Marc a pu planifier pendant des mois sans que la culpabilité ne l'arrête. Cela suggère soit un clivage massif (la partie qui planifie ne ressent pas de culpabilité), soit une suspension temporaire du Surmoi.
3. COMMUNICATION : Analyser le contexte déclencheur
3.1 Contexte familial pré-passage à l'acte
Climat relationnel : Tensions qualifiées d'"invivables" . Mais quelle était la nature précise de ces tensions ? Disputes quotidiennes ? Violences verbales ? Provocations mutuelles ?
Escalade symétrique probable : Les conflits beau-père/adolescent prennent souvent la forme d'escalades symétriques. L'adolescent provoque ("tu n'es pas mon père"). Le beau-père surenchérit ("dans ma maison, c'est moi qui commande"). L'adolescent renchérit ("je ne t'obéirai jamais"). L'escalade monte progressivement. Si aucun mécanisme de régulation n'existe (médiation maternelle, capacité de l'un ou l'autre à désamorcer), l'escalade peut devenir chronique, insupportable.
3.2 Le déclencheur situationnel (hypothèses)
Le passage à l'acte survient le 28 janvier 2015. Qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'acte ce jour-là après des mois de rumination ?
Hypothèse 1 : Rupture d'homéostasie : Un événement spécifique a fait basculer Marc de la rumination à l'acte. Une dispute particulièrement violente ? Une menace d'Antoine ("je vais dire à maman ce que tu me fais") ? Une humiliation publique ? Il semble que l’élément déclencheur soit la gifle que Marc a reçue lorsqu’il a tenté de s’interposer lors d’une dispute entre Antoine et sa soeur.
Hypothèse 2 : Saturation de la capacité de contention : Marc a ruminé pendant des mois. À un moment donné, la tension accumulée a dépassé sa capacité de contention. Le passage à l'acte n'a pas nécessairement besoin d'un déclencheur spécifique majeur. C'est l'accumulation chronique qui finit par déborder.
3.3 Le contexte post-acte : dissimulation et acting out
Phase de dissimulation active (janvier 2015 - mars 2016) :
Marc participe activement aux recherches, organise des battues, s'affiche dans les médias, retourne régulièrement sur les lieux pour lester davantage le corps. Cette phase révèle :
Un contrôle défensif massif : Il doit maintenir la dissimulation, empêcher toute découverte.
Un clivage en action : Il joue le rôle du beau-père inquiet tout en sachant qu'Antoine est mort par sa main.
Une angoisse chronique : Chaque jour, il vit dans la terreur d'être découvert. Cette angoisse est probablement insoutenable.
Phase d'effondrement (mars 2016 - août 2016) :
Aveux après interrogatoire, tentative de suicide immédiate, signalement comme fragile psychiquement, suicide réussi 5 mois plus tard. L'effondrement post-aveux révèle que le clivage ne tient plus. Les deux réalités se rencontrent brutalement. Marc doit affronter ce qu'il a fait. La culpabilité devient insoutenable. Le suicide devient la seule "solution" pour échapper à cette culpabilité et à la perspective du jugement. Je rappelle également que Marc avait écrit des lettres à Sabine pour tenter de retrouver son amour, pour qu’elle lui pardonne son acte.
4. CONVERGENCE DS2C : Pourquoi Marc Demeulemeester est-il passé à l'acte ?
Niveau phylogénétique :
Substrat pulsionnel agressif universel, activé par des conflits chroniques avec Antoine. L'agressivité phylogénétique existe chez tous les humains. Chez Marc, elle a été massivement activée par une relation vécue comme invivable.
Niveau tempéramental :
Probablement Passionné (Émotif, Actif, Secondaire). Ce tempérament favorise :
L'accumulation des affects (retentissement secondaire) : la colère s'accumule pendant des mois au lieu de se décharger immédiatement
La planification (activité dirigée) : passage de la rumination à l'organisation méthodique du meurtre
L'intensité émotionnelle refoulée (émotivité) : affects massifs mais contrôlés en surface, jusqu'à l'explosion finale
Niveau ontogénétique :
Structure limite avec traits névrotiques. Cette structure détermine :
Le clivage : coexistence de deux réalités (je sais que j'ai tué / je joue le beau-père inquiet)
L'intolérance de l'objet persécuteur : Antoine devient l'objet mauvais qu'il faut éliminer
Le passage à l'acte comme "solution" : incapacité à résoudre symboliquement le conflit relationnel
La culpabilité post-acte : traits névrotiques qui produisent un effondrement après les aveux
Niveau situationnel :
Complémentarité rigide + escalades symétriques répétées + rupture d'homéostasie
Complémentarité rigide : Marc tente d'imposer son autorité, Antoine résiste
Escalades symétriques : disputes répétées où aucun ne peut céder sans perdre la face
Rupture d'homéostasie : événement déclencheur spécifique (gifle) ou saturation chronique de la tension accumulée
Absence de régulation externe : pas de médiation maternelle efficace, pas de soutien thérapeutique
Convergence finale :
Le passage à l'acte de Marc Demeulemeester résulte de la convergence de ces quatre niveaux :
Pulsion agressive phylogénétique activée par des conflits chroniques
Tempérament Passionné favorisant l'accumulation (secondaire) et la planification (actif)
Structure limite ne permettant qu'un clivage instable, une intolérance de l'autre, une résolution par l'acte plutôt que par le symbole
Contexte situationnel de complémentarité rigide et d'escalades répétées, sans médiation externe efficace
À un moment donné (janvier 2015), cette convergence atteint un point critique. La capacité de régulation de Marc est débordée. La pulsion agressive, accumulée pendant des mois, ne peut plus être contenue par le clivage. L'opportunité se présente (Antoine endormi, vulnérable). Le passage à l'acte survient.
5. PROFIL SYNTHÉTIQUE
Structure : Limite avec traits névrotiques
Tempérament : Passionné (hypothèse)
Mécanismes de défense dominants : Clivage, contrôle omnipotent, rationalisation
Angoisse dominante : Probablement angoisse d'engloutissement (Antoine envahit son espace, menace sa position, il doit s'en débarrasser)
Pattern relationnel : Complémentarité rigide, intolérance de l'opposition adolescente
Type de passage à l'acte : Prémédité, méthodique, lucide, avec dissimulation élaborée
Issue : Effondrement post-aveux, culpabilité insoutenable, suicide
6. LIMITES DE CETTE ANALYSE
Angles morts majeurs :
Absence d'anamnèse détaillée : Nous ne savons rien de l'enfance de Marc, de ses relations parentales, de ses traumatismes éventuels, de son histoire conjugale avant la relation avec la mère d'Antoine.
Absence d'informations sur la nature précise des conflits avec Antoine : Étaient-ce des conflits d'autorité classiques ? Des provocations mutuelles ? Des violences réciproques ?
Absence d'informations sur le rôle de la mère : Comment se positionnait-elle dans le conflit entre son compagnon et son fils ? Cette position est essentielle pour comprendre le système familial.
Absence d'expertise psychiatrique disponible : Marc est mort avant son procès. Aucune expertise psychiatrique complète n'a été rendue publique. Nous travaillons donc sur des hypothèses structurelles, pas sur des certitudes diagnostiques.
Analyse uniquement à partir de sources médiatiques : Les informations disponibles proviennent de la presse. Elles sont partielles, parfois contradictoires, nécessairement lacunaires.
Cette analyse DS2C est donc une reconstruction hypothétique basée sur les éléments disponibles. Elle propose une grille de lecture cohérente avec notre modèle théorique, mais elle ne prétend pas à la certitude. Une analyse complète nécessiterait l'accès au dossier judiciaire, aux témoignages, aux expertises, aux interrogatoires.
DS2C : une méthode intégrative développementale et psychodynamique du passage à l'acte
Le 22/11/2025
L'analyse du passage à l'acte souffre d'un cloisonnement disciplinaire préjudiciable. D'un côté, la criminologie actuarielle multiplie les facteurs de risque, quantifie les probabilités de récidive, mais reste en surface : elle prédit sans comprendre. De l'autre, la psychanalyse explore les profondeurs de l'économie psychique, accède au sens du symptôme, mais peine à opérationnaliser ses intuitions : elle comprend sans prédire.
Cette fracture épistémologique pose problème. L’analyste confronté à un passage à l'acte violent a besoin d'une double lecture : identifier les facteurs de vulnérabilité (pour évaluer le risque) ET saisir la dynamique psychique singulière (pour comprendre pourquoi cet individu, à ce moment précis, a basculé dans l'acte).
DS2C est une méthode intégrative qui articule rigueur empirique et profondeur clinique. Elle s'appuie sur deux piliers complémentaires : l'approche développementale de la psychocriminologie moderne (trajectoires de vie, attachement, facteurs de risque) et la lecture psychodynamique (structure de personnalité, économie pulsionnelle, caractérologie, pragmatique de la communication). Cette double lecture permet une analyse à la fois prédictive et compréhensive du passage à l'acte.
Génèse de la méthode
DS2C naît d'une insatisfaction clinique. Formé à la psychologie, je m’intéresse rapidement à la psychologie évolutionniste et comportementale, mais j'ai rapidement buté sur les limites du behaviorisme radical. Watson et Skinner évacuent le psychisme, cette "boîte noire" dont ils refusent de spéculer le contenu. Le comportement observable devient la seule réalité : stimulus, réponse, conséquence. Cette approche fonctionnelle permet de modifier des comportements, certes, mais elle ignore ce qui fait l'essence du passage à l'acte : le sens qu'il prend dans l'économie psychique du sujet.
Abandonner le behaviorisme pur ne signifie pas renoncer à l'observation comportementale. L'analyse des séquences (antécédents, comportement, conséquences), l'identification des renforçateurs, la compréhension des patterns d'adaptation restent des outils précieux. Mais ils doivent être intégrés à une lecture plus large qui interroge : pourquoi ce sujet a-t-il construit ce mode d'adaptation plutôt qu'un autre ? Quelle angoisse cherche-t-il à éviter ? Quel affect ne peut-il élaborer autrement que par l'agir ?
La psychanalyse structurale (Freud, Bergeret) offre ce cadre de compréhension. Elle permet de saisir l'organisation psychique du sujet, la nature de ses angoisses, la solidité de son Moi, ses mécanismes de défense dominants. Elle donne accès au sens inconscient du passage à l'acte : compulsion de répétition, retour du refoulé, effraction traumatique, décharge d'un affect insupportable.
Mais la psychanalyse seule ne suffit pas. Il lui manque l'ancrage empirique de la psychocriminologie moderne : les données sur les trajectoires développementales, les recherches sur l'attachement, les études sur les facteurs de risque validés statistiquement. Ces travaux (Moffitt, Fonagy, Cusson, Coutanceau) permettent de quantifier les vulnérabilités, d'identifier les fenêtres critiques, d'évaluer les probabilités de récidive. Ils offrent un socle factuel indispensable à toute expertise.
DS2C articule ces deux approches. Elle refuse le réductionnisme (tout expliquer par les facteurs de risque OU tout expliquer par l'inconscient) pour construire une lecture stratifiée du passage à l'acte.
Les piliers de DS2C
A. Pilier empirique : l'approche développementale
Le passage à l'acte ne surgit jamais ex nihilo. Il s'inscrit dans une trajectoire de vie, résultat d'interactions cumulées entre vulnérabilités individuelles et adversité environnementale. L'approche développementale reconstitue cette trajectoire.
Les trajectoires de vie (Moffitt, Patterson) distinguent plusieurs patterns : début précoce avec continuité (life-course persistent), passage à l'acte limité à l'adolescence (adolescence-limited), ou début tardif. Ces trajectoires ne sont pas immuables : des turning points (événements charnières) peuvent les réorienter, positivement ou négativement.
La théorie de l'attachement (Bowlby, Ainsworth, Fonagy) montre que la qualité du lien précoce détermine la capacité de régulation émotionnelle et les stratégies relationnelles ultérieures. L'attachement insécure, et particulièrement l'attachement désorganisé, constitue un facteur de risque majeur de violence. La mentalisation (capacité à comprendre ses propres états mentaux et ceux d'autrui) se construit dans ce lien précoce : sa défaillance compromet la capacité d'empathie et favorise le passage à l'acte.
Les facteurs de risque et de protection (Cusson, Coutanceau) s'accumulent au fil du développement. L'Adverse Childhood Experiences (ACE) score quantifie cette adversité cumulée : maltraitance, négligence, dysfonctionnement familial. Plus le score est élevé, plus le risque de passage à l'acte violent augmente. À l'inverse, les facteurs de protection (ressources personnelles, soutien social, expériences positives) peuvent contrebalancer ces vulnérabilités.
Ce pilier empirique répond à la question : QUELS facteurs ont conduit à ce passage à l'acte ? Il permet d'établir un pronostic criminologique, d'identifier les fenêtres de vulnérabilité, d'évaluer le risque de récidive.
B. Pilier psychodynamique : structure et dynamique
Les facteurs de risque ne produisent pas les mêmes effets chez tous les individus. Deux sujets avec un parcours développemental similaire peuvent présenter des passages à l'acte radicalement différents. Pourquoi ? Parce que la structure de personnalité détermine le type de décompensation.
La structure de personnalité (Bergeret) organise le fonctionnement psychique selon trois grands modes : psychotique (morcellement du Moi, angoisse de morcellement), limite (clivage, angoisse d'abandon), névrotique (refoulement, angoisse de castration). Le passage à l'acte psychotique (brutal, délirant, sans affect) n'a rien à voir avec le passage à l'acte limite (impulsif, répété, dans la dépendance relationnelle) ou névrotique (rare, symbolique, chargé de culpabilité).
L'économie pulsionnelle (Freud) interroge la balance entre Éros et Thanatos, la capacité de liaison de l'affect, la nature des mécanismes de défense. Le passage à l'acte survient quand l'affect ne peut être élaboré psychiquement : soit parce que les défenses sont trop rigides (refoulement excessif → retour du refoulé), soit parce qu'elles sont trop fragiles (clivage → décharge). La compulsion de répétition pousse à rejouer le trauma, tentative inconsciente de maîtrise qui échoue et se répète.
La caractérologie (Le Senne) affine cette analyse en introduisant la dimension temporelle. Selon le profil caractériel (émotif/non-émotif, actif/non-actif, primaire/secondaire), le délai entre tension et passage à l'acte varie. Le Colérique (émotif-actif-primaire) explose immédiatement. Le Passionné (émotif-actif-secondaire) rumine longuement avant d'agir. Le Sentimental (émotif-non-actif-secondaire) accumule jusqu'à l'effondrement brutal. Cette typologie permet de prédire la temporalité du passage à l'acte et d'identifier les signaux précurseurs.
En supplément, la pragmatique de la communication (Watzlawick) replace le passage à l'acte dans son contexte interactionnel. Les escalades symétriques (surenchère), les complémentarités rigides, les doubles contraintes (injonctions paradoxales) créent des spirales comportementales qui mènent à l'acte. La prophétie auto-réalisatrice fonctionne : "tu vas me quitter" → comportements de contrôle → étouffement relationnel → abandon effectif → passage à l'acte violent. L'observation de la communication non-verbale (congruence/incongruence avec le discours, signaux de tension) complète cette analyse.
Ce pilier psychodynamique répond à la question : COMMENT et POURQUOI ce sujet singulier a basculé dans l'acte à ce moment précis ? Il donne accès au sens inconscient du passage à l'acte et permet de comprendre sa fonction dans l'économie psychique.
Les 6 phases d'analyse DS2C
DS2C déploie une analyse stratifiée en six phases, du plus général (développemental) au plus singulier (interactionnel).
Phase 1 : Analyse développementale
- Questions posées : Quelle est l'histoire d'attachement du sujet ? Quels traumas a-t-il subis ? Quelle est sa trajectoire de vie ? Quels facteurs de risque et de protection sont présents ?
- Outils mobilisés : Anamnèse structurée, ACE score, identification des turning points, cartographie des ressources.
- Apport : Ce niveau établit le terreau développemental. Il permet d'identifier les vulnérabilités précoces, les patterns de continuité ou de rupture, les fenêtres critiques. Il fournit la base empirique pour l'évaluation du risque de récidive.
Phase 2 : Structure de personnalité (Bergeret)
- Questions posées : Quelle est la nature de l'angoisse dominante ? Quelle est la solidité du Moi ? Quels mécanismes de défense prédominent ? Quelle est la qualité des relations d'objet ?
- Outils mobilisés : Grille structurale de Bergeret (psychotique/limite/névrotique), analyse des mécanismes de défense (primaires/secondaires), observation clinique.
- Apport : Ce niveau détermine le TYPE de passage à l'acte. Une structure psychotique décompensera par effraction délirante, une structure limite par décharge impulsive, une structure névrotique par retour du refoulé. La structure prédit également la qualité de l'affect (absent, clivé, culpabilisé) et la capacité d'élaboration post-acte.
Phase 3 : Dynamique pulsionnelle (Freud + évolutionnisme)
- Questions posées : Quelle est la balance Éros/Thanatos ? Quel affect ne peut être élaboré ? Quel trauma est rejoué ? Quelle pulsion évolutionniste est en jeu (survie, reproduction, dominance) ?
- Outils mobilisés : Écoute psychanalytique, identification de la compulsion de répétition, analyse du sens inconscient, perspective évolutionniste darwinienne.
- Apport : Ce niveau donne accès au SENS du passage à l'acte. Il révèle ce que le sujet cherche inconsciemment à accomplir : décharger une rage archaïque, maîtriser un trauma en le rejouant, évacuer un affect insupportable. L'intégration de Darwin permet de comprendre comment certaines pulsions (territorialité, jalousie sexuelle, protection de la descendance) s'articulent avec les mécanismes psychiques.
Phase 4 : Profil caractériel (Le Senne)
- Questions posées : Le sujet est-il émotif ou non-émotif ? Actif ou non-actif ? Primaire ou secondaire ? Quel est son type caractériel parmi les 8 possibles ?
- Outils mobilisés : Grille caractérologique de Le Senne, observation de la réactivité émotionnelle et de la temporalité comportementale.
- Apport : Ce niveau prédit la TEMPORALITÉ du passage à l'acte. Il indique le délai probable entre montée de tension et décharge, identifie les signaux précurseurs spécifiques à chaque type, permet d'anticiper le mode de décompensation (explosion immédiate, rumination prolongée, effondrement brutal après inhibition).
Phase 5 : Analyse interactionnelle (Watzlawick)
- Questions posées : Qui sont les protagonistes (auteur, victime, tiers) ? Quelle est la séquence communicationnelle ? Y a-t-il escalade symétrique, double contrainte, prophétie auto-réalisatrice ? Que révèle la communication non-verbale ?
- Outils mobilisés : Axiomes de Watzlawick, analyse des patterns interactionnels, observation comportementale (posture, gestuelle, micro-expressions).
- Apport : Ce niveau replace le passage à l'acte dans sa dimension relationnelle. Il montre comment les spirales interactionnelles amplifient les tensions, comment les paradoxes communicationnels piègent les protagonistes, comment l'observation du non-verbal peut révéler la montée de tension avant l'acte. Il évite l'écueil d'une analyse purement intrapsychique en intégrant le contexte relationnel immédiat.
Phase 6 : Synthèse et prédiction
- Questions posées : Comment s'articulent les cinq niveaux précédents ? Quelle est la fonction du passage à l'acte (décharge, défense, communication, maîtrise) ? Quel est le risque de récidive ? Dans quelles conditions le passage à l'acte risque-t-il de se reproduire ?
- Outils mobilisés : Intégration multi-niveaux, reconstruction de la chaîne causale, identification des facteurs déclenchants, évaluation clinique du risque.
- Apport : Ce niveau synthétise l'analyse complète. Il reconstruit le passage à l'acte comme résultante d'une trajectoire développementale (terreau), d'une structure psychique (type de décompensation), d'une dynamique pulsionnelle (énergie et sens), d'un tempérament caractériel (temporalité) et d'une escalade interactionnelle (déclencheur). Cette reconstruction permet d'évaluer le risque de récidive, d'identifier les conditions critiques, de proposer des stratégies d'intervention adaptées.
Limites
DS2C ne prédit pas avec certitude. L'être humain n'est pas une machine déterministe. Des facteurs imprévisibles (événement fortuit, rencontre, décision consciente) peuvent modifier la trajectoire. L'analyse DS2C identifie des probabilités, des vulnérabilités, des patterns, mais ne peut garantir qu'un passage à l'acte aura lieu ou non.
Les biais de l'analyste sont inévitables. Toute observation comporte une part de subjectivité, toute interprétation psychanalytique reste hypothétique. L'analyste projette ses propres schémas, son contre-transfert influence sa lecture. La transparence sur ces limites est une exigence méthodologique.
DS2C nécessite des données complètes. L'analyse ne peut se faire sans anamnèse développementale, sans observation clinique prolongée, sans éléments contextuels détaillés. Une analyse rétrospective sur dossier reste partielle et doit être présentée comme telle.
Conclusion
DS2C propose un pont entre psychocriminologie et psychanalyse, entre approche actuarielle et lecture clinique. Elle refuse le cloisonnement disciplinaire pour construire une méthode intégrative qui articule rigueur empirique et profondeur psychodynamique.
Cette double lecture permet d'évaluer les risques (facteurs développementaux quantifiables) tout en accédant au sens (dynamique psychique singulière). Elle évite le double écueil du réductionnisme scientiste (tout expliquer par des corrélations statistiques) et de l'herméneutique pure (tout expliquer par l'inconscient sans validation empirique).
DS2C s'adresse aux cliniciens confrontés à l'analyse du passage à l'acte : psychologues, psychiatres, experts judiciaires, professionnels de la protection. Elle se veut un outil opérationnel, rigoureux, mais humble dans ses prétentions. Le dialogue interdisciplinaire reste ouvert : DS2C n'a pas vocation à être un système clos, mais une méthode évolutive, enrichie par les apports de la recherche et de la pratique clinique.
La semaine prochaine, j'aborderai un cas concret...
Frantz BAGOE
Psychologue comportementaliste
Créateur de la méthode DS2C

Le meurtre en série : accident darwinien ou vestige adaptatif ?
Le 15/11/2025
Le meurtre en série : accident darwinien ou vestige adaptatif ?
La question que personne ne pose
Les criminologues classent, les psychiatres diagnostiquent, les neuroscientifiques scannent. Mais personne ne pose la question fondamentale : pourquoi cette capacité existe-t-elle dans le répertoire comportemental humain ?
La sélection naturelle est impitoyablement économe. Elle ne conserve pas de traits coûteux sans raison. Or le meurtre en série est manifestement contre-adaptatif : il expose à la capture, l'exécution, l'ostracisation totale, et compromet radicalement la reproduction. Un tueur en série capturé transmet zéro gène. Échec darwinien absolu.
Alors pourquoi ce comportement persiste-t-il, certes rare (environ 1 pour 2 millions d'individus), mais universel dans toutes les cultures humaines documentées ? Quatre hypothèses méritent examen.
Hypothèse 1 : Le byproduct pathologique
Mécanismes adaptatifs détournés
Le meurtre en série pourrait être un effet secondaire non sélectionné de traits qui, eux, furent adaptatifs :
- L'agressivité mâle compétitive
Dans l'Environnement d'Adaptation Évolutive (EAE), l'agressivité masculine était cruciale pour :
-
- La compétition intrasexuelle (accès aux femelles)
- La défense du territoire
- La prédation
- La protection du groupe
Cette agressivité est régulée par des mécanismes neurologiques précis : cortex préfrontal ventromédian (inhibition), amygdale (détection de menace), système sérotoninergique (modulation de l'impulsivité). Chez certains individus, ces régulateurs dysfonctionnent.
Neurobiologie des tueurs en série documentée :
-
- Hypométabolisme préfrontal (Raine et al., 1997)
- Réactivité amygdalienne aberrante
- Déficit d'empathie cognitive (théorie de l'esprit intacte) mais absence d'empathie affective (résonance émotionnelle)
- Polymorphisme MAO-A (gène warrior) combiné à maltraitance infantile = facteur de risque massif
- Analogie évolutionniste : l'agressivité est comme un thermostat. Réglée normalement, elle permet compétition et survie. Déréglée (combinaison génétique + environnement développemental toxique), elle produit des déviations extrêmes.
Le tueur en série serait donc un accident de régulation : le système a été construit pour une chose (compétition calibrée) mais peut, dans des conditions pathologiques, produire autre chose (prédation conspécifique).
La capacité prédatrice généralisée
Homo sapiens est un super-prédateur. Nous avons exterminé la mégafaune quaternaire, colonisé tous les continents, développé des stratégies de chasse sophistiquées (traque, embuscade, mise à mort efficace).
Cette machinerie cognitive de prédation inclut :
- Capacité à planifier sur le long terme
- Objectification de la proie (déshumanisation nécessaire)
- Insensibilité à la souffrance de la cible
- Plaisir lié à la capture réussie (récompense dopaminergique)
Normalement, cette machinerie est inhibée envers les conspécifiques par des mécanismes puissants :
- Reconnaissance des signaux de détresse (pleurs, supplications)
- Empathie affective
- Normes sociales internalisées
- Peur de la réciprocité (vengeance du groupe)
Chez le tueur en série, ces inhibiteurs sont défaillants. La machinerie prédatrice, intacte, se retourne vers des humains. Les victimes deviennent des proies. La chasse procure la même satisfaction neurochimique que la traque d'un cerf pour un chasseur-cueilleur.
Conclusion partielle : le meurtre en série n'a jamais été sélectionné positivement. C'est un bug, pas une feature. Un dérapage de systèmes conçus pour autre chose.
Hypothèse 2 : Stratégie reproductive déviante (dark triad maximisée)
Le continuum des stratégies sexuelles
La psychologie évolutionniste distingue deux grandes stratégies reproductives :
Stratégie K : investissement parental élevé, partenaires stables, peu de descendants, soins prolongés. Stratégie dominante chez Homo sapiens.
Stratégie r : maximisation du nombre d'accouplements, investissement minimal, nombreux descendants, pas de soins. Rare chez les humains mais présente dans certaines sous-populations.
Entre les deux, un continuum de stratégies mixtes. À l'extrémité pathologique de la stratégie r, on trouve la coercition sexuelle : viol, violence, manipulation.
- Le tueur en série comme stratège r déviant
Certains tueurs en série (sous-type lust principalement) présentent un profil troublant :
- Nombre élevé de victimes (tentatives "reproductives" avortées)
- Violence sexuelle systématique
- Objectification totale de la victime (partenaire réduit à support physiologique)
- Absence d'attachement, de relation, de réciprocité
- Compulsion répétitive (incapacité à satiation)
Interprétation évolutionniste hérétique : et si c'était une stratégie r pathologiquement désinhibée ? Le viol comme tentative de transmission génétique par coercition est documenté chez plusieurs espèces. Chez les humains, c'est une stratégie ultra-minoritaire, réprimée violemment, mais elle existe.
Le tueur en série sexuel serait alors un individu :
- À très faible statut social (accès nul aux partenaires par voie normale)
- Incapable de compétition intrasexuelle conventionnelle
- Privé de toute ressource attractive (ressources matérielles, statut, charisme)
- Dont les inhibiteurs neurologiques/sociaux ont échoué
- Qui bascule dans la coercition extrême comme dernière "tentative" reproductive
Évidemment, le meurtre sabote cette "stratégie" : une victime morte ne transmet rien. Mais le système motivationnel sous-jacent pourrait être une version détraquée du mating effort (effort d'accouplement).
- Dark Triad et fitness reproductive
Les traits de personnalité Dark Triad (narcissisme, machiavélisme, psychopathie) sont faiblement mais positivement corrélés avec le succès reproductif à court terme dans certaines études (Jonason et al., 2009).
Pourquoi ? Parce qu'ils favorisent :
- Manipulation sociale efficace
- Extraction de ressources
- Multiplication des partenaires sexuels
- Désengagement rapide (pas d'investissement parental)
Mais : au-delà d'un certain seuil, ces traits deviennent contre-productifs. La psychopathie complète (comme chez les tueurs en série) entraîne incarcération ou mort violente. C'est le principe de l'inverted U-curve : un peu de machiavélisme peut être adaptatif, trop est désastreux.
Le tueur en série serait situé au-delà du seuil viable sur ce continuum. Un Dark Triad poussé si loin qu'il s'auto-détruit.
Objection majeure : cette "stratégie" ne fonctionne pas. Les tueurs en série ont une fitness reproductive proche de zéro. Donc ce n'est PAS une adaptation, plutôt un misfiring d'un système de coercition sexuelle qui, à dose modérée, a pu être marginalement efficace dans certains contextes ancestraux (guerre, raids, contextes d'effondrement social).
Hypothèse 3 : Inadaptation environnementale (mismatch évolutionniste)
Le cerveau paléolithique dans la modernité
Notre neurobiologie s'est forgée pendant 2 millions d'années de vie en petits groupes de chasseurs-cueilleurs (50-150 individus). Les pressions de sélection de cette époque ont sculpté nos circuits comportementaux.
Mécanismes régulateurs ancestraux du meurtre conspécifique :
1. Visibilité totale : dans un groupe de 80 personnes, impossible de cacher un meurtre. Détection immédiate.
2. Ostracisation rapide : un individu dangereux était expulsé ou exécuté. Pas de prison, pas de procédure. Justice tribale immédiate.
3. Coût de réputation : tuer un membre du groupe détruisait instantanément le capital social de l'agresseur, compromettant ses chances reproductives.
4. Vengeance de sang : la famille de la victime vengeait le mort. Dissuasion puissante.
5. Rareté de l'anonymat : tout le monde connaît tout le monde. Pas de victimes "étrangères" disponibles.
Ces mécanismes ne fonctionnent plus dans les sociétés modernes :
- Anonymat urbain : possibilité de cibler des inconnus, de se déplacer sans être reconnu.
- Délai de justice : entre le crime et la sanction (si elle arrive), des années peuvent passer.
- Absence de régulation tribale : personne ne vous expulse immédiatement du groupe social.
- Mobilité géographique : possibilité de fuir, de changer de territoire.
- Densité de population : réservoir quasi-illimité de victimes potentielles.
Le meurtre en série est un phénomène moderne (première documentation au 19e siècle, explosion au 20ème). Pourquoi ? Parce que les conditions environnementales qui le rendaient impossible ancestralement ont disparu.
L'hypothèse du mismatch toxique
Le tueur en série serait un individu dont :
1. La régulation neurobiologique de l'agressivité est défaillante (génétique + trauma développemental)
2. Cette défaillance aurait été neutralisée dans l'Environnement d’Adaptation Evolutive (contexte écologique et social ancestral) par les mécanismes sociaux (ostracisation immédiate, exécution)
3. Mais dans l'environnement moderne, ces freins externes n'existent plus
4. L'individu pathologique peut donc exprimer pleinement sa dysfonction sans régulation sociale efficace
Analogie : une voiture sans freins sur terrain plat (EAE) ne cause pas d'accident. La même voiture sur autoroute (modernité) est mortelle.
Le meurtre en série ne serait donc pas une adaptation mais une pathologie rendue possible par l'inadéquation entre notre cerveau archaïque et notre environnement récent.
Cela expliquerait :
- Sa rareté (la pathologie de base reste rare)
- Son émergence moderne (l'environnement permissif est récent)
- Sa présence transculturelle (toutes les sociétés modernes présentent ce mismatch)
Hypothèse 4 : Pathologie du statut et monopolisation reproductive
Compétition intrasexuelle et hiérarchie
Chez les primates sociaux, que nous sommes, l'accès à la reproduction est inégalement distribué. Les mâles de haut rang monopolisent l'accès aux femelles. Les mâles de bas rang ont une fitness reproductive drastiquement réduite.
Mécanismes adaptatifs pour les mâles de bas rang :
- Tentatives furtives d'accouplement
- Formation de coalitions pour renverser le dominant
- Migration vers un autre groupe
- Attente patiente d'une opportunité
Mais : que se passe-t-il quand ces stratégies alternatives échouent toutes ? Quand un mâle se trouve dans une impasse reproductive totale ?
- Le désespoir reproductif
Données troublantes chez les tueurs en série :
- Majorité écrasante de mâles (>90%)
- Faible attractivité (physique, sociale, économique)
- Échecs répétés dans les relations amoureuses/sexuelles
- Sentiment d'humiliation, d'invisibilité sociale
- Rage narcissique contre les femmes (représentantes du rejet)
Mécanisme hypothétique :
1. L'individu perçoit (souvent correctement) qu'il est exclu de la compétition reproductive normale.
2. Son système motivationnel reproductif (dopaminergique, testostérone-dépendant) reste actif, créant une frustration massive.
3. Les circuits de dominance masculine, incapables de s'exprimer normalement, se déforment.
4. La violence devient un substitut pathologique à l'expression de la dominance sexuelle.
5. Le meurtre en série représente une tentative démente de réaffirmer une puissance qui n'existe pas socialement.
Les victimes sont souvent :
- Des femmes jeunes, sexuellement attractives (représentantes de ce qui est inaccessible)
- Des personnes socialement vulnérables : dominance possible
Interprétation darwinienne brutale : le tueur en série est un perdant génétique (faible fitness) qui exprime sa rage d'exclusion par la seule forme de domination qui lui reste accessible : la destruction.
Ce n'est PAS une stratégie adaptative (elle ne transmet aucun gène). C'est une réaction pathologique à l'échec adaptatif. Un court-circuit motivationnel.
- Comparaison inter-espèces
Chez certaines espèces, les mâles exclus de la reproduction présentent des comportements aberrants :
- Infanticide chez les lions (tuer les petits du mâle dominant)
- Violence contre les femelles chez les orangs-outans
- Auto-destruction chez certains rongeurs (syndrome du "behavioral sink")
Le meurtre en série humain pourrait être notre version de ce désespoir biologique : quand l'impératif reproductif rencontre une impossibilité structurelle, le système se détraque.
Synthèse : un faisceau de dysfonctions convergentes
Aucune de ces quatre hypothèses ne suffit seule. La réalité est probablement un enchevêtrement :
Niveau 1 : Substrat neurobiologique
- Dysfonction préfrontale (inhibition défaillante)
- Hypersensibilité aux signaux de menace/humiliation
- Déficit d'empathie affective
- Système de récompense déréglé (dopamine)
Niveau 2 : Développement pathologique
- Trauma précoce (majorité des tueurs en série ont subi maltraitance/négligence)
- Échec d'attachement sécure
- Construction d'une personnalité psychopathique ou limite
- Fantasmatique sadique progressivement renforcée
Niveau 3 : Positionnement social
- Échec de compétition intrasexuelle
- Exclusion reproductive
- Statut social très faible
- Rage narcissique
Niveau 4 : Contexte environnemental
- Anonymat urbain
- Disparition des mécanismes régulateurs tribaux
- Disponibilité de victimes isolées
- Délai de justice
Le meurtre en série émerge quand ces quatre niveaux s'alignent : un cerveau dysfonctionnel, un développement catastrophique, une exclusion sociale/reproductive, dans un environnement qui ne régule plus.
Conclusion : le monstre comme révélateur
Le tueur en série n'est pas un alien. C'est un extrême pathologique de processus qui existent en chacun de nous :
- Capacité d'agression
- Compétition pour les ressources reproductives
- Objectification temporaire d'autrui
- Fantasmes de dominance
Chez la plupart, ces processus sont régulés par :
- Neurobiologie fonctionnelle
- Socialisation réussie
- Empathie affective
- Coût social dissuasif
- Alternatives adaptatives disponibles
Chez le tueur en série, tous les régulateurs ont échoué simultanément. Ce n'est pas une espèce à part, c'est nous-mêmes quand tous les fusibles ont sauté.
La leçon darwinienne : l'évolution ne produit pas de solutions parfaites, seulement des compromis viables. Le meurtre en série est le prix statistique que notre espèce paie pour avoir des systèmes d'agressivité, de compétition reproductive, et de prédation.
Ces systèmes sont globalement adaptatifs. Mais dans une infime minorité de cas (combinaison génétique malheureuse + environnement développemental toxique + contexte social pathogène + modernité anomique), ils produisent des monstres.
Le monstre ne vient pas d'ailleurs. Il est l'ombre portée de notre propre architecture évolutive.
Darwin nous enseigne que rien en biologie n'a de sens sauf à la lumière de l'évolution. Le meurtre en série n'échappe pas à cette règle : c'est un accident darwinien, pas un dessein, mais un accident profondément révélateur de ce que nous sommes.
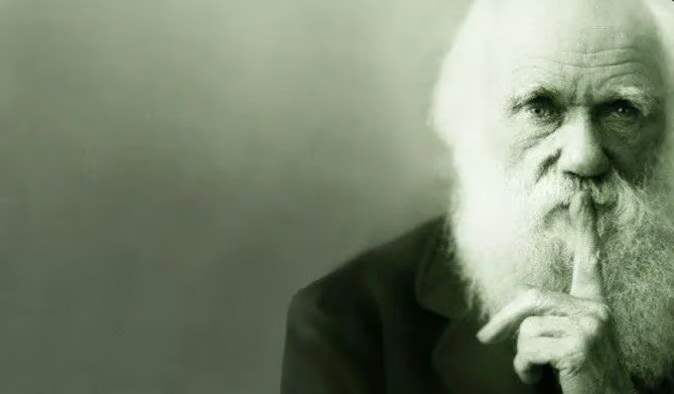
Taxonomie des tueurs en série
Le 08/11/2025
Echec épistémologique d'un champ athéorique
Le fantasme classificatoire
La criminologie moderne, particulièrement anglo-saxonne, s'est évertuée depuis quarante ans à catégoriser les tueurs en série avec l'espoir naïf qu'une bonne taxonomie révélerait la nature profonde du phénomène.
Trois approches dominent : Holmes & DeBurger (1988), David Canter (années 1990), et la position évolutive du FBI. Chacune échoue différemment, et cet échec nous renseigne davantage sur les limites de la pensée classificatoire que sur l'objet étudié.
Holmes & DeBurger : la tentation phénoménologique
Ronald Holmes et James DeBurger proposent en 1988 une typologie quadripartite basée sur la « motivation inférée du tueur :
- Le Visionnaire tue sous l'impulsion de voix, d'hallucinations, d'injonctions divines ou démoniaques. Break psychotique patent, structure délirantielle. Désorganisation comportementale majeure.
- Le Missionnaire possède une pseudo-rationalité : éliminer les prostituées, les homosexuels, les "parasites sociaux". Pas de psychose, mais rigidité idéologique extrême. L'acte est "nécessaire", pas jouissif.
- L'Hédoniste tue pour le plaisir, subdivisé en trois sous-types :
- Lust : gratification sexuelle directe
- Thrill : excitation, frisson, chasse
- Comfort : gain matériel (assurances, héritages)
- Le Dominateur cherche le contrôle absolu sur sa victime. Torture prolongée, humiliation, réduction à l'objet. La mort n'est que l'aboutissement regrettable de la domination totale.
Critique structurale
Ce modèle souffre d'un vice circulaire fondamental : on infère la motivation du comportement observé, puis on classe selon cette motivation inférée. Le raisonnement se mord la queue. Comment distinguer empiriquement un hédoniste-thrill d'un dominateur ? Les deux torturent, les deux prolongent, les deux jouissent du contrôle.
L'échantillon (110 cas environ) ne permet aucune validation statistique robuste. Plus grave : les catégories se chevauchent constamment. Un dominateur EST nécessairement hédoniste. Un missionnaire peut éprouver du thrill. La typologie ne découpe pas le réel, elle le quadrille arbitrairement.
Biais rétrospectif massif
Connaissant l'issue et les déclarations post-capture, on "trouve" facilement la motivation. Mais ce modèle n'a aucun pouvoir prédictif prospectif. C'est de l'herméneutique criminologique déguisée en science.
Plasticité ignorée
Un même individu peut passer d'un registre à l'autre selon les opportunités, l'évolution de sa pathologie, les contingences situationnelles. BTK était missionnaire au début (éliminer des familles "idéales" par jalousie), hédoniste-lust ensuite, dominateur toujours. Quelle est sa "vraie" catégorie ?
Intérêt résiduel
Utile comme heuristique grossière pour initier une réflexion, rien de plus. En pédagogie, peut-être. En investigation, dangereux : risque de biais de confirmation ("il doit être visionnaire, cherchons des signes de psychose").
David Canter : le behaviorisme statistique
David Canter, psychologue environnemental britannique, adopte une approche radicalement différente dans les années 1990. Pas de spéculation motivationnelle. Uniquement des variables comportementales observables, analysées statistiquement sur 100 tueurs britanniques via Smallest Space Analysis (analyse multidimensionnelle).
Les dimensions canteriennes
Canter refuse les types discrets. Il propose des continuums :
- Dimension 1 : Expressif vs Instrumental
- Expressif : violence excessive, mutilations, rage manifeste, désorganisation émotionnelle, overkill, acharnement post-mortem. Le crime exprime un affect débordant.
- Instrumental : violence minimale nécessaire, planification, froideur, dissimulation du corps, nettoyage de la scène. Le crime est un moyen, pas une fin émotionnelle.
- Dimension 2 : Conservateur vs Explorateur (cognitive)
- Conservateur : zone géographique restreinte, routines rigides, victimes du voisinage, territorialité, faible mobilité.
- Explorateur : mobilité élevée, adaptation, nouveaux territoires, victimes éloignées du domicile, flexibilité opportuniste.
Ces dimensions sont « orthogonales » : on peut être expressif-conservateur (rage locale) ou instrumental-explorateur (tueur itinérant froid).
Forces méthodologiques
Empirisme rigoureux. Données observables, reproductibles, mesurables. Pas d'inférence psychologique hasardeuse. Le modèle est prédictif pour le Geographic Profiling : un conservateur-expressif opérera probablement près de chez lui dans un rayon de 2-3 km.
Compatible avec une épistémologie behavioriste stricte : si on ne peut pas l'observer sur la scène de crime, on ne le modélise pas.
Limites épistémologiques
- Réductionnisme statistique : la singularité du cas disparaît dans les moyennes. Un tueur n'est jamais réductible à ses coordonnées sur deux axes.
- Athéorique : Canter décrit des patterns sans les expliquer. POURQUOI existe-t-il des expressifs et des instrumentaux ? Quelle étiologie développementale ? Quelle économie pulsionnelle ? Silence total.
- Culturellement situé : échantillon britannique, contexte légal et social spécifique. La généralisation aux USA ou ailleurs reste douteuse.
En termes Le-Senniens, Canter cherche les "caractères" (au sens caractérologie) mais sans théorie de la personnalité. C'est de la cartographie sans géologie. On sait où sont les montagnes, pas pourquoi elles sont là.
Le FBI : de l'enthousiasme typologique au pragmatisme radical
Phase 1 (1970s-80s) : l'âge d'or des profilers
Robert Ressler, John Douglas, Roy Hazelwood du Behavioral Science Unit lancent le Criminal Personality Research Project. Ils interviewent 36 tueurs en série (Bundy, Kemper, Gacy...) et forgent la dichotomie célèbre :
- Organisé : QI élevé, planification, contrôle de la scène, dissimulation du corps, socialement compétent, suit l'affaire dans les médias.
- Désorganisé : QI faible, impulsif, scène chaotique, corps abandonné, isolement social, pas de suivi médiatique.
Opérationnel, médiatique, séduisant. Adopté massivement par les départements de police. Un succès de communication criminologique.
Phase 2 (1990s) : la critique empirique
David Canter démontre que 75% des scènes de crime présentent des éléments des DEUX catégories. La dichotomie ne reflète pas un "type" de tueur mais plutôt :
- L'évolution dans la série (début désorganisé, apprentissage, devenir organisé)
- Les variations situationnelles (victime résiste = désorganisation)
- La séquence temporelle (planification organisée, exécution émotionnelle désorganisée)
Exemple paradigmatique : BTK (Dennis Rader). Planification obsessionnelle (organisé), mais lors du passage à l'acte, perte de contrôle émotionnelle, jouissance prolongée, désordre (désorganisé). Quelle est sa "vraie" nature ?
La dichotomie est un artefact classificatoire qui simplifie abusivement une réalité continue et contextuelle.
Phase 3 (2005-aujourd'hui) : l'abandon des typologies
En 2005, Robert Morton et Mark Hilts publient pour le FBI un rapport sévère : les typologies sont "artificielles et contre-productives". Position officielle actuelle du BAU (Behavioral Analysis Unit) :
- Principes directeurs
- Refus des catégories a priori. Chaque cas est analysé inductivement, sans grille préétablie.
- Focus sur les comportements observables uniquement :
- Modus operandi (MO) : techniques utilisées, évoluent avec l'expérience
- Signature : éléments psychologiquement nécessaires, stables, liés à la gratification
- Contrôle de la victime (verbal, physique, chimique)
- Niveau de risque pris
- Temps passé sur la scène
- Comportement post-offense
- Pas de profil psychologique spéculatif. Trop aléatoire, juridiquement fragile, scientifiquement invérifiable.
- Pragmatisme investigatif : ce qui n'aide pas à identifier ou capturer le suspect est écarté.
Lecture Watzlawickienne : les typologies créent ce qu'elles décrivent
Le FBI a compris, probablement sans le conceptualiser ainsi, un principe constructiviste fondamental : les classifications ne décrivent pas une réalité préexistante, elles la construisent.
- Effets circulaires observés
- Les interrogatoires biaisés ("Vous êtes organisé, n'est-ce pas ?") obtiennent des réponses conformes.
- Les médias reproduisent les catégories, créant des scripts culturels.
- Les criminels eux-mêmes se catégorisent, adoptent l'identité proposée, agissent en conséquence (effet copycat raffiné).
- Les enquêteurs cherchent des indices confirmant leur hypothèse typologique initiale (biais de confirmation).
- La prophétie autoréalisatrice en action. Les tueurs "organisés" existent parce qu'on a inventé cette catégorie et qu'elle circule dans l'imaginaire collectif.
- Le FBI a fait son épistémologie pragmatique à la Peirce : si ça n'a pas d'effet pratique différentiel, c'est une distinction vide. Et les typologies n'en avaient plus.
Constat d'échec : l'absence criante de théorie
Ces trois approches partagent un vide théorique abyssal concernant :
- L'étiologie développementale : Que s'est-il passé dans l'enfance, l'adolescence ? Quelle trajectoire d'attachement ? Quels traumas séquentiels ? Quelle construction de la mentalisation ? Bergeret aurait des choses à dire sur les états-limites et les structures psychotiques, mais personne ne l'invite dans ce champ.
- La neurobiologie : Anomalies préfrontales, dysrégulation sérotoninergique, hypersensibilité amygdalienne, déficit d'empathie cognitive vs affective. Données massives ignorées.
- L'économie pulsionnelle : Quel rapport à la pulsion de mort ? Quelle défaillance du Surmoi ? Quelle jouissance spécifique ? Le meurtre en série n'est pas un comportement, c'est une solution psychique à une problématique interne. Personne ne le traite comme tel.
- La fonction adaptative darwinienne : pourquoi ce répertoire comportemental existe-t-il dans l'espèce humaine ? Quelle pression de sélection, quelle niche écologique, quelle stratégie reproductive aberrante ?
On cartographie des surfaces sans explorer les profondeurs. C'est de la criminologie plate.
Vers une approche intégrative
Les taxonomies ont échoué parce qu'elles confondent « description » et « explication ». Holmes & DeBurger spéculent sans rigueur. Canter mesure sans théoriser. Le FBI observe sans interpréter.
Une approche authentiquement scientifique devrait :
1. Ancrer l'analyse dans une théorie développementale robuste (attachement, trauma, construction de la personnalité).
2. Intégrer les données neurobiologiques disponibles, sans réductionnisme.
3. Penser la fonction adaptative du comportement, même aberrant, dans une perspective évolutionniste.
4. Reconnaître la construction sociale du phénomène (Watzlawick) sans tomber dans le relativisme.
5. Accepter la singularité irréductible de chaque cas, tout en cherchant des patterns généralisables.
Ce champ reste un désert théorique. Les tueurs en série continuent d'être traités comme des curiosités à classer plutôt que comme des révélateurs de processus psychopathologiques fondamentaux.
Le prochain article abordera précisément ce qui manque : l'angle darwinien. Pourquoi l'évolution a-t-elle permis qu'existe dans le répertoire comportemental humain cette capacité au meurtre en série ? Quelle est sa fonction, son coût, sa niche écologique ? Qu'est-ce que cela révèle de notre espèce ?
Sources :
Holmes, R. M., & DeBurger, J. (1988). Serial Murder. Sage Publications.
Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Douglas, J. E. (1988). Sexual Homicide: Patterns and Motives. Lexington Books.
Canter, D., & Wentink, N. (2004). "An empirical test of Holmes and Holmes's serial murder typology". Criminal Justice and Behavior, 31(4), 489-515.
Canter, D. (1994). Criminal Shadows. HarperCollins. (Vulgarisation de ses travaux)
Canter, D., & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology : Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Wiley.
Morton, R. J., & Hilts, M. A. (Eds.). (2005). Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators. Behavioral Analysis Unit, FBI.
Raine, A., Buchsbaum, M., & LaCasse, L. (1997). "Brain abnormalities in murderers indicated by positron emission tomography". Biological Psychiatry, 42(6), 495-508.
Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence : The Biological Roots of Crime. Pantheon. (Synthèse accessible)
Cleckley, H. (1941). The Mask of Sanity. Mosby.
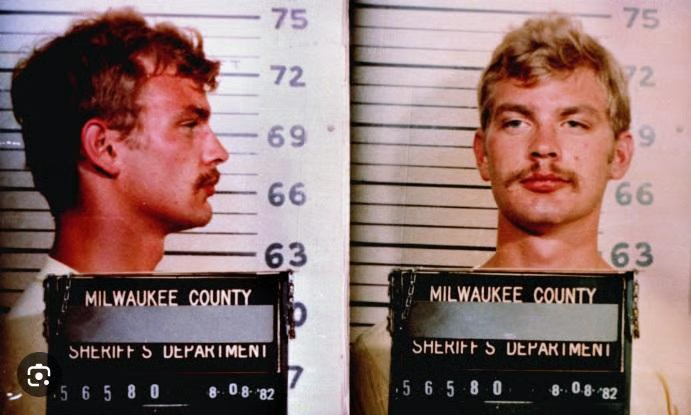
L'Amour à tout prix ?
Le 01/11/2025
Anatomie de l'idéalisation narcissique pathologique
Quand l'amour devient tyrannie
« Je ne peux pas vivre sans toi. » Cette phrase, qui semble exprimer l'intensité d'un sentiment amoureux, révèle parfois une tout autre réalité : celle d'une dépendance narcissique où l'autre n'existe que comme prothèse psychique. L'idéalisation pathologique de l'objet n'est pas l'amour — c'est son ersatz, sa contrefaçon économique. Elle procède d'une confusion fondamentale : ce que le sujet prend pour de l'amour n'est qu'un investissement massif visant à combler une béance narcissique primitive.
Cette dynamique, que Freud identifiait dès 1914 dans « Pour introduire le narcissisme », pose une question centrale : comment distinguer l'investissement libidinal d'objet authentique de sa version pathologique, où l'autre devient le réceptacle projeté de ce que le sujet ne peut tolérer en lui-même ? L'idéalisation narcissique pathologique n'est pas un excès d'amour — c'est son impossibilité.
Genèse structurale : Les racines du mirage
Le narcissisme primaire et ses avatars
Pour comprendre l'idéalisation pathologique, il faut remonter à l'économie narcissique primitive. Le narcissisme primaire, état mythique de complétude originaire, reste un fantasme organisateur pour tout sujet. Mais chez certains, la blessure narcissique précoce — liée à une carence d'investissement maternel suffisamment bon, pour parler comme Winnicott, ou à une défaillance des fonctions pare-excitantes — laisse une cicatrice béante.
Le processus normal dans des circonstances optimales de l’enfance se déroule de la façon suivante : l’enfant éprouve peu à peu une déception devant l’objet idéalisé (qui est le parent idéalisé) à mesure que l’évaluation qu’il en fait devient plus réaliste. L’enfant se rend compte des failles du parent. Il se produit alors un retrait des investissements narcissiques envers ce parent idéalisé et leur intériorisation se fait progressivement pour mener à l’acquisition de structures psychologiques permanentes qui continuent, à l’intérieur de soi, les fonctions auparavant exercées par le fameux parent idéalisé.
Mais cette intériorisation n’aura pas lieu si la perte de l’objet (le parent idéalisé) a été traumatique. L’enfant n’acquiert pas la structure interne nécessaire et son psychisme reste fixé à cette étape traumatique et tout au long de sa vie, son psychisme sera dépendant d’autres personnes (idéalisées a priori) en tant que substituts des fragments absents du parent idéalisé disparu.
Bergeret décrit avec précision comment cette faille précoce empêche la constitution d'un Moi suffisamment solide. Le sujet reste alors fixé à une économie narcissique archaïque, où la différenciation Moi/non-Moi demeure fragile. L'autre n'est pas reconnu dans son altérité : il n'existe que comme prolongement fantasmé du Moi, support d'une projection massive.
L'échec de la triangulation œdipienne
L'Œdipe, lorsqu'il est traversé pathologiquement, laisse le sujet captif d'une relation duelle fusionnelle. La fonction paternelle — qui devrait opérer la séparation d'avec l'objet primaire et introduire la castration symbolique — échoue à s'installer. Le tiers manque, l’altérité manque. L’enfant cherche désespérément dans chaque relation à reconstituer cette unité perdue.
Cette fixation explique pourquoi il y a « idéalisation pathologique ». La jalousie y est délirante, car tout tiers est vécu comme menace vitale : il vient rappeler la séparation insupportable.
La défaillance des identifications structurantes
Le Senne nous rappelle que le caractère se forge dans la durée, par sédimentation d'expériences relationnelles. Or, chez le sujet à idéalisation pathologique, les identifications primaires sont défaillantes ou conflictuelles. Soit le modèle parental était lui-même trop fragile narcissiquement pour offrir un support identificatoire solide, soit les images parentales étaient clivées (toute-bonne/toute-mauvaise), empêchant l'intégration d'une représentation nuancée de l'autre.
Cette carence identificatoire laisse le Moi appauvri, contraint de chercher à l'extérieur ce qu'il ne peut générer en lui-même : une cohérence, une valeur, une consistance. D'où la nécessité vitale de l'autre idéalisé, qui vient compenser ce déficit structural.
« Comme toute la perfection et la puissance résident maintenant dans l’objet idéalisé, l’enfant se sent vide et impuissant quand il en est séparé, aussi tente-t-il de maintenir avec cet objet une union continue. » (« Le Soi », Heinz Kohut, puf 1971).
Mécanismes de fonctionnement : L'économie du mirage
Le choix d'objet narcissique
Freud distingue deux types de choix d'objet (une personne) : le choix par étayage (la personne choisie ressemble aux figures protectrices de l'enfance) et le choix narcissique (la personne représente ce que le sujet est, a été, voudrait être ou une partie de lui-même). Dans l'idéalisation pathologique, le choix est exclusivement narcissique : l'autre n'est choisi que pour ce qu'il représente fantasmatiquement.
La personne idéalisée incarne le Moi idéal archaïque — cette image grandiose de complétude que le sujet ne peut maintenir seul. Il porte la projection massive de toutes les qualités que le sujet s'est vu contraint de renoncer sous la pression de la réalité et du Surmoi. L'autre devient littéralement le dépositaire du narcissisme perdu.
La projection et l'identification projective
Le mécanisme central de l'idéalisation pathologique est la projection massive. Le sujet projette sur l'objet ses propres qualités fantasmées, ses aspirations inaccessibles, sa puissance imaginaire. Mais cette projection n'est pas une simple attribution externe : elle s'accompagne d'une identification projective, où le sujet tente de contrôler l'autre de l'intérieur, de le forcer à incarner réellement ce qui est projeté sur lui.
Watzlawick et l'école de Palo Alto nous aideraient ici à comprendre la dimension interactionnelle : le sujet envoie des messages paradoxaux (« sois ce que je projette sur toi, mais ne change pas »), créant un double bind qui rend l'autre captif d'une assignation impossible. La communication devient pathologique, circulaire, autoconfirmatrice.
Le déni de la réalité et le clivage
Pour maintenir l'idéalisation, le sujet doit dénier toute information contradictoire. Le clivage opère massivement : la personne est soit totalement bonne (idéalisée), soit totalement mauvaise (persécutrice). Pas de nuances. Cette économie psychotique du clivage révèle la fragilité de l'organisation défensive.
Le réel est constamment dénié au profit de la construction fantasmatique. Chaque indice qui viendrait contredire l'image idéale est soit scotomisé (nié parce qu’intolérable), soit rationalisé, soit projeté ailleurs (« c'est moi qui ne le comprends pas assez bien »). Cette distorsion systématique de la perception maintient le mirage au prix d'une dépense énergétique considérable.
L'économie libidinale : tout ou rien
L'investissement libidinal dans l'idéalisation pathologique est massif, exclusif, totalitaire. Le sujet désinvestit toute autre personne, tout autre intérêt, toute autre source de satisfaction narcissique. C'est une économie du « tout ou rien », sans régulation possible. La libido est captive, figée sur cet objet unique.
Cette économie est intrinsèquement instable. Elle ne peut se maintenir qu'au prix d'un effort constant de déni, de contrôle, de surinvestissement. Elle épuise les ressources psychiques du sujet, qui vit dans l'angoisse permanente de perdre cet objet dont il dépend vitalement.
Le cycle addiction/désillusion
Comme Darwin nous le rappellerait, les comportements se répètent s'ils ont une fonction adaptative — même pathologique. L'idéalisation fonctionne sur un mode addictif : elle procure une jouissance immédiate (comblement fantasmatique de la béance narcissique), suivie inévitablement d'une chute (confrontation au réel de l'objet, qui ne peut incarner indéfiniment la projection).
Cette alternance génère un cycle infernal : idéalisation → surinvestissement → désillusion → dévalorisation (parfois haine) → nouvelle quête d'un objet idéal. Le sujet passe d'une relation à l'autre, reproduisant le même scénario, sans jamais interroger la structure qui le sous-tend. La répétition est ici au service du déni : chaque nouvel objet est censé être « le bon », celui qui enfin comblera la faille.
Manifestations cliniques : Les visages du mirage
Le tableau de la dépendance affective
Cliniquement, l'idéalisation pathologique se présente souvent sous le masque de la « dépendance affective ». Le sujet rapporte une impossibilité de vivre sans l'autre, des angoisses d'abandon massives, une jalousie envahissante, des comportements de contrôle et de surveillance. Il décrit son partenaire en termes hyperboliques, niant systématiquement ses défauts ou les minimisant.
Le discours révèle une confusion identitaire : « sans lui, je ne suis rien », « il est toute ma vie », « je ne sais plus qui je suis quand il n'est pas là ». Le sujet ne se perçoit pas comme entité autonome mais comme fragment d'un tout fantasmatique dont l'autre serait l'autre moitié (mythe de l'androgyne, utilisé défensivement).
Les avatars du masochisme relationnel
L'idéalisation pathologique conduit fréquemment à des configurations masochistes. Le sujet tolère l'intolérable — maltraitance, infidélités répétées, mépris — au nom de l'amour. Mais cette tolérance n'est pas altruiste : elle sert à préserver l'objet idéalisé coûte que coûte, quitte à se détruire soi-même.
Le masochisme ici n'est pas recherche de la souffrance pour elle-même mais conséquence logique d'une économie où la survie psychique est vécue comme dépendante du maintien de l'objet, quel qu'en soit le prix. Le sujet préfère souffrir que renoncer à l'illusion.
La violence du retournement
Lorsque l'idéalisation s'effondre — et elle s'effondre toujours, car aucun être réel ne peut soutenir indéfiniment une projection aussi massive — le renversement est brutal. L'amour se transforme en haine, l'objet idéalisé devient persécuteur, le même qui était « parfait » devient « le pire ».
Cette violence du retournement révèle que l'ambivalence n'avait jamais été intégrée. Le clivage se maintient, seul change le pôle investi. Le sujet oscille entre positions paranoïde (« il me veut du mal, il m'a trompé depuis le début ») et dépressive (« je suis nul, je n'ai rien compris, je mérite cette souffrance »), sans parvenir à une position intermédiaire de reconnaissance de la complexité de l'objet et de soi.
Conséquences : Le coût psychique et relationnel
L'appauvrissement du Moi
L'idéalisation pathologique appauvrit considérablement le Moi. Toute l'énergie psychique étant investie dans le maintien de l'illusion, les autres fonctions du Moi sont négligées : capacité de jugement, pensée autonome, créativité, investissements sociaux et professionnels. Le sujet se vide de sa substance propre au profit d'une existence par procuration.
Cet appauvrissement crée un cercle vicieux : plus le Moi s'appauvrit, plus il dépend de l'objet externe pour se sentir exister, plus l'idéalisation devient nécessaire. La dépendance se renforce au fil du temps, jusqu'à des états de décompensation grave lorsque l'objet fait défection.
L'impossibilité de la rencontre authentique
En figeant l'autre dans un rôle fantasmatique, l'idéalisation empêche toute rencontre véritable. L'autre réel — avec ses désirs propres, ses contradictions, sa finitude — ne peut exister. Il est réduit au statut d'objet partiel, support d'une projection. Cette négation de l'altérité empêche toute relation dialogique, au sens où Watzlawick pourrait l'entendre : il n'y a pas d'ajustement réciproque, pas de négociation, pas de reconnaissance mutuelle.
Le partenaire idéalisé se trouve assigné à une place impossible. Il doit incarner le fantasme du sujet tout en restant « naturel ». Toute tentative d'affirmer sa propre subjectivité est vécue comme trahison, abandon, preuve qu'il n'est « pas le bon ». Cette situation génère chez lui culpabilité, confusion, parfois même effondrement identitaire.
La répétition compulsive et l'échec thérapeutique
L'idéalisation pathologique s'inscrit dans une compulsion de répétition particulièrement résistante. Le sujet répète inlassablement le même scénario relationnel, cherchant dans chaque nouvelle relation à effacer l'échec de la précédente. Mais la structure demeurant inchangée, l'issue est prévisible.
Les risques de décompensation
Lorsque l'objet idéalisé se dérobe définitivement — rupture, décès, révélation de sa « vraie nature » — le risque de décompensation est majeur. Le sujet peut basculer dans des états mélancoliques graves (avec risque suicidaire élevé), des décompensations persécutives (l'objet perdu devient persécuteur), ou des agirs violents (passage à l'acte contre l'objet ou contre soi).
La mélancolie post-idéalisation est particulièrement grave car l'objet perdu emporte avec lui tout ce que le sujet avait projeté de valorisant. Le Moi, déjà appauvri, se retrouve confronté à sa vacuité. Les auto-reproches mélancoliques (« je suis nul, je ne vaux rien ») sont en réalité des reproches adressés à l'objet intériorisé.
Comment sortir du mirage
La confrontation progressive au fantasme
Il est nécessaire de ne pas conforter l'idéalisation. Face à une personne qui décrit son partenaire en termes dithyrambiques, on doit introduire le doute, questionner, pointer les contradictions. Non pour détruire brutalement l'illusion — ce serait traumatique — mais pour ouvrir un espace de questionnement.
Le travail sur les assises narcissiques
Il faut aider la personne à développer des sources de valorisation internes, indépendantes du regard de l'autre. Bergeret insisterait sur la nécessité de consolider le Moi par un étayage analytique patient, permettant au sujet d'intérioriser progressivement des fonctions auparavant externalisées.
Cela passe par la reconnaissance de ses affects, de ses désirs, de ses pensées propres, souvent niés ou confondus avec ceux de l'autre idéalisé.
La tolérance de l'ambivalence
Il est nécessaire que la personne puisse intégrer l'ambivalence. Tout objet est à la fois bon et mauvais, aimable et détestable, satisfaisant et frustrant. Cette réalité, évidente pour un sujet sain, est insupportable pour celui qui fonctionne sur le mode du clivage.
Progressivement, la personne peut apprendre que l'ambivalence n'est pas destruction, que l'on peut aimer quelqu'un tout en voyant ses défauts.
De l'illusion à la rencontre
L'idéalisation narcissique pathologique n'est pas une forme extrême de l'amour — c'est son antithèse. Là où l'amour reconnaît l'altérité et accepte la vulnérabilité, l'idéalisation nie et contrôle. Là où l'amour tolère l'ambivalence, l'idéalisation clive. Là où l'amour accepte le manque, l'idéalisation exige la complétude.
Comprendre cette pathologie exige d'en saisir les racines structurales : faille narcissique primitive, défaut de triangulation œdipienne, identifications défaillantes. Elle impose aussi d'analyser ses mécanismes économiques : choix d'objet narcissique, projection massive, déni du réel, surinvestissement exclusif. Les conséquences sont graves : appauvrissement du Moi, impossibilité de la rencontre, répétition compulsive, risques dépressifs majeurs.
Peut-être faut-il, pour conclure, rappeler cette évidence : on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est lui, avec ses failles et ses contradictions. L'amour véritable commence là où l'idéalisation s'achève — dans la reconnaissance lucide et néanmoins bienveillante de l'altérité irréductible de l'autre.
Ce qui se paie « à tout prix » n'est jamais l'amour — c'est toujours la défense contre son impossibilité.
Lire ses équipes sans se tromper
Le 12/10/2025
Le mythe qui coûte cher
Un collaborateur croise les bras pendant que vous présentez vos chiffres hebdomadaires.
Conclusion rapide instinctive : résistance, fermeture, désaccord. Vous notez mentalement de surveiller ce collaborateur.
Sauf qu'il avait froid. Ou mal au dos. Ou c'est sa position naturelle quand il réfléchit intensément, quand il est à l’écoute.
Ce petit exemple résume le problème : nous interprétons la gestuelle comme si elle était une langue univoque, un dictionnaire où chaque geste = une signification. C'est rassurant. C'est aussi faux et ça coûte cher en décisions RH mal fondées, en relations dégradées, en talents perdus.
Les managers lisent du "body language" comme on lisait jadis les horoscopes : on y voit ce qu'on veut y voir. Et puis on agit dessus.
Cet article propose une approche différente. Une qui s'appuie sur la biologie (Darwin), mais qui refuse le déterminisme simpliste. Une qui reconnaît que la gestuelle communique toujours quelque chose, mais que ce "quelque chose" dépend entièrement du contexte relationnel (Watzlawick).
Le résultat ? Vous lirez mieux vos équipes. Mais surtout, vous arrêterez de mal les interpréter.
Darwin : ce qu'on sait vraiment de nos gestes
Charles Darwin, dans ses observations sur l'expression des émotions, a établi un point crucial : certains gestes et expressions faciales transcendent les frontières culturelles. Un enfant aveugle-né fait la grimace de dégoût sans jamais avoir vu quelqu'un d'autre le faire. La peur produit les mêmes micro-expressions chez un japonais, un brésilien, un suédois.
Pourquoi ? Parce que l'évolution a gravé certains comportements dans notre neurobiologie. Ces gestes servaient à la survie : se faire petit quand on a peur, montrer les dents en agressivité, se détendre quand le danger passe.
Ce que cela signifie pour vous, manager :
Il existe des indicateurs biologiquement fondés de l'état émotionnel. Un collaborateur en stress chronique va présenter des patterns observables : tension dans les épaules, respiration courte, micro-contractions faciales. Ces signaux ne mentent pas, ils reflètent un état physiologique réel.
Un exemple concret : lors d'une réunion difficile, vous remarquez qu'une collaboratrice évite le contact visuel, se tortille dans sa chaise, a les mains crispées. Ce ne sont pas des "mensonges", c'est son système nerveux qui crie. Elle est en détresse, point. C'est factuel. Et vous devez lui demander pourquoi elle est en tension, qu’est-ce qui la perturbe, l’interroge.
Voici le piège : Darwin montre que ces gestes existent et qu'ils reflètent quelque chose de réel. Mais il ne dit pas ce qu'ils signifient exactement. C'est là que les managers se trompent.
Le même évitement du regard peut être : de la peur, de la honte, de la culpabilité, de la concentration, de l'autisme, de la dépression, ou simplement une préférence culturelle (dans certaines cultures, regarder le chef dans les yeux est irrespectueux).
Darwin nous donne les briques. Pas la maison.
Watzlawick : quand le contexte remet tout en question
Paul Watzlawick, en observant les systèmes relationnels, a démontré que la communication n'est jamais une transmission simple d'information. C'est une danse où les deux partenaires créent continuellement le sens, ensemble.
Son premier axiome est implacable : "On ne peut pas ne pas communiquer." Mais cela signifie aussi : on ne peut pas faire de communication hors contexte. Tout geste communique « quelque chose », mais ce « quelque chose » émerge de la situation relationnelle, pas du geste lui-même.
Transposons cela au management.
Le silence en réunion.
Vous posez une question. Un collaborateur reste silencieux. Darwin vous dit : peut-être qu'il réfléchit (respiration calme, posture stable). Ou peut-être qu'il est anxieux (micro-tremblements, regard baissé).
Mais Watzlawick vous pose des questions autrement plus utiles :
- Quelle est sa relation à vous ? Est-ce qu'il a peur de vous ?
- Quel est le contexte ? Y a-t-il déjà eu des représailles contre ceux qui ont parlé ?
- Qui d'autre est dans la salle ? Est-ce qu'il va parler ensuite en privé ?
- Quel est son tempérament ? Certaines personnes pensent à voix haute, d'autres réfléchissent en silence.
Le même silence peut vouloir dire : réflexion profonde, désaccord muet, peur, dépression, introversion, dévalorisation ("mon avis ne compte pas"), ou simplement que la question n'a pas déclenché sa curiosité.
La posture fermée.
Un commercial croise les bras lors d'une confrontation sur ses résultats. Vous pensez : il est sur la défensive, fermé, craint la critique.
Watzlawick demande : qu'avez-vous fait avant qu'il croise les bras ? Lui avez-vous déjà fait des remarques négatives en réunion ? Avez-vous une histoire relationnelle où vous l'avez mis en danger psychologiquement ? Si oui, alors oui, il se ferme—parce que vous avez créé un système où c'est nécessaire.
Mais si c'est son premier jour dans votre équipe et que c'est simplement sa posture naturelle ? Alors vous lisez de l'hostilité là où il n'y a que de la neutralité.
L'engagement apparent.
Une collaboratrice vous regarde droit dans les yeux pendant que vous parlez, opine du chef, prend des notes. Darwin dit : elle est engagée, intéressée. Watzlawick demande : d'où vient ce comportement ? Est-ce qu'elle se sent obligée de faire du spectacle parce que vous êtes son responsable ? Est-ce qu'elle a appris que c'était le comportement attendu pour être inclue au sein de l’équipe ? Ou est-ce qu'elle est réellement intéressée ?
Vous ne pouvez pas le savoir juste en regardant son non-verbal.
Le tempérament change la lecture
René Le Senne a proposé que les individus possèdent des tempéraments constitutifs : sensibilité, réactivité, résonance affective différentes. C'est génétique, c'est stable, et cela influence profondément comment chacun communique non-verbalement.
Un tempérament nerveux (émotif, secondaire chez Le Senne) va gesticuler davantage, parler plus vite, montrer plus de micro-expressions. La même anxiété interne va s'exprimer différemment chez lui que chez un tempérament flegmatique (non-émotif, primaire).
Exemple : Vous avez deux collaborateurs stressés avant une présentation importante.
Le premier (tempérament sanguin/nerveux) : parle vite, se lève et s'assoit, gesticule, change de couleur faciale, demande plusieurs fois si tout va bien.
Le second (tempérament apathique/flegmatique) : parle peu, bouge à peine, expression faciale neutre, semble impassible.
Si vous lisez le non-verbal naïvement, vous pensez : le premier est paniqué, le second est calme. Faux. Tous deux sont stressés. Ils l'expriment juste différemment.
Le manager compétent sait que le même état interne peut produire des gestualités radicalement opposées selon le tempérament. Cela signifie : vous ne pouvez pas utiliser un seul indicateur non-verbal pour conclure quelque chose.
Vous devez construire une baseline pour chaque personne. Comment se comporte-t-elle normalement ? Qu'est-ce qui change quand elle est anxieuse, contente, concentrée ? Puis vous pouvez détecter les écarts.
La relation managériale : un système où le non-verbal s'échange
Watzlawick insiste : dans une relation, les deux parties façonnent continuellement le comportement l'une de l'autre. C'est un système.
En management, cela veut dire : votre gestuelle affecte la gestuelle de votre équipe. Ce n'est pas une voie à sens unique.
Si vous entrez dans une réunion les bras croisés, le sourire crispé, regardant à peine votre équipe, vous créez un système où les gens vont se fermer aussi, parce qu’ils croient eux-aussi que les bras croisés sont un signe de fermeture. Vous n'avez pas lu leur fermeture—vous l'avez créée.
Inversement, si vous vous asseyez ouvert, que vous faites contact visuel, que vous vous penchez légèrement en avant quand quelqu'un parle, signe qui montre que vous vous intéressez, vous installez un système où la communication s'ouvre.
Exemple concret : Un manager remarque que son équipe ne parle jamais en réunion. Il conclut : ils sont passifs, démotivés, désengagés. Il intensifie sa critique. L'équipe se ferme davantage.
Watzlawick dirait : c'est un système. Le manager a créé, sans le savoir, un contexte où parler = danger. Peut-être qu'il interrompt. Peut-être qu'il critique celui qui s'exprime. Peut-être qu'il a l'air pressé. Le non-verbal du manager a configuré le système.
Pour casser le cercle, il faut que le manager change « sa » gestuelle en premier. S'il ralentit, s'il crée du silence confortable après ses questions, s'il hoche la tête quand quelqu'un parle, il invite un nouveau système.
C'est Watzlawick pur : on ne change pas le problème en le critiquant, on le change en transformant le système.
Ce que le manager compétent fait réellement
Armé de cette compréhension, voici comment vous devriez procéder.
- Observez sans juger
Ne confondez pas observation et interprétation. "Il a les épaules tendues" est une observation. "Il est stressé" est une interprétation. "Il est stressé donc il cache quelque chose" est une interprétation sur une interprétation—c'est où les erreurs se reproduisent.
- Cherchez les patterns, pas les gestes isolés
Un geste seul ne signifie rien. Une succession de comportements, sur du temps, signifie quelque chose. Si un collaborateur est toujours tendu, parle moins, évite les réunions collectives, alors oui, il se passe quelque chose. Mais vous devez le vérifier.
- Connaissez la baseline individuelle
Comment se comporte normalement cette personne ? Un introverti va paraître "fermé" comparé à un extraverti. Ce n'est pas qu'il est hostile—c'est sa baseline, son comportement habituel.
- Tenez compte du contexte relationnel
Si vous avez une histoire de confiance avec quelqu'un, vous pouvez interpréter son non-verbal différemment que si vous venez d'être nommé manager. Si la personne vient d'une culture différente, les règles changent.
- Vérifiez verbalement
C'est le point clé : posez des questions. "Je remarque que tu parles moins depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se passe ?" Ne concluez pas, demandez.
Cette simple action transforme l'interprétation en dialogue. Elle crée un système où la communication devient possible.
- Modifiez votre propre gestuelle intentionnellement
Si vous voulez que votre équipe s'ouvre, commencez par vous ouvrir. Votre non-verbal configure le système relationnel. Utilisez-le comme outil de management.
- Acceptez l'ambiguïté
Parfois, vous ne saurez pas ce que signifie réellement un geste. C'est OK. C'est même honnête. "Je ne suis pas sûr de comprendre, explique-moi" est plus utile que de faire des hypothèses.
Les pièges à éviter
- Le biais de confirmation : Vous avez décidé que votre collaborateur est paresseux. Maintenant, chaque geste le confirme à vos yeux. S'il regarde son téléphone = preuve de désengagement. S'il parle peu = preuve de manque de motivation. Vous ne voyez que ce qui confirme votre hypothèse. Watzlawick l'appelle la "prédiction qui se réalise" : vous créez par votre comportement ce que vous prédisiez.
- La projection culturelle : Vous venez d'une culture où regarder le patron dans les yeux signifie respect. Vous interprétez celui qui regarde vers le bas comme manquant de confiance. Mais dans sa culture, c'est l'inverse. Vous vous trompez.
- L'interprétation clinique : Un collaborateur n'est pas votre patient. Ne diagnostiquez pas. "Tu es déprimé" basé sur un comportement non-verbal est une violation. Vous n'êtes pas qualifié et ce n'est pas votre rôle.
- Le monologue non-verbal : Vous "lisez" quelqu'un pendant toute une réunion et vous ne lui parlez jamais. Résultat ? Vous avez une version complète construite mentalement, qui n'a aucun rapport avec la réalité. Dialoguez.
Conclusion : une fenêtre, pas un miroir
La gestuelle communique. Darwin l'a prouvé : c'est enraciné biologiquement. Mais Watzlawick a prouvé qu'on ne peut pas lire la gestuelle en dehors du système relationnel.
En tant que manager, vous n'êtes pas un "lecteur de corps". Vous êtes un observateur humble et curieux. Vous remarquez des patterns. Vous posez des questions. Vous créez un système où la communication verbale et non-verbale peuvent s'aligner.
Cela demande plus d'effort que de lire un "dictionnaire du body language". Mais c'est aussi infiniment plus efficace. Et c'est la seule approche honnête.
Vos collaborateurs ne sont pas des énigmes à déchiffrer. Ce sont des humains complexes, avec des tempéraments différents, des histoires relationnelles avec vous, des contextes culturels propres.
Regardez-les. Observez-les. Mais surtout, parlez-leur.
Les matrices de compatibilité caractérielle sont-elles une impasse ?
Le 05/10/2025
Précision liminaire
Je pratique une branche de la psychologie - la caractérologie - notamment celle de Le Senne. Mais il faut être clair sur ce qu'elle apporte par rapport aux tests conventionnels de personnalité.
Les tests standardisés (MBTI, Big Five, DISC, etc.) produisent des profils statiques et descriptifs. Ils photographient un état supposé stable, catégorisent, et souvent promettent de prédire les comportements. Leur logique est celle du catalogue : vous êtes ceci, donc vous êtes susceptibles de faire cela.
La caractérologie fonctionne autrement. Elle n'est pas prédictive mais compréhensive.
Elle offre un langage pour saisir les tendances d'une personne – son rapport à l'émotion, à l'action, au temps – non pas pour l'enfermer dans une case, mais pour comprendre comment elle se défend, comment elle entre en relation, comment elle souffre. C'est un outil d'intelligibilité du fonctionnement psychique, pas un verdict.
Surtout, la caractérologie que je pratique n'est jamais isolée du contexte relationnel et systémique. Savoir qu'un sujet est "colérique" ou "sentimental" ne dit rien de sa relation à l'autre tant qu'on n'analyse pas « comment » ces tendances s'actualisent dans l'interaction concrète. C'est une grille de lecture parmi d'autres, pas une vérité finale.
L'appel du catalogue
La tentation est compréhensible. Face à un couple en crise ou une équipe dysfonctionnelle, pouvoir consulter une matrice croisant les profils psychologiques pour prédire qui "fonctionne" avec qui procurerait une illusion rassurante de maîtrise. Les tests de personnalité en recrutement, les applications de rencontre basées sur des algorithmes de compatibilité, les conseils conjugaux simplistes oscillant entre "les opposés s'attirent" et "qui se ressemble s'assemble" témoignent de ce fantasme prédictif.
Le marché regorge de ces outils : MBTI, ennéagramme (j’y suis formé moi-même), DISC (j’y suis moi-même certifié), et même des réappropriations sauvages de typologies cliniques comme celle de Le Senne. Tous promettent la même chose : anticiper le fonctionnement relationnel en additionnant des caractéristiques individuelles. C'est séduisant, c'est vendeur, et c'est fondamentalement erroné.
Bergeret : la structure se révèle dans le lien
Jean Bergeret nous rappelle que la structure de personnalité n'est pas un objet fixe qu'on "apporterait" dans la relation comme un bagage préexistant. Elle se révèle, se mobilise et se transforme *dans* l'interaction.
Prenons un exemple : un sujet à fonctionnement obsessionnel ne "sera" pas le même avec un partenaire hystérique qu'avec un autre obsessionnel. Ce n'est pas une simple addition de traits (obsessionnel + hystérique = X). C'est un processus relationnel où chacun convoque chez l'autre certaines défenses, certains modes de fonctionnement plutôt que d'autres.
Avec un partenaire hystérique, l'obsessionnel pourra se rigidifier davantage pour contenir l'émotion débordante de l'autre, ou au contraire découvrir une souplesse insoupçonnée face à la séduction. Avec un autre obsessionnel, il pourra entrer dans une compétition féroce pour le contrôle, ou trouver un confort dans la prévisibilité partagée. Ce qui émerge n'est pas prédictible par une matrice mais par l'analyse du système défensif activé « entre » ces deux personnes-là, dans ce contexte-là.
La personnalité se co-construit dans le lien. Vouloir prédire la relation à partir des individus isolés, c'est comme vouloir prévoir la mélodie en examinant séparément chaque note.
Darwin : l'adaptation contextuelle prime
Charles Darwin nous enseigne que la sélection naturelle ne favorise pas « le meilleur » ou le plus « fort » en absolu, mais l'adéquation au milieu. Transposé aux relations humaines : il n'existe pas de combinaison caractérielle universellement fonctionnelle.
Un couple formé de deux sujets "colériques" (au sens de Le Senne : émotifs, actifs, primaires) peut être parfaitement adapté dans un contexte d'adversité nécessitant de l'action rapide et de l'intensité – gérer une entreprise en crise, affronter une maladie grave, traverser une période d'instabilité sociale. Le même couple, placé dans un contexte de stabilité et de routine quotidienne, peut devenir dysfonctionnel par surinvestissement énergétique sans exutoire.
Inversement, deux « flegmatiques » (non-émotifs, actifs, secondaires) excelleront dans la consolidation tranquille d'un projet à long terme mais risquent l'enlisement face à une urgence requérant réactivité émotionnelle.
L'environnement – matériel, social, temporel – détermine quelle configuration relationnelle sera adaptative. Une matrice de compatibilité fige ce qui est par nature évolutif et contextuel. Elle présuppose un essentialisme des caractères là où règne le mouvement adaptatif.
Watzlawick : la circularité contre la causalité linéaire
Paul Watzlawick et l'école de Palo Alto démolissent définitivement l'idée qu'on pourrait prédire une interaction en additionnant des caractéristiques individuelles. Leur apport majeur : substituer la causalité circulaire à la causalité linéaire.
La pensée linéaire dit : "A est dominateur, donc B devient soumis". La pensée circulaire dit : "A et B co-créent un pattern complémentaire de domination/soumission, chacun renforçant le comportement de l'autre dans une boucle sans origine assignable". Qui a commencé ? Question absurde. Le système interactionnel précède les positions individuelles.
Les patterns relationnels – complémentaires (différence acceptée) ou symétriques (égalité revendiquée) – émergent de l'interaction. Ils ne préexistent pas dans les "caractères" des protagonistes. Un même individu développera des patterns radicalement différents selon son interlocuteur et le contexte communicationnel.
Le paradoxe devient alors évident : chercher LA bonne combinaison de profils empêche précisément de voir COMMENT fonctionne le système relationnel réel. On cherche la cause dans les individus alors qu'elle réside dans la structure de leur interaction.
Vouloir établir une matrice de compatibilité, c'est comme vouloir prédire une partie d'échecs en examinant séparément les pièces blanches et noires, sans considérer le jeu lui-même.
Implications pratiques
En thérapie conjugale
Le couple qui consulte en disant "nous ne sommes pas compatibles" exprime souvent un renoncement à comprendre ce qui se joue entre eux. Le travail thérapeutique consiste alors à déplacer la question : non pas "sommes-nous faits l'un pour l'autre ?" mais "que jouons-nous ensemble et pouvons-nous jouer autrement ?"
Explorer les patterns circulaires, identifier les double-liens, mettre au jour les bénéfices secondaires des dysfonctionnements : voilà le travail clinique. Une matrice de compatibilité court-circuite cette élaboration en offrant un verdict pseudo-scientifique là où il faudrait une analyse.
En intervention systémique (équipes, organisations)
En contexte professionnel, l'illusion est encore plus prégnante. Les outils RH promettent de composer "l'équipe idéale" en croisant des profils. Résultat : on constitue des groupes sur le papier harmonieux qui dysfonctionnent dans la réalité, parce que personne n'a pensé à la régulation systémique nécessaire.
Une équipe n'est pas une collection d'individus mais un système avec ses règles implicites, ses coalitions, ses boucs émissaires, ses non-dits. La vraie question n'est pas "qui avec qui ?" mais "quelles régulations mettre en place pour que la diversité devienne ressource plutôt que handicap ?"
Un sujet à structure limite peut être toxique dans une équipe sans cadre, et précieux dans une équipe fortement structurée où son intensité émotionnelle apporte du liant. Un obsessionnel sera paralysant dans un contexte exigeant de la réactivité, et salvateur dans un projet nécessitant rigueur et anticipation.
Conclusion : de la carte au territoire
Les outils typologiques – que ce soit Le Senne, le Big Five, le MBTI ou tout autre système classificatoire – ont leur utilité comme « cartes heuristiques » pour penser. Ils permettent de nommer, de différencier, de conceptualiser des tendances caractérielles. Ce sont des instruments d'intelligibilité, pas des GPS prédictifs.
L'erreur catastrophique consiste à les transformer en matrices de compatibilité, c'est-à-dire en instruments prédictifs d'appareillage relationnel. C'est confondre la carte avec le territoire, le concept avec le réel, la typologie avec la clinique.
La vraie expertise du praticien – thérapeute, coach, consultant – ne réside pas dans la maîtrise d'un catalogue de profils, mais dans sa capacité à analyser finement ce qui se joue « ici et maintenant » entre CES personnes-là, dans CE contexte-là. C'est plus exigeant intellectuellement, plus inconfortable pour le praticien/consultant et pour le patient ou client, mais c'est la seule voie cliniquement honnête.
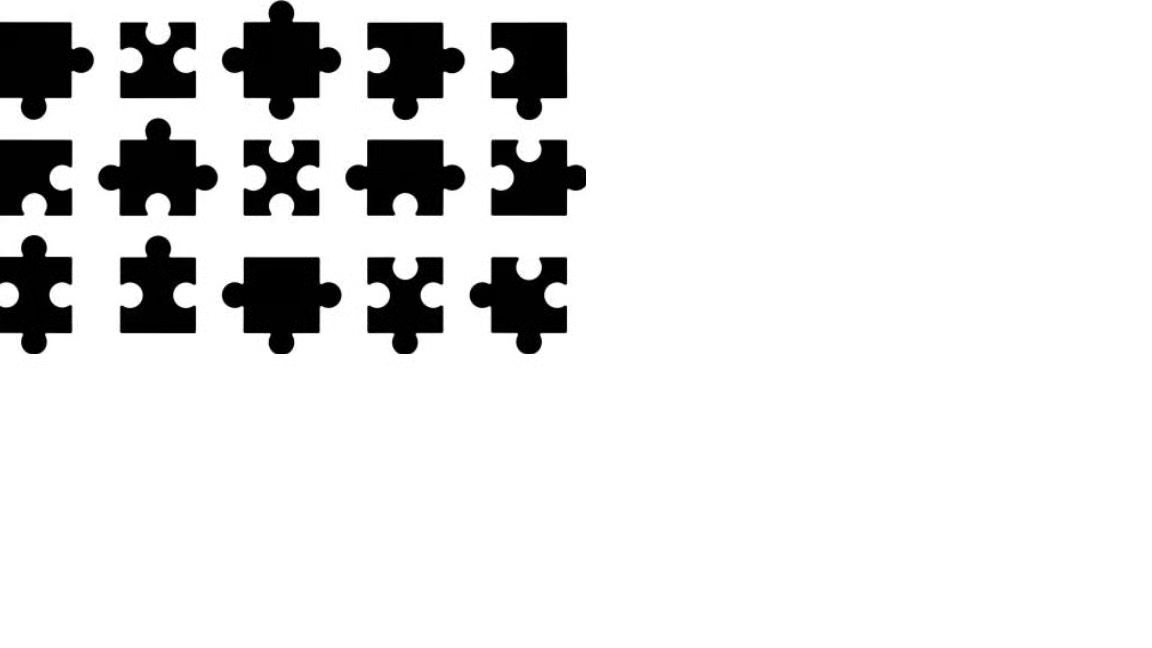
Affaire Daval : trajectoire d'un meurtrier
Le 04/09/2025
L’affaire Daval a bouleversé la France par son paradoxe : celui du « gendre idéal » devenu meurtrier. Comment comprendre ce basculement ? La seule explication rationnelle ne peut se réduire à la jalousie, à une dispute ou au hasard tragique d’une soirée. Pour éclairer ce drame, il faut se tourner vers la caractérologie de René Le Senne, et plus particulièrement vers le type émotif – non actif – secondaire (EnAS).
Ce profil de caractère, bien identifié, est prédisposé à accumuler les tensions intérieures jusqu’au moment où la soupape cède. Jonathann Daval en incarne une illustration clinique.
Un terrain psychologique fragile
L’émotif vit tout intensément. Ses expériences, ses relations, ses échecs comme ses réussites, prennent une dimension disproportionnée. Daval apparaît, dès son adolescence, comme un garçon timide, introverti, manquant de confiance en lui. L’émotivité, sans l’activité qui permet de la transformer en action constructive, devient un poids.
Or, chez le non-actif, les conflits ne se règlent pas dans l’affrontement ou le dialogue. Ils s’intériorisent, se ruminent, fermentent. À cela s’ajoute la secondarité, c’est-à-dire la tendance à ressasser les blessures et à entretenir les rancunes. Dans le cas de Daval, cela se traduit par des années de frustrations silencieuses, soigneusement contenues derrière un masque d’effacement.
L’idéalisation comme refuge
Rencontrer Alexia au lycée fut pour lui une planche de salut narcissique. Elle était plus vive, plus affirmée, plus énergique. En la choisissant, il s’offrait une identité par procuration : « elle a changé ma vie », disait-il. En réalité, il s’est installé dans une relation asymétrique : elle comme moteur, lui comme suiveur.
L’idéalisation d’Alexia lui évitait la confrontation avec son propre vide intérieur. Mais idéaliser, c’est aussi se condamner : si l’objet aimé s’éloigne, c’est tout l’édifice psychique qui s’effondre. Or, leur couple traversait une crise majeure : disputes répétées, difficulté à concevoir un enfant, déséquilibre des places. L’homme effacé voyait poindre le risque ultime : être abandonné, se retrouver nu, sans femme, sans foyer, sans identité.
La cocotte-minute caractérologique
Un profil EnAS fonctionne comme une cocotte-minute émotionnelle. Chaque reproche, chaque humiliation, chaque conflit non exprimé s’ajoute dans le réservoir. Rien ne sort, tout se dépose dans les couches profondes de la mémoire affective. La secondarité maintient vivace ces blessures, la non-activité empêche de les sublimer, et l’émotivité leur donne une intensité presque insupportable.
Le soir du meurtre, la dispute fut « la dispute de trop ». Les mots d’Alexia, ses reproches, ont rouvert des années de blessures enfouies. Jonathann lui-même l’a reconnu à l’audience : « Tout est ressorti, ces années de colère, tout ce que j’ai emmagasiné… »
Il ne s’agit pas d’une explosion « soudaine » au sens strict. Le terrain était préparé depuis longtemps. La rupture, impossible à concevoir pour lui, équivalait psychiquement à une annihilation. Le passage à l’acte fut alors l’expression ultime d’un effondrement du Moi incapable de contenir davantage la pression.
Le meurtre comme fausse solution
Étrangler Alexia n’était pas un projet, mais une issue brutale à un conflit intérieur insoluble. Il voulait « qu’elle se taise », disait-il. Derrière cette phrase, on lit le désespoir d’un homme incapable d’affronter la vérité de son couple et de sa propre fragilité. Le meurtre fut une tentative désespérée de faire taire la source de ses tourments internes.
Mais une fois l’acte accompli, l’émotif redevient… émotif. D’où ces larmes, ces signes de tristesse authentique, ce chagrin réel. L’émotif-non actif-secondaire n’est pas un psychopathe froid : c’est un être hypersensible, mais prisonnier de son incapacité à transformer sa sensibilité en confrontation constructive. D’où ce paradoxe : meurtrier et triste à la fois.
Une leçon de caractérologie
L’affaire Daval montre avec une crudité tragique comment certains profils caractérologiques, laissés à eux-mêmes, peuvent devenir dangereux dans un contexte de crise. L’EnAS est vulnérable face à l’accumulation de stress. Tant que le cadre est protecteur, il s’y fond. Mais dès que le cadre menace de se fissurer, le risque d’explosion devient réel.
Comprendre cela n’excuse rien. Cela permet en revanche d’identifier un mécanisme psychologique récurrent : la violence comme débordement de tensions trop longtemps contenues. Daval n’est pas l’incarnation du mal absolu, mais l’illustration tragique d’une structure de caractère fragile, confrontée à une situation de couple destructrice.
Conclusion
Le « gendre idéal » n’a pas tenu. Non parce qu’il était pervers ou manipulateur de bout en bout, mais parce que son profil caractérologique le condamnait à l’échec face à un stress conjugal extrême.
L’émotif-non actif-secondaire peut être tendre, fidèle, attachant. Mais il est aussi celui qui, privé d’espace d’expression, accumule les rancunes silencieuses jusqu’à ce que l’implosion devienne inévitable. L’affaire Daval nous rappelle que la compréhension des structures de caractère n’est pas une spéculation théorique : c’est une grille de lecture indispensable pour prévenir, anticiper et, peut-être, éviter le pire.

Convergences
Le 30/08/2025
Les convergences de Freud, René Le Senne, Jean Bergeret, Charles Darwin et Paul Watzlawick : une lecture croisée de l’humain
L’histoire de la pensée psychologique et scientifique a souvent pris des chemins divergents. D’un côté, la psychanalyse freudienne, marquée par l’exploration des profondeurs de l’inconscient et des conflits psychiques. De l’autre, la caractérologie de René Le Senne, cherchant à décrire les structures fondamentales de la personnalité. À côté encore, la clinique de Jean Bergeret, attentive aux pathologies de la relation et aux modes d’organisation de la vie psychique. Mais également, l’évolutionnisme de Charles Darwin, qui replace l’homme dans la continuité biologique du vivant. Enfin, la théorie de la communication de Paul Watzlawick, ancrée dans une lecture interactionnelle et systémique.
À première vue, ces cinq penseurs n’ont pas grand-chose en commun. Freud s’intéressait aux rêves, Darwin aux pinsons des Galápagos, Le Senne à la typologie des caractères, Bergeret aux cliniques borderline et Watzlawick aux paradoxes de la communication humaine. Pourtant, si l’on gratte la surface, on découvre un faisceau de points de rencontre, qui dessinent une vision cohérente de l’homme : un être déterminé, contraint, traversé par des tensions internes et externes, fondamentalement relationnel, limité dans sa liberté mais inscrit dans une dynamique évolutive.
Je vous propose d’explorer ces convergences. Non pas pour les forcer artificiellement, mais parce qu’elles révèlent une manière commune d’aborder l’humain : non pas comme un individu souverain, mais comme un être façonné par des structures qui le dépassent.
Nous suivrons cinq fils directeurs : les structures qui déterminent l’homme, les conflits qui l’animent, la centralité du lien à l’autre, les limites de sa liberté, et enfin la dimension évolutive qui traverse sa condition.
L’homme déterminé par ses structures
Freud, Darwin, Le Senne, Bergeret et Watzlawick partagent une conviction fondamentale : l’homme ne se définit pas d’abord par sa liberté, mais par des structures qui le déterminent.
Freud : la tyrannie de l’inconscient
Freud a montré que l’homme est gouverné par des forces inconscientes. Le « ça », réservoir pulsionnel, agit en dehors de toute volonté consciente. Le « moi » tente de composer avec la réalité, tandis que le « surmoi » impose ses interdits. Loin d’être libre, l’homme est ainsi travaillé par des instances psychiques contradictoires. Les rêves, les lapsus, les symptômes névrotiques montrent la puissance de cet inconscient structuré.
René Le Senne : la structure caractérologique
René Le Senne a proposé une approche caractérologique fondée sur trois dimensions stables : l’émotivité, l’activité et le retentissement (primaire ou secondaire). Ces paramètres dessinent une « structure » relativement fixe, qui conditionne la manière d’être au monde. Un émotif primaire ne réagira pas comme un non-émotif secondaire : la liberté se trouve encadrée par cette trame.
Darwin : l’héritage de l’évolution
Pour Darwin, l’homme est avant tout un animal. Son comportement, ses instincts, ses émotions trouvent leur origine dans des processus évolutifs. La peur, la jalousie, la coopération, la tendance à protéger sa descendance : autant de traits qui s’expliquent par la sélection naturelle. L’individu ne choisit pas ces dispositions, il les reçoit en héritage.
Bergeret : les organisations de la personnalité
Jean Bergeret a montré que la personnalité se structure selon des organisations – névrotique, psychotique, limite – qui orientent la manière de gérer les conflits internes et externes. Ces organisations ne sont pas des choix conscients, mais des adaptations précoces à des environnements affectifs et relationnels.
Watzlawick : la prison de la communication
Pour Paul Watzlawick, l’homme est pris dans des systèmes de communication dont il ne peut sortir. « On ne peut pas ne pas communiquer » : même le silence est un message. Les relations imposent des codes et des significations qui échappent souvent au contrôle individuel.
Point commun : tous ces penseurs montrent que l’homme est déterminé par des structures – inconscientes, caractérologiques, biologiques, organisationnelles ou communicationnelles.
Conflits et tensions comme moteur
L’homme n’est pas seulement structuré : il est traversé par des tensions. Ces conflits constituent le moteur même de son fonctionnement psychique et social.
Freud : les conflits pulsionnels
La psychanalyse repose sur l’idée que l’homme est travaillé par des pulsions contradictoires : Eros (vie, sexualité, lien) et Thanatos (mort, destruction). Le principe de plaisir se heurte au principe de réalité. Les symptômes naissent de ces tensions jamais complètement résolues.
Bergeret : les conflits psychiques organisateurs
Bergeret a décrit comment chaque organisation de la personnalité gère les conflits. Le névrotique vit dans le conflit intrapsychique (désir vs interdit). Le psychotique gère la menace d’effondrement de l’identité. Le borderline oscille entre ces deux pôles, avec un conflit constant autour de l’abandon et de la dépendance.
Le Senne : la tension caractère/situation
Le Senne insistait sur la confrontation entre structure caractérologique et circonstances. Un caractère rigide se heurte à une situation exigeant de la souplesse, et naît alors un conflit intérieur qui oriente le comportement.
Darwin : la lutte pour l’existence
L’évolution repose sur la tension entre individus pour la survie et la reproduction. La nature est une scène de conflits permanents : prédateur et proie, individus concurrents, espèces en compétition.
Watzlawick : les paradoxes de la communication
La double contrainte (double bind) illustre la conflictualité relationnelle : « sois spontané ! », injonction contradictoire qui piège l’individu. Les relations humaines sont traversées de paradoxes inévitables.
Point commun : chez tous, l’homme est un être de contradiction, son équilibre dépend de la manière dont il gère ses conflits.
L’importance du lien à l’autre
Aucun de ces auteurs ne pense l’homme isolément. Tous soulignent la dimension fondamentale de la relation.
Freud : le transfert et l’amour
Freud a montré que le rapport à l’autre est fondateur : le sujet se constitue dans le regard et le désir de l’autre. Le transfert en psychanalyse révèle combien les relations passées continuent de structurer les relations présentes.
Bergeret : pathologies relationnelles
Pour Bergeret, les troubles de la personnalité sont avant tout des troubles du lien. Les borderline, par exemple, oscillent entre fusion et rejet, dépendance et haine de l’autre.
Watzlawick : les axiomes de la communication
La communication est constitutive du lien humain. On ne peut pas ne pas communiquer, chaque message porte un contenu et une dimension relationnelle, et toute interaction est ponctuée différemment selon les acteurs.
Darwin : l’origine de la coopération
Darwin voyait dans la coopération et la solidarité des instincts sociaux favorisés par l’évolution. Les groupes capables d’entraide avaient plus de chances de survie.
Le Senne : compatibilités caractérologiques
La caractérologie éclaire les affinités et les incompatibilités : certains caractères se complètent, d’autres s’affrontent. La relation dépend de ces structures profondes.
Point commun : l’homme est un être de relation, le lien à l’autre conditionne son existence.
Les limites de la liberté et de la conscience
Tous ces penseurs convergent sur un point dérangeant : la liberté humaine est très relative.
Pour Freud, nous croyons décider, mais c’est l’inconscient qui gouverne.
Pour Le Senne, nous croyons choisir, mais c’est le caractère qui fixe nos marges.
Pour Bergeret, nous croyons être autonomes, mais notre histoire affective nous détermine.
Pour Darwin, nous croyons être supérieurs, mais nous restons soumis aux lois biologiques.
Pour Watzlawick, nous croyons être libres, mais nous sommes pris dans des systèmes communicationnels dont nous ne maîtrisons pas les règles.
Point commun : l’homme est limité, sa liberté est un mythe réconfortant plus qu’une réalité.
Une vision dynamique et évolutive de l’humain
Malgré ces contraintes, ces penseurs ne décrivent pas un homme figé. Au contraire, tous insistent sur la dimension dynamique de l’humain.
Freud : l’appareil psychique est un champ de forces en perpétuel mouvement.
Darwin : l’évolution est un processus continu, qui façonne encore nos comportements.
Bergeret : les organisations psychiques sont des adaptations dynamiques à l’environnement relationnel.
Le Senne : le caractère est stable, mais il se module selon les expériences.
Watzlawick : la communication est un système vivant, toujours en réorganisation.
Point commun : l’homme est un processus, pas une essence.
En conclusion
Freud, Le Senne, Bergeret, Darwin et Watzlawick appartiennent à des traditions intellectuelles très différentes. Pourtant, leurs pensées se rejoignent sur plusieurs points :
L’homme est déterminé par des structures qui le dépassent.
Son existence est traversée de conflits et de contradictions.
Le lien à l’autre est fondamental.
Sa liberté est limitée.
Il est un être en mouvement, inscrit dans une dynamique évolutive.
En croisant ces perspectives, on obtient une image de l’humain bien plus complexe qu’une vision naïve de l’individu libre et rationnel. L’homme est un être paradoxal : contraint mais dynamique, limité mais créatif, toujours pris entre des déterminismes et des possibles.
Cette lecture croisée permet d’éclairer nos comportements contemporains. Face aux nouvelles pathologies du lien, aux illusions de liberté entretenues par les réseaux sociaux, ou encore aux tensions identitaires, les enseignements de Freud, Le Senne, Bergeret, Darwin et Watzlawick demeurent d’une actualité brûlante.
Pourquoi certaines personnes répètent les mêmes erreurs ?
Le 31/07/2025
« Je ne comprends pas… je retombe toujours dans les mêmes travers. »
« J’attire toujours le même type de personne. »
« Chaque fois que j’avance, je finis par saboter. »
Ces phrases résonnent dans les cabinets de psychologues, de thérapeutes et de coachs. Derrière l’apparent hasard de certaines répétitions se cache une mécanique bien plus profonde, enracinée dans la personnalité, le tempérament et l’histoire du sujet.
Voici une lecture croisée à la fois caractérologique, comportementale et psychanalytique, pour mieux comprendre ces scénarios qui se rejouent, souvent au détriment de notre épanouissement.
La répétition : un symptôme courant, une fonction adaptative
Répéter, en soi, n’a rien d’anormal. Notre cerveau fonctionne par schémas et routines, ce qui lui permet d’économiser de l’énergie cognitive. Ainsi, nous apprenons à marcher, conduire, parler ou résoudre des conflits à partir de nos expériences passées. Le problème surgit lorsque ces répétitions deviennent rigides, douloureuses, ou autodestructrices.
Le comportement appris : le poids du conditionnement
La psychologie comportementale montre que nos réactions sont souvent le fruit d’apprentissages précoces. Nous développons des réponses conditionnées selon les conséquences que nos actions ont eues par le passé :
Un comportement renforcé (par une récompense ou une réduction d’un malaise) tend à se maintenir.
Un comportement puni ou inefficace tend à s’éteindre… sauf si une dimension affective s’y accroche.
Par exemple, une personne qui a appris dans l’enfance que la soumission évitait les conflits familiaux pourra reproduire ce pattern dans ses relations adultes, même si cela nuit à son affirmation de soi.
Freud et la compulsion de répétition : rejouer pour (ne pas) comprendre
Freud fut l’un des premiers à théoriser la compulsion de répétition : la tendance inconsciente à rejouer certains scénarios traumatiques non élaborés.
Pourquoi ? Parce que le psychisme, pour intégrer un événement, doit pouvoir le représenter, le symboliser, le mettre en récit. Si ce n’est pas le cas (par exemple dans un trauma infantile), l’expérience revient… mais sous forme d’action, de répétition.
On ne s’en souvient pas, on le revit.
Par exemple, un sujet abandonné par un parent négligent peut inconsciemment choisir des partenaires distants ou indisponibles. Il tente de réparer l’histoire… mais en réactivant exactement le même schéma.
La structure caractérielle : nos filtres émotionnels et relationnels
La caractérologie, notamment celle initiée par René Le Senne, permet de comprendre comment nos traits de caractère profonds influencent la manière dont nous vivons et interprétons le monde.
Selon Le Senne, trois facteurs principaux structurent le caractère :
- Émotivité : sensibilité à l’impact affectif d’un événement. L’émotif adhère à ce qui l’émeut. D’autre part, l’émotivité se spécifie et souvent ne se traduira que dans les domaines où les intérêts vitaux de l’individu sont engagés. Ainsi, un émotif pourra être froid pour ce qui ne l’intéresse pas.
- Activité : tendance à passer à l’action ou à rester passif. L’inactif agit contre son gré, l’actif vit pour agir.
- Retentissement : on doit distinguer entre le retentissement actuel d’une représentation et son retentissement posthume. Tous les effets produits par une représentation pendant qu’elle occupe la conscience constituent le premier retentissement, la fonction primaire de la représentation. Tous les effets produits par une représentation après qu’elle a cessé d’être présente à la conscience constituent le second retentissement, la fonction secondaire de la représentation. Quand les effets d’une donnée mentale actuellement présente à la conscience refoulent ceux des données passées, la fonction primaire domine, on se trouve en présence d’un « primaire ». Dans le cas inverse, la « secondarité » domine et l’homme doit être dit secondaire. (Guy Palmade – « La caractérologie » – Puf, 1995).
Ces variables donnent naissance à plusieurs types caractériels, chacun ayant ses répétitions typiques.
Quelques exemples :
Le Passionné (émotif, actif, secondaire) : recherche de relations intenses. Il répète souvent des histoires d’amour conflictuelles, jalouses ou fusionnelles. Il dramatise, amplifie, relance des scénarios relationnels intenses, quitte à s’épuiser.
Le Flegmatique (non émotif, non actif, secondaire) : évite le conflit, préfère la stabilité. Il peut se retrouver dans des contextes professionnels ou conjugaux médiocres mais s’y maintient longtemps, par peur du changement ou du conflit.
Le Nerveux (émotif, non actif, primaire) : hypersensible, impulsif, souvent instable. Il peut répéter des décisions précipitées ou des sabotages à court terme, sous le coup de l’émotion.
Ces traits ne sont pas des fatalités, mais ils structurent des filtres de perception qui influencent nos choix, nos attirances, nos réactions, donc… nos répétitions.
Schémas précoces inadaptés
La thérapie des schémas de Jeffrey Young propose une lecture intégrative : certaines répétitions comportementales viennent de schémas précoces inadaptés, c’est-à-dire de croyances négatives construites très tôt (souvent dans l’enfance) à partir d’expériences relationnelles dévalorisantes ou insécurisantes.
Par exemple :
- Schéma d’abandon → partenaires émotionnellement indisponibles.
- Schéma de carence affective → recherche excessive de validation.
- Schéma de défaveur → sabotage des réussites.
Ces schémas activent des réponses comportementales automatiques, que le patient confond souvent avec sa « personnalité » alors qu’il s’agit de stratégies de survie émotionnelle.
Illustrations concrètes
Marie, 34 ans, passionnée
Marie tombe toujours amoureuse d’hommes instables, parfois violents, mais ne « supporte pas » la tiédeur ou la prévisibilité. En caractérologie, elle correspond à un type émotif-actif-secondaire (passionnée).
Sa compulsion de répétition est aussi alimentée par un schéma de trahison (père infidèle). Elle rejoue l’abandon et cherche à le maîtriser… en le provoquant.
Thomas, 41 ans, flegmatique
Thomas reste dans un poste sous-payé depuis dix ans malgré un potentiel reconnu. Il évite les conflits, n’ose pas demander une augmentation ni postuler ailleurs. Il est de type flegmatique secondaire, peu émotif, peu actif, ruminant.
Son schéma de soumission l’amène à répéter des situations de dévalorisation, par peur de perdre l’approbation des autres.
Comment sortir de la répétition ?
Briser les répétitions nécessite :
La prise de conscience du schéma : reconnaître le pattern, voir ses origines, repérer les déclencheurs.
L’identification des croyances associées : « Je ne mérite pas mieux », « Je suis trop… », « Si je me défends, on me rejette ».
Un travail sur les traits de caractère : non pas pour les « changer », mais pour les apprivoiser et les adapter.
La mise en place de nouvelles réponses comportementales : expérimenter progressivement d’autres manières d’agir ou de réagir.
Une forme de tolérance à l’inconfort : car sortir d’un schéma familier, même douloureux, provoque de l’angoisse.
La répétition n’est pas une faiblesse, c’est un signal
Répéter les mêmes erreurs n’est pas un défaut moral mais un langage de l’inconscient et du caractère. C’est une tentative de maintenir une forme de cohérence interne, souvent coûteuse émotionnellement mais qui a du sens si on sait l’écouter.
Analyser ses schémas, comprendre son fonctionnement caractériel, décrypter ses conditionnements comportementaux, c’est ouvrir la voie à une transformation réelle — pas celle d’un idéal rêvé, mais celle d’un soi plus libre, plus lucide et plus apaisé.
Agir sous le coup de l'émotion
Le 19/07/2025
Est-il bon d’agir sous le coup de la colère ou de la tristesse ?
Une perspective comportementale sur l’impact des émotions intenses sur nos décisions.
Emotion et action, un lien instinctif
Il est courant d’entendre des expressions telles que : « J’ai réagi à chaud », « Je n’étais pas moi-même », ou « Je regrette d’avoir agi sous le coup de l’émotion ». Ces formulations traduisent une réalité neuropsychologique bien documentée : les émotions, lorsqu’elles atteignent une certaine intensité, modifient profondément nos prises de décision, nos actions et nos jugements.
Mais faut-il pour autant s’abstenir systématiquement d’agir lorsqu’on ressent de la colère ou de la tristesse ? Toute émotion forte est-elle mauvaise conseillère ? Dans cet article, nous examinons ces questions sous un angle comportementaliste, en nous appuyant sur les notions de régulation émotionnelle, de renforcement et de contingence.
Colère et tristesse : deux émotions fondamentales, deux fonctions adaptatives
La colère et la tristesse sont des réponses émotionnelles naturelles, universelles, et fonctionnelles. Elles remplissent des rôles bien précis dans notre adaptation à l’environnement :
La colère est liée à une perception d’injustice, de violation de règles ou de frustration. Elle est souvent associée à une activation physiologique intense (augmentation du rythme cardiaque, tension musculaire, vigilance accrue) et à une tendance à l’action : confrontation, revendication, défense des limites.
La tristesse, en revanche, est une émotion de perte, de désespoir ou d’impuissance. Elle s’accompagne d’un ralentissement global (baisse d’énergie, retrait social, rumination) et vise souvent à favoriser la réévaluation, la demande de soutien, ou l’introspection.
Ces émotions, dans un cadre adaptatif, servent à mobiliser des ressources ou à susciter des ajustements dans nos relations et nos comportements. Elles ne sont pas intrinsèquement négatives, mais leur influence sur nos comportements peut devenir problématique lorsqu’elles bloquent l’analyse rationnelle ou renforcent des patterns dysfonctionnels.
Agir "à chaud" : quels risques comportementaux ?
D’un point de vue comportemental, agir sous le coup d’une émotion intense revient à réagir automatiquement à un antécédent émotionnel, souvent sans analyse des conséquences. Cela pose plusieurs problèmes :
1. Distorsion de l’évaluation des contingences
Sous l’effet de la colère ou de la tristesse, l’individu surestime ou sous-estime certaines conséquences de ses actes. Par exemple, une personne en colère peut frapper ou insulter un proche, pensant "remettre les pendules à l’heure", sans anticiper les dommages relationnels à long terme.
2. Renforcement immédiat du comportement émotionnel
Si l’action entreprise "soulage" l’émotion (ex. : crier ou claquer une porte apaise temporairement la tension), un renforcement négatif se produit : on est plus susceptible de réutiliser ce mode d’action à l’avenir, même s’il est inadapté.
3. Inhibition des fonctions exécutives
Les émotions fortes activent le système limbique (notamment l’amygdale), au détriment du cortex préfrontal impliqué dans la planification, la logique et le contrôle inhibiteur. Il s’agit d’un biais neurocomportemental naturel, mais potentiellement dommageable.
Cas cliniques : quand l’émotion parasite la décision
Exemple 1 : La colère impulsive
Un patient se dispute avec sa conjointe et, pris dans un élan de colère, claque la porte et quitte le domicile. Sur le moment, il ressent un soulagement (renforcement négatif de la fuite), mais le conflit s’envenime. Ce comportement devient un schéma répétitif : dès que la tension monte, il fuit ou explose, empêchant toute régulation constructive.
Exemple 2 : La tristesse paralysante
Une patiente, après une rupture, se sent submergée par une tristesse intense. Elle envoie des messages désespérés à son ex-partenaire dans l’espoir de rétablir un lien. L’inaction de l’autre renforce son sentiment d’abandon. Chaque message non répondu devient une preuve de rejet, consolidant un cercle vicieux de passivité et de dévalorisation.
Est-il possible d’agir sous émotion sans être dysfonctionnel ?
Oui, mais à certaines conditions. Les recherches en psychologie de la régulation émotionnelle et en thérapie comportementale montrent qu’il est possible d’agir sous le coup d’une émotion à condition que celle-ci soit identifiée, régulée et contextualisée.
1. La reconnaissance émotionnelle
Avant d’agir, il faut pouvoir nommer ce que l’on ressent. "Je suis en colère", "Je suis triste", "Je suis frustré". Cette mise en mots favorise une prise de recul.
2. La régulation émotionnelle
Il ne s’agit pas de nier ou de bloquer l’émotion, mais de l’accueillir sans se laisser submerger. Des techniques comme la respiration, l’ancrage, la pleine conscience ou les stratégies de distraction active (aller marcher, appeler un proche, écrire) permettent de retrouver un seuil de lucidité avant l’action.
3. Le report de la décision
Dans la plupart des situations, l’urgence ressentie est émotionnelle, pas réelle. Remettre à plus tard l’action ("Je vais y réfléchir ce soir", "Je lui répondrai demain") est souvent un acte de lucidité, pas de faiblesse.
Ce que dit la recherche : émotion ≠ mauvaise décision… si elle est régulée
Des études en psychologie cognitive (Gross, 1998 ; LeDoux, 2000 ; Damasio, 1994) ont montré que les émotions sont essentielles à la prise de décision. Antonio Damasio a notamment démontré qu’un individu privé de ressentis émotionnels (suite à une lésion cérébrale) est incapable de prendre des décisions cohérentes, même simples.
Mais ces émotions doivent être intégrées au raisonnement, pas le remplacer.
Ressentir, oui – agir impulsivement, non
Agir sous le coup de la colère ou de la tristesse n’est pas conseillé si l’émotion domine l’analyse comportementale, biaise la perception des conséquences ou renforce des réactions inadaptées. Cela peut entraîner des effets secondaires importants : conflits, ruptures, culpabilité, isolement, ou encore auto-renforcement de schémas dysfonctionnels.
Toutefois, une émotion reconnue, régulée et mise au service d’un objectif clair peut devenir un puissant moteur d’action. En tant que psychologue comportementaliste, il est essentiel d’enseigner aux patients à distinguer l’impulsion de l’intention, à retarder l’action, et à réévaluer les contingences émotionnelles avant d’agir.
Pour aller plus loin
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology.
Damasio, A. (1994). L’erreur de Descartes : la raison des émotions.
Baumeister, R. F. et al. (2007). Emotion, decision, and action: A behavioral perspective. Psychological Inquiry.
Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior.
Du passage à l'acte à l'acting out
Le 25/05/2025
Le comportement humain ne naît pas au hasard. Il résulte d’une interaction complexe entre trois grandes dimensions : cognitive (les pensées et représentations mentales), affective (les émotions et sentiments), et biologique (l’état physique, le fonctionnement cérébral, etc.). Ces trois éléments forment ce qu’on appelle une causalité triadique : un modèle qui montre que nos actions sont le produit de plusieurs influences simultanées et interdépendantes, je n’évoque pas l’influence de l’environnement ici.
De cette interaction peut émerger un moteur essentiel à l’action : la motivation. Cette dernière ne se résume pas à une simple envie passagère ; elle repose sur quatre caractéristiques principales :
- L’intentionnalité : c’est le fait que des états mentaux tels que percevoir, croire, désirer, craindre et avoir une intention, se réfèrent toujours à quelque chose.
- La pensée anticipatrice : ici, les événements futurs imaginés servent à la fois à nous pousser à agir (motivation) et à ajuster notre comportement en fonction de ce qui est attendu (régulation).
- L’auto-réactivité : cela correspond à notre aptitude à nous autoréguler, c’est-à-dire à gérer nous-mêmes notre motivation, nos émotions et nos actions.
- La réflexivité : pour ajuster son comportement de manière fine, il est essentiel d’avoir un certain recul sur soi, d’être capable de s’observer, de s’analyser et de se remettre en question.
Pour comprendre pourquoi une personne agit comme elle le fait, il faut prendre en compte ce mélange subtil entre pensées, émotions, état physique et capacité à se projeter. C’est dans cet équilibre que naît la motivation, ce moteur discret mais fondamental de nos comportements.
Ce cadre permet aussi d’éclairer certains comportements impulsifs ou violents, comme ce que l’on appelle en psychologie l’acting out. Il s’agit d’un passage à l’acte souvent brutal, où une tension interne – émotionnelle ou psychique – n’est pas verbalisée, mais exprimée directement par le comportement. Lorsqu’une personne n’a pas accès à la réflexivité ou à l’autorégulation, ou lorsque la pensée anticipatrice est court-circuitée par une charge affective trop intense, l’acting out peut devenir une manière de "dire sans mots".
Deux exemples concrets (soft) :
- Un adolescent en colère après une dispute avec ses parents claque violemment la porte, renverse des objets et quitte la maison sans prévenir. Il ne parvient pas à exprimer verbalement ce qu’il ressent, et son passage à l’acte devient le seul moyen d’extérioriser sa frustration.
- Un patient en thérapie, submergé par une émotion qu’il ne parvient pas à formuler, interrompt brusquement la séance en lançant une remarque blessante, puis quitte le cabinet. Là encore, le comportement agit comme un exutoire émotionnel, en l’absence de mots disponibles pour canaliser la tension.
Ces exemples montrent que l’acting out est souvent un signal de détresse, et qu’il peut être compris comme une tentative de rétablir un équilibre intérieur perdu.
L’acting out se définit par un acte impulsif en lien avec la dynamique relationnelle. Porot (1969) le définit comme un passage à l’acte réservé aux actes violents et agressifs à caractère impulsif et délictueux. Pour lui, le terme de « passage à l’acte » correspond plutôt à l’agir, c’est-à-dire à l’ensemble des actes, de l’impulsif aux conduites organisées.
Dans les éléments qui, conjugués entre eux favorisent cet acting out selon Vercier (1938), nous retrouvons l’infantilisme psychique, la faiblesse du jugement, le défaut d’autocritique, l’absence de gestion des émotions. Tardif (1998) y ajoute l’alexithymie, c’est-à-dire une incapacité à développer une activité symbolique, par l’inhabilité à mettre en mots et à différencier émotions et sensations corporelles et par un appauvrissement de la vie fantasmatique/phantasmatique ( on distingue « fantasme » qui est un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, d'une façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient et « phantasme » qui désigne le fantasme inconscient). « Le problème de l’alexithymique ne réside pas dans la propension à décharger les émotions mais dans l’impossibilité de tolérer les affects et les informations significatives qui y sont liés, ce qui génère une incapacité à élaborer ce qu’il ressent » (Tardif, 1998).
Ce mode de fonctionnement primaire caractérise une incapacité à freiner l’impulsivité, à tolérer la frustration. C’est prendre un raccourci entre ressenti et comportement, ce qui évite de passer par une phase d’élaboration intellectuelle, trop coûteuse, trop vorace en énergie.
En compensation de cet acting out, c’est un sentiment d’impunité, d’omnipotence, de toute puissance mais il s’agit en arrière-plan d’une réactualisation des conflits internes avec une compulsion de répétition. C’est un mode d’expression d’enfant en bas âge envahi par la honte, le désespoir, et l’incapacité de résilience… leurs tensions psychologiques sont déplacées vers des voies moins coûteuses en énergie, en effort, en remise en question…
Ces individus qui font de l’acting out leur mode d’expression courante, cachent des squelettes émotionnels (voire pire) dans un placard qu’ils ne veulent surtout pas ouvrir. Pas très valorisant mais lorsque l’éducation fait montre d’un manque flagrant de limite et d’obligation, de la dévalorisation du débat contradictoire et d’une absence totale de la recherche de sources fiables, il ne faut pas s’étonner. Le goût de l’effort devrait être un pilier dans l’éducation, et nous sommes tous acteurs de nos vies…
« Le recours à l’acte, à la violence, est une réalisation narcissique de puissance pour échapper à la menace de vide narcissique créée par la captation spéculaire. Le retournement de la passivité en activité et, inversement, la cyclicité de ces processus se réfèrent à une angoisse de passivation et d’anéantissement, l’acte criminel sauvant d’un effondrement insupportable » (Balier, Zagury, Meloy).
Sources :
Raoult, P.-A. (2006). Clinique et psychopathologie du passage à l'acte. Bulletin de psychologie, Numéro 481(1), 7-16. https://doi.org/10.3917/bupsy.481.0007.
Vercier (V.). – Les états de déséquilibre mental, Thèse de médecine, Paris, 1938.
Tardif (Monique). – Le déterminisme de la carence d’élaboration psychique dans le passage à l’acte, dans Millaud (F.), Le passage à l’acte. Aspects cliniques et psychodynamiques, Paris, Masson, 1998, p. 25-40.
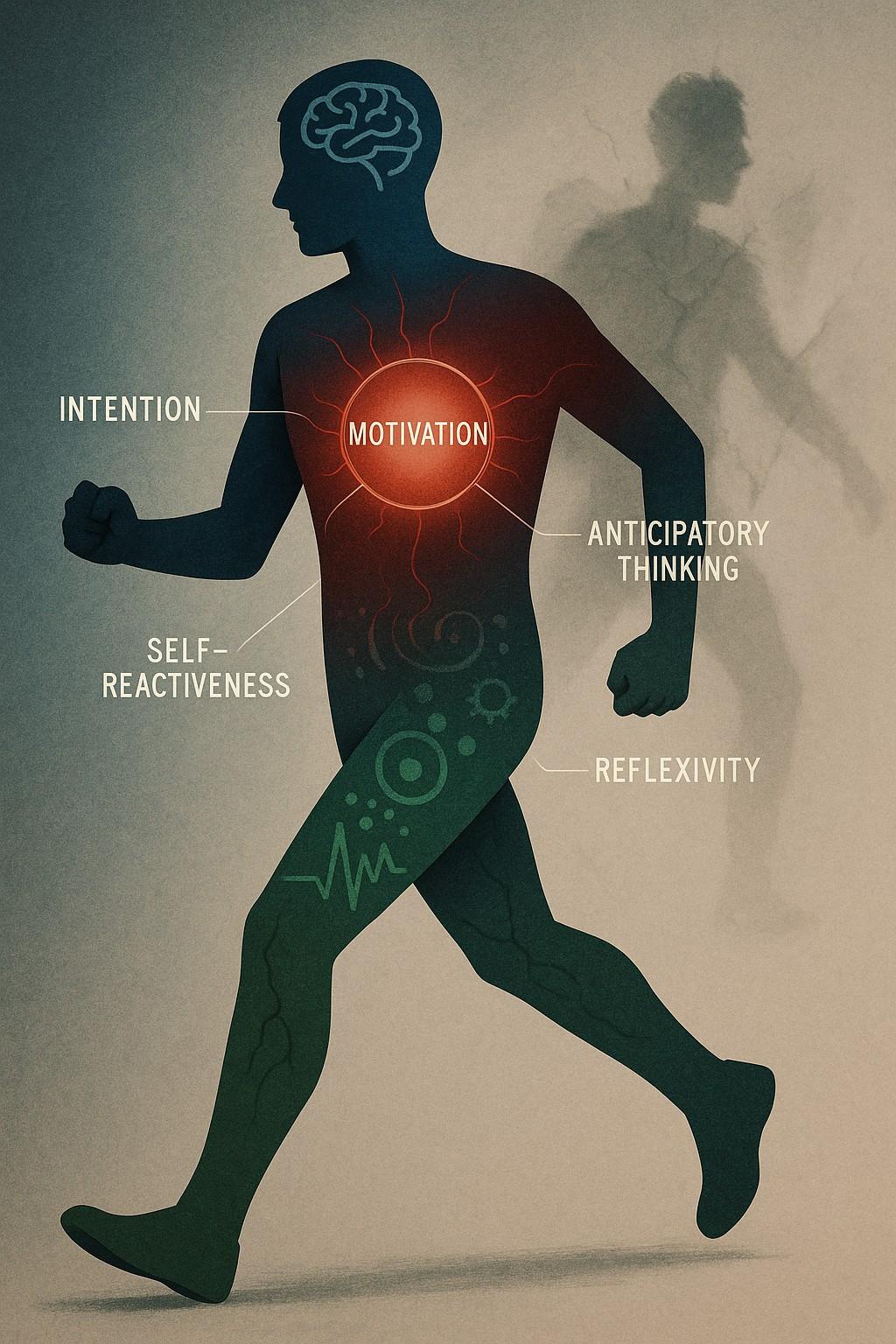
Narcissique extraverti ou introverti ?
Le 21/04/2025
Tous les narcissiques ne sont pas de grandes gueules extraverties, il existe aussi des manipulateurs cachés dans la plupart des cercles sociaux.
Il semble que le nombre de narcissiques ait très fortement augmenté et c’est devenu une sorte de label dont certain(e)s se servent concernant leur ex, leur patron, même certains membres de leur famille.
On pense tous avoir déjà rencontré un narcissique (qui relève de la pathologique psychiatrique bien sûr) mais il n’est pas si évident à identifier que ça, selon de récentes recherches. La pathologie narcissique affecte environs 1 personne sur 20, c’est une estimation. Ils ont un sentiment de grandeur, de supériorité et possèdent un faible niveau d’empathie. Ils ont besoin qu’on les admire constamment et se montrent facilement cassant.
Il est d’autant plus difficile à débusquer qu’il existe un autre type de narcissiques dits « vulnérables », qui ne sont pas dans l’extériorisation, l’arrogance, ni la grandiloquence. Ce sont plutôt des personnes introverties, pas habilles socialement, insécures, sur la défensive et angoissées. Ils essaient constamment de cacher leurs failles, leur tristesse. « Il a tendance à être fragile et ne peut pas faire de critique, » explique Hart (an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton).
Contrairement à leurs pairs, les narcissiques vulnérables sont convaincus qu’ils n’ont pas le statut social qu’ils méritent alors que ce n’est pas une volonté de leurs pairs. Il n’est pas question pour eux d’être en compétition s’ils sont convaincus qu’ils vont perdre. « Ça provoquerait un stress accru et un fort sentiment de honte, » dit Hart.
Les narcissiques vulnérables sont moins enclin à fantasmer sur leur supériorité, cependant leur réaction défensive peut être violente en cas de critique, et vous ne savez pas à quel moment ils vont exploser, et ça se fera derrière votre dos, lorsque vous ne vous y attendrez pas. Ils ne se contentent pas de collecter quelques informations personnelles sur vous pour s’en servir contre vous. Pour y arriver, ils vont vous confier des informations personnelles sur eux, vraies ou pas, mais ça vous donnera l’impression qu’ils sont dignes de confiance et donc de confidences. Manipulation !
De toute évidence, les deux types ont tendance à répondre aux personnes qui les entourent de manière antagoniste – des niveaux élevés de narcissisme ont été liés à l’intimidation, à la violence et à l’agression, directe et indirecte. Mais le narcissique vulnérable peut le faire pour des raisons différentes de celles du grandiose. « Ils peuvent intimider ou perpétrer de la violence parce qu'ils sont incertains d'eux-mêmes, » dit Hart.
Dans une relation avec l’un d’eux, sans surprise, les narcissiques grandioses sont toujours à l’affût de quelqu’un de mieux – ils ont l’impression de mériter le meilleur – ce qui conduit souvent à tricher, à mentir. « Les narcissiques vulnérables ont toutefois tendance à être beaucoup plus nécessiteux, mais peuvent aussi contrôler et manipuler de manière moins évidente, » explique Hart.
Vous êtes probablement convaincu que quelqu'un dans votre vie est un narcissiste déguisé, plein de force et sans filtre, cependant ils ne sont peut-être pas affectés par un trouble de la personnalité, donc de la pathologie qui relève de la psychiatrie.
Il est important de garder à l'esprit que les traits narcissiques peuvent aller et venir, cela concerne chacun de nous en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui peut conduire à ce que les autres se trompent et nous prennent parfois pour des narcissiques pathologiques.
Il y a des circonstances qui font ressortir le pire en nous tous – déchaînant ce que la recherche appelle le « narcissisme contextuel ». Tout le monde existe quelque part sur le spectre. Les traits de personnalité narcissique peuvent devenir plus forts ou plus faibles au fil du temps, être déclenchés par certaines situations et s'exprimer différemment chez différentes personnes. Cela signifie que nous sommes tous narcissiques – dans une certaine mesure.
Contrairement aux personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique diagnostiqué, les personnes ayant des niveaux élevés de traits de personnalité narcissique peuvent être en mesure de composer avec ces tendances dans certaines situations, comme autour de leur famille.
Contrairement au trouble clinique, les traits narcissiques sont très communs, et ils le deviennent de plus en plus dans de nombreux endroits à travers le monde – certainement en rapport avec la prépondérance du rapport à l’image aujourd’hui, que dis-je, la suprématie de l’ego.
Une étude réalisée par l’équipe de Heym suggère que les narcissiques ont la capacité d'empathie, mais choisissent simplement d’en faire fi la plupart du temps. Et c'est logique, si votre principal intérêt est votre GRANDE et IMPORTANTE personne, et que vous êtes prêt à exploiter et tromper les autres pour vous améliorer, éteindre votre capacité d'empathie est un avantage.
Une équipe de chercheurs a suivi des enfants sur une période de deux ans et constaté que ceux dont les parents les surévaluaient, les louant d'être exceptionnels et supérieurs à d'autres enfants, étaient plus susceptibles de montrer par la suite des signes de narcissisme.
Ils ont également découvert que les enfants qui recevaient une rétroaction incohérente, parfois surévaluée, démesurée ou sous-évalués, étaient plus susceptibles de développer un narcissisme vulnérable. Aaahhh, les enfants rois…
J'insiste (encore !) mais il est important de rappeler de ne pas confondre la « perversion narcissique » et la « personnalité narcissique » qui, elle, est structurelle et qui est intégrée dans le manuel de diagnostic psychiatrique DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) et classée dans les « Troubles de la personnalité ».
Le trouble de la personnalité narcissique (donc la pathologie) se caractérise par au moins 5 de ces critères de diagnostics :
- Mégalomanie (sens exagéré de leur importance et de leurs talents),
- Une obsession de fantasmes de succès, d’influence, de pouvoir, d’intelligence, de beauté, ou d’amour parfait,
- La conviction d’être spécial et unique et de fréquenter uniquement des personnes hors normes,
- Un besoin inconditionnel d’être admiré,
- La conviction de disposer de droits sur l’autre,
- L’exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs,
- Un manque d’empathie,
- Sentiment que les autres les envient,
- L’arrogance et la fierté.
Si cinq ou plus de ces traits de personnalités deviennent chroniques et interfèrent avec la vie personnelle ou professionnelle, le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique est posé.
La perversion narcissique quant à elle décrit un comportement manipulateur et destructeur associé au narcissisme.
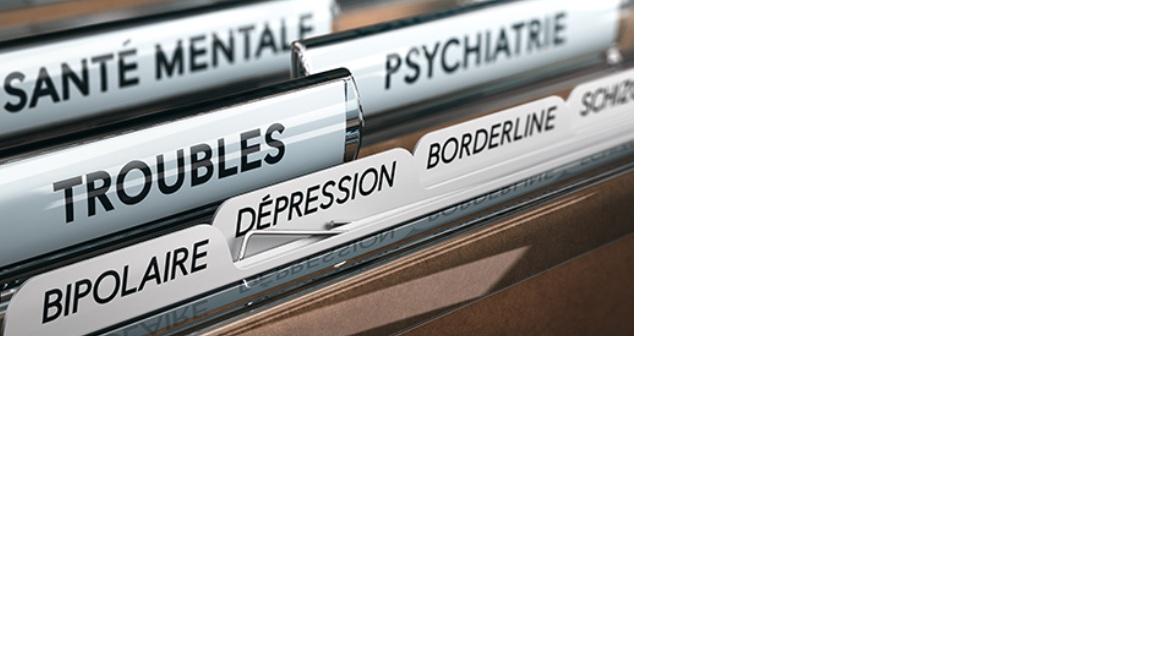
Source: « How to spot the 'covert narcissists' hiding in your life » Myriam Frankel, september 16, 2024, BBC Science Focus
About our experts
Dr Claire Hart is an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton. Her work has been published in Sex Roles, Computers in Human Behavior, and Journal of Personality Assessment.
Nadja Heym is an Associate Professor of personality psychology at Nottingham Trent University. Her work has been published in Psychology & Neuroscience, Current Opinions in Behavioural Sciences, and Forensic Science International: Mind & Law (to name a few).
Le passage à l'acte délictuel et criminel : entre déficit identitaire et clivage du Moi
Le 16/03/2025
L’adolescence est une période de transformations psychiques et biologiques intenses, marquée par des conflits internes et des réajustements identitaires. Pour certains individus, ces tensions peuvent conduire au passage à l’acte délictuel ou criminel, qui devient alors une tentative de résolution d’une impasse psychique.
Un évitement de la réalité
Les troubles dépressifs observés à l’adolescence sont souvent liés à une difficulté à accepter une réalité perçue comme décevante. L’individu, confronté à la frustration et à l’angoisse de la séparation (d’avec sa mère), peut se replier sur un univers fantasmé où persistent les imagos archaïques (ce sont des représentations psychiques souvent inconscientes du père, de la mère…).
Ces représentations façonnent l’inconscient et influencent la manière dont le sujet se positionne face au monde, face aux autres. Leur persistance sous des formes rigides peut générer une incapacité à s’adapter aux exigences de la réalité adulte, favorisant alors des comportements de rupture.
Une Identité Menacée
Freud a mis en évidence l’importance du conflit œdipien dans la structuration psychique de l’individu. Lorsque l’enfant ne parvient pas à intégrer ce conflit de manière satisfaisante, l’adolescence réactive ces tensions, créant une incertitude identitaire.
Un déficit d’intégration des identifications parentales peut alors mener à une perte de repères, souvent compensée par l’adhésion à des idéaux de groupe. Ce besoin de se raccrocher à une identité collective peut se traduire par un basculement vers des conduites délinquantes, la bande devenant un substitut aux figures parentales défaillantes. L’individu s’idéalise omnipotent et au-dessus de tous. L’agressivité tend à s’assurer une emprise/domination sur les autres qui sont vus comme des choses, des objets qu’il faut manipuler et maîtriser.
C’est une façon d’oublier l’absence de la mère, perçu comme un abandon, et la scène est rejouée de façon répétitive, sclérosant l’individu dans une position infantile victimaire, dénué d’intentionnalité et de goût pour l’effort. Cette mégalomanie est une défense contre l’autre qui est vu comme dangereux et son inversion en sentiment de dévalorisation en cas d’échec.
Symptômes et passage à l’acte
Dans certaines situations, la détresse psychique ne peut être mentalisée et se traduit par des comportements symptomatiques tels que la délinquance, la toxicomanie ou l’anorexie. Ces conduites permettent d’éviter une confrontation directe avec l’angoisse, en maintenant un clivage/séparation inconsciente du Moi.
Le clivage du Moi se manifeste par la coexistence de deux parties psychiques :
- L’une conforme aux exigences de la réalité extérieure,
- L’autre soumise aux pulsions archaïques.
Ce clivage explique la répétition compulsive des actes transgressifs, où l’acte prend le relais du langage pour exprimer une souffrance indicible. Le passage à l’acte est une annulation de la réalité psychique et des angoisses infantiles.
Une absence de symbolisation
Chez certains adolescents présentant une personnalité de type « psychopathique », on observe une inaffectivité marquée et un déficit dans la structuration des processus symboliques. L’absence de cadre interne (absence du père bien souvent et/ou mère ambivalente, non sécurisante) stable entraîne :
- Une impulsivité incontrôlée,
- Une mythomanie compensatoire,
- Une agressivité primaire mal canalisée,
- Une pauvreté fantasmatique, réduisant les capacités d’élaboration psychique.
Le phénomène de bande vient alors renforcer des identifications superficielles où le sujet fonctionne « comme si » il incarnait un personnage dans un jeu de rôle, sans réelle intégration subjective.
Le passage à l’acte comme solution ultime
L’agressivité, dans sa dimension primitive, est une réponse à l’angoisse de séparation avec la mère. Elle devient un mécanisme de défense contre l’angoisse d’abandon et l’effondrement narcissique.
Pour rappel, l’enfant transfert normalement cette angoisse vers l’adoption d’une peluche par exemple. Cet objet est ainsi sensé symboliser la mère absente et a pour vocation de rassurer l’enfant.
Dans les cas les plus graves, notamment dans les structures psychopathiques ou psychotiques froides, la relation à l’objet se fétichise. Le passage à l’acte ne vise plus seulement à exprimer une tension interne, mais à vérifier sa propre existence par le biais d’un objet/personne externe. L’acte devient alors un moyen de pallier une faille narcissique insupportable.
Le passage à l’acte est une tentative de résolution psychique
Loin d’être un simple dysfonctionnement social, le passage à l’acte délictuel ou criminel traduit souvent un échec des processus d’identification et de symbolisation. Pris dans une impasse psychique très angoissante, l’individu trouve dans l’acte un exutoire à ses tensions internes, un moyen de réaffirmer son existence face à un monde perçu comme hostile ou indifférent.
Que dit la réalité des chiffres ?
En 2004, 500 000 personnes ont fait l'objet d'une condamnation pour un délit ou une contravention « grave », inscrite dans le casier judiciaire. Parmi eux, quatre sur dix ont déjà des antécédents judiciaires au moment de la condamnation de 2004.
Entre 2004 et 2011, si l'on exclut les infractions à la circulation routière, qui constituent un cas de récidive fréquent et atypique, 38 % des condamnés ont récidivé. Ce taux de récidive atteint 59 % pour les condamnés présentant des antécédents judiciaires. Environ 40 % des récidivistes retournent devant la Justice pour la même infraction que celle sanctionnée en 2004.
La récidive est très fréquente chez les jeunes, voire très jeunes, délinquants : six condamnés sur dix en 2004, mineurs au moment des faits reprochés, ont récidivé avant 2011.
Entre 2000 et 2010, le parquet a joué un rôle de plus en plus important dans la justice pénale des mineurs, comme dans celle des majeurs. Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses mesures alternatives aux poursuites ont été développées, permettant à la fois d’accroitre la réponse pénale et de soulager les juridictions des infractions les moins graves. Les alternatives aux poursuites constituent ainsi plus de 50 % de la réponse pénale à l’encontre des auteurs mineurs depuis 2004 et 63 % en 2020 contre 46 % pour les auteurs majeurs.
L’emprisonnement, ferme ou assorti, en tout ou partie, d’un sursis, est la peine la plus souvent prononcée et concerne une condamnation de mineurs sur trois (35 % en 2020). La durée des peines d’emprisonnement ferme s’est allongée depuis dix ans : le quantum moyen d’emprisonnement ferme prononcé est passé de 5,5 mois en 2010 à 9 mois en 2020.
Les mesures et sanctions éducatives n’impliquant pas de suivi éducatif représentent toujours en 2020 une part importante des peines et mesures principales prononcées par les juges et tribunaux pour enfants (40 %), même si elles ont décliné (46 % en 2005) au profit de mesures entraînant un suivi, comme la mise sous protection judiciaire.
La récidive des mineurs primo-condamnés est restée relativement stable, plus d’un mineur sur deux condamnés pour la première fois entre 2005 et 2012 a récidivé. La récidive est relativement rapide, 70 % des récidivistes ont récidivé en moins de deux ans. (Source : Info Stat Justice 30/06/2022, mis à jour le 14/07/2024).
En 2020, les alternatives aux poursuites ont concerné 61 600 affaires, et 63 % de ces alternatives étaient des rappels à la loi. Cette mesure, la plus légère, permet au procureur de la République de rappeler au mineur auteur des faits les obligations résultant de la loi malgré l’absence de poursuite (source : Info Stat Justice n°186 – 2000 2020 : un aperçu statistique du traitement pénal des mineurs).
Prendre une décision sur la base de l'intuition ou de la réflexion ?
Le 25/01/2025
Focus sur : « La Force de l'intuition » de Malcolm Gladwell
Gladwell explore la manière dont notre esprit prend des décisions rapides et intuitives, souvent en quelques secondes, et comment ces jugements peuvent être aussi fiables, voire plus, que des décisions réfléchies et analytiques. Gladwell introduit le concept de « thin-slicing », qui désigne notre capacité à saisir l'essence d'une situation ou d'une personne en se basant sur de brefs instants ou des informations limitées.
Gladwell illustre cette idée à travers diverses anecdotes et études. Par exemple, il mentionne le chercheur John Gottman, capable de prédire avec une précision de 90 % si un couple va divorcer en analysant seulement 15 minutes de leur conversation. Gottman et Amber Tabares, une de ses étudiantes, ont remarqué que chez les couples qui devaient par la suite divorcer, quand l’un des conjoints demandait à l’autre de l’approuver, il n’obtenait jamais satisfaction. Chez les couples plus heureux, au contraire, le conjoint répondait à la demande en disant simplement « oui, oui » ou en hochant la tête.
Gladwell souligne également que ces jugements instantanés sont souvent inconscients. Il cite l'exemple de l'entraîneur de tennis Vic Braden, qui pouvait prédire quand un joueur commettrait une double faute avant même que le service ne soit exécuté, sans pouvoir expliquer comment il arrivait à cette conclusion. Cela démontre que notre subconscient joue un rôle majeur dans nos décisions rapides.
Attention aux biais
Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers potentiels de ces jugements intuitifs, notamment lorsqu'ils sont influencés par des stéréotypes ou des préjugés inconscients. Il aborde le concept de « priming » psychologique, où des associations subconscientes peuvent affecter nos perceptions et décisions.
Gladwell discute également de la notion de « paralysie par l'analyse », où un excès d'informations peut nuire à la qualité de nos décisions. Il affirme que, dans de nombreux cas, disposer de moins d'informations mais savoir identifier les éléments pertinents permet de prendre de meilleures décisions. Cette idée est illustrée par des exemples dans divers domaines, tels que la médecine, où des diagnostics basés sur des informations clés peuvent être plus précis que ceux fondés sur une multitude de données.
Dans le cadre de l’analyse des décisions intuitives, Gladwell fait écho au modèle RPD (Recognition-Primed Decision), un cadre développé par le psychologue Gary Klein pour expliquer comment les experts prennent des décisions dans des situations complexes ou stressantes. Ce modèle repose sur l’idée que les décisions intuitives ne sont pas des actes de hasard, mais le fruit de la reconnaissance rapide d’un schéma familier dans une situation donnée. Lorsqu’une personne expérimentée est confrontée à un problème, son cerveau identifie immédiatement une solution en se basant sur des expériences similaires passées, sans qu’il soit nécessaire de comparer systématiquement toutes les options. Ce processus d’intuition experte permet des réponses rapides et adaptées, particulièrement dans des domaines où le temps est un facteur critique, comme la médecine d’urgence, la gestion de crise, ou encore les opérations militaires.
Quels champs d’application ?
Les champs d’application du modèle RPD sont variés. Le RPD intervient dans un contexte où la contrainte de temps est importante, où il est nécessaire d’avoir de l’expérience opérationnelle, dans des conditions dynamiques avec des objectifs non quantifiables.
Par exemple, les pompiers qui évaluent une scène d’incendie peuvent, en quelques secondes, identifier le danger principal et ajuster leurs actions en conséquence. De même, un chirurgien chevronné peut instinctivement détecter une complication potentielle au cours d’une opération grâce à des signaux subtils qu’un novice pourrait ignorer. Ce modèle met en lumière l’importance de l’expérience dans l’efficacité des décisions intuitives, tout en soulignant que les erreurs peuvent survenir lorsque des biais ou des préjugés influencent le jugement initial.
En résumé
Le modèle RPD complète l’analyse de Gladwell en démontrant comment les décisions rapides reposent sur une base solide d’apprentissage et de reconnaissance, en s’avérant souvent supérieures dans des environnements dynamiques et exigeants.
Mais allons encore plus loin, jusqu’à Husserl
La corrélation entre la force de l’intuition de Malcolm Gladwell et l’intentionnalité de Husserl est une réflexion fascinante qui lie deux domaines apparemment distincts : la psychologie intuitive et la phénoménologie.
L’intentionnalité chez Husserl
L’intentionnalité, au cœur de la phénoménologie d’Edmund Husserl, désigne le fait que toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Cela signifie que la pensée humaine n’est jamais isolée ou abstraite, mais qu’elle vise toujours un objet ou une situation spécifique. Pour Husserl, cette orientation intentionnelle n’est pas seulement un acte mental délibéré, mais aussi une manière dont notre esprit se dirige spontanément vers le monde, en saisissant les phénomènes dans leur immédiateté.
Intuition dans La Force de l’intuition
Chez Gladwell, l’intuition est décrite comme une capacité du cerveau à prendre des décisions rapides en s’appuyant sur des signaux inconscients et des expériences passées. Cette forme de cognition repose sur une saisie immédiate de l’essence d’une situation (le "thin-slicing"), souvent sans analyse consciente détaillée.
La corrélation : une saisie intuitive de l’essence
Ces deux perspectives peuvent se rejoindre dans l’idée que l’intuition, comme l’intentionnalité, est un mode de rapport immédiat au monde :
1. Saisie directe de l’objet : L’intuition de Gladwell peut être vue comme une application pratique de l’intentionnalité husserlienne, dans laquelle l’esprit, dirigé vers un phénomène, en capte l’essence essentielle sans médiation analytique. Par exemple, un expert en art peut reconnaître instinctivement un faux tableau, tout comme l’intentionnalité husserlienne permet de saisir directement les qualités d’un phénomène.
2. Pré-réflexivité : Husserl souligne que de nombreuses perceptions intentionnelles se déroulent sans réflexion consciente. De la même manière, Gladwell montre que l’intuition opère souvent en arrière-plan, mobilisant des processus inconscients basés sur des expériences accumulées.
3. Le rôle du contexte : Dans les deux approches, le contexte joue un rôle clé. Husserl insiste sur le fait que chaque intention est ancrée dans un horizon de signification, tout comme Gladwell démontre que l’intuition se nourrit des expériences vécues dans des contextes particuliers.
Applications communes
1. Psychologie : En psychologie appliquée, les deux notions renforcent l’idée que nos jugements ne sont jamais neutres ou désincarnés. Ils sont enracinés dans notre expérience du monde et influencés par l’environnement et le vécu.
2. Éthique et prise de décision : La réflexion sur l’intentionnalité peut éclairer les limites de l’intuition. Par exemple, si une intuition est biaisée par des stéréotypes (comme Gladwell le montre), elle pourrait être réexaminée à travers l’analyse intentionnelle husserlienne pour mieux comprendre les structures qui influencent ce jugement.
3. Phénoménologie de l’action : Les deux approches mettent en lumière la manière dont nos actions (qu’elles soient intuitives ou réfléchies) sont toujours orientées vers une finalité, qu’elle soit consciente ou inconsciente.
En conclusion
L’intuition, telle que décrite par Gladwell, peut être interprétée comme une forme d’intentionnalité pré-réflexive. Là où Husserl se concentre sur la manière dont la conscience oriente et constitue les phénomènes, Gladwell explore les manifestations pratiques de cette orientation dans nos jugements rapides. Cette mise en relation ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre comment nos décisions intuitives sont enracinées dans notre expérience phénoménologique du monde.
Le triptyque de DS2C
Le 20/10/2024
DS2C s’est bâti sur un triptyque psychologique, véritable socle, véritable base pour analyser et décrypter les comportements humains. Charles Darwin, Frantz Brentano et Sigmund Freud sont cette base cruciale. Ils me permettent d’appréhender l’ensemble du fonctionnement humain et du passage à l’acte et de comprendre ce qu’il se trame dans l’esprit d’une personne qui fait ce qu’elle fait, quelles sont ses motivations.
Voyons comment la théorie de l'évolution de Darwin influence la psychologie descriptive et génétique de Brentano, et comment ces idées se connectent à la psychanalyse de Freud.
La théorie de l'évolution de Darwin
Charles Darwin, avec sa publication de "L'Origine des espèces" en 1859, a révolutionné notre compréhension de la biologie et de l'évolution. Sa théorie de la sélection naturelle propose que les espèces évoluent au fil du temps par le biais de mécanismes adaptatifs. Les individus qui possèdent des traits favorables à leur survie et reproduction sont plus susceptibles de transmettre ces traits à leur descendance. Cette théorie a non seulement transformé la biologie, mais a également eu des répercussions profondes sur la psychologie.
L'impact de Darwin sur la psychologie
La théorie de Darwin a encouragé les psychologues à envisager l'esprit humain comme un produit de l'évolution. Des concepts tels que l'instinct, le comportement adaptatif et la fonction des émotions ont été intégrés dans les études psychologiques. La psychologie évolutive, qui émerge plus tard, se base sur l'idée que de nombreux aspects du comportement humain peuvent être compris à travers le prisme de l'évolution.
Frantz Brentano et la psychologie descriptive
Frantz Brentano, philosophe et psychologue autrichien, a développé une approche unique de la psychologie. Dans son œuvre majeure, "Psychologie from an Empirical Standpoint", Brentano propose une psychologie descriptive qui se concentre sur l'expérience subjective. Il insiste sur l'importance de l'intentionnalité, l'idée que les états mentaux sont toujours dirigés vers quelque chose. Cette approche se distingue par sa volonté de décrire les phénomènes psychologiques sans recourir à des explications biologiques ou physiologiques.
Brentano a également introduit la notion de psychologie génétique, qui examine le développement des états mentaux au fil du temps. Il s'intéresse à la manière dont les expériences individuelles et les processus psychologiques évoluent, ce qui établit un lien avec la théorie de l'évolution de Darwin. En effet, tout comme les espèces évoluent, les états mentaux et les comportements humains se développent et s'adaptent en réponse à l'environnement.
La psychanalyse de Freud
Sigmund Freud, souvent considéré comme le père de la psychanalyse, a également été influencé par les idées évolutionnistes. Dans ses théories, Freud propose que les comportements humains sont souvent motivés par des pulsions inconscientes, notamment des désirs sexuels et agressifs. Il introduit des concepts tels que le ça, le moi et le surmoi, qui décrivent les différentes instances de la psyché humaine.
Freud a intégré des idées darwiniennes dans sa conception de la sexualité et des instincts. Il a suggéré que les pulsions humaines, tout comme les traits évolutifs, sont le résultat de processus adaptatifs qui ont été façonnés par l'évolution. La lutte pour la survie, l'angoisse et les conflits internes sont des thèmes récurrents dans son œuvre, soulignant l'importance de l'évolution dans la compréhension de la psyché humaine.
Liens entre les théories
Les liens entre la théorie de l'évolution de Darwin, la psychologie de Brentano et la psychanalyse de Freud se manifestent dans plusieurs domaines clés :
1. **L'évolution et la psychologie** : Les trois penseurs reconnaissent que les comportements et les états mentaux humains sont influencés par des facteurs évolutifs. Darwin établit le cadre de l'évolution, Brentano décrit les processus mentaux, et Freud explore les motivations inconscientes.
2. **L'intentionnalité et les pulsions** : Brentano met en avant l'idée que les états mentaux sont intentionnels, tandis que Freud souligne que ces états sont souvent motivés par des pulsions inconscientes. Cette intersection offre une compréhension plus nuancée de la psyché humaine.
3. **Le développement et l'adaptation** : La psychologie génétique de Brentano et les théories de Freud sur le développement psychologique mettent en lumière comment les individus s'adaptent à leur environnement, un concept central dans la théorie de l'évolution.
En conclusion
Les contributions de Darwin, Brentano et Freud ont façonné notre compréhension de la psychologie moderne. En reliant la théorie de l'évolution aux processus psychologiques, ces penseurs ont ouvert la voie à une exploration plus profonde de la nature humaine. Leur héritage continue d'influencer les recherches contemporaines en psychologie, soulignant l'importance des facteurs biologiques et évolutifs dans la compréhension de l'esprit humain.
DS2C reste à votre disposition pour une MasterClass sur l’analyse comportementale (2h), mais DS2C c’est aussi décrypter et analyser le fonctionnement, le passage à l’acte et la communication non-verbale d’un individu.
Pour toute information, contactez moi par mail : frantz.bagoe@gmail.com ou par téléphone au 06 13 68 38 65.
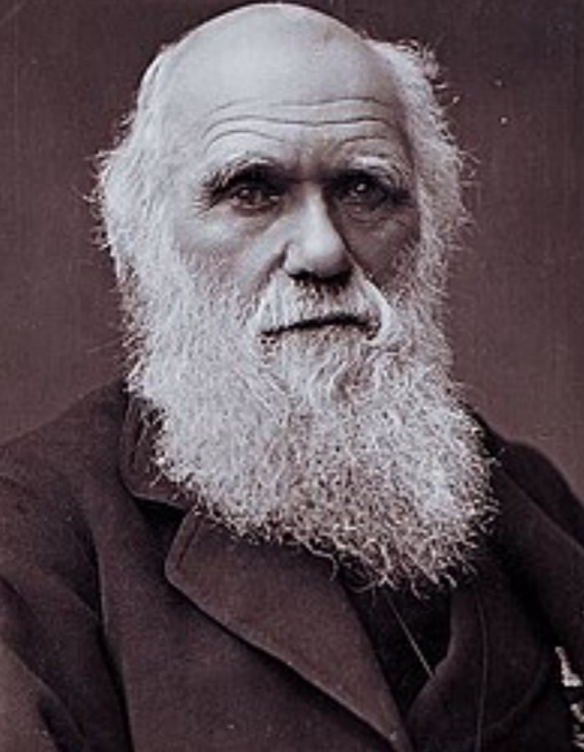
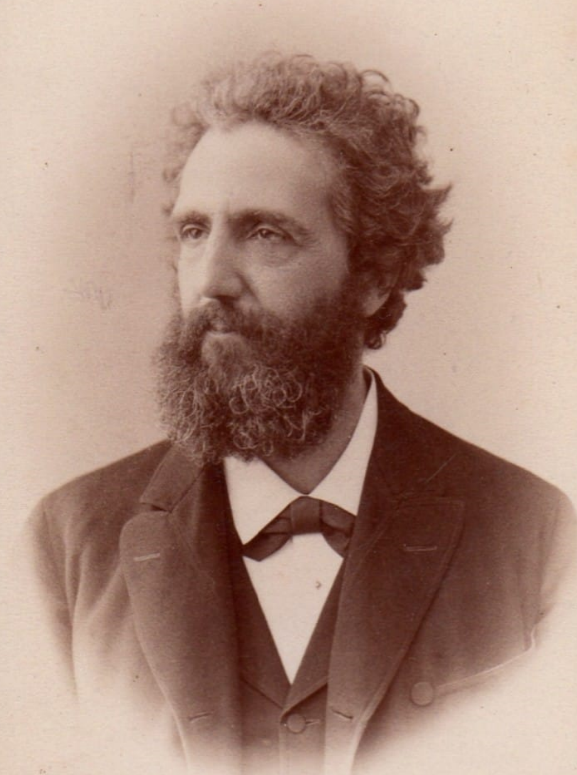
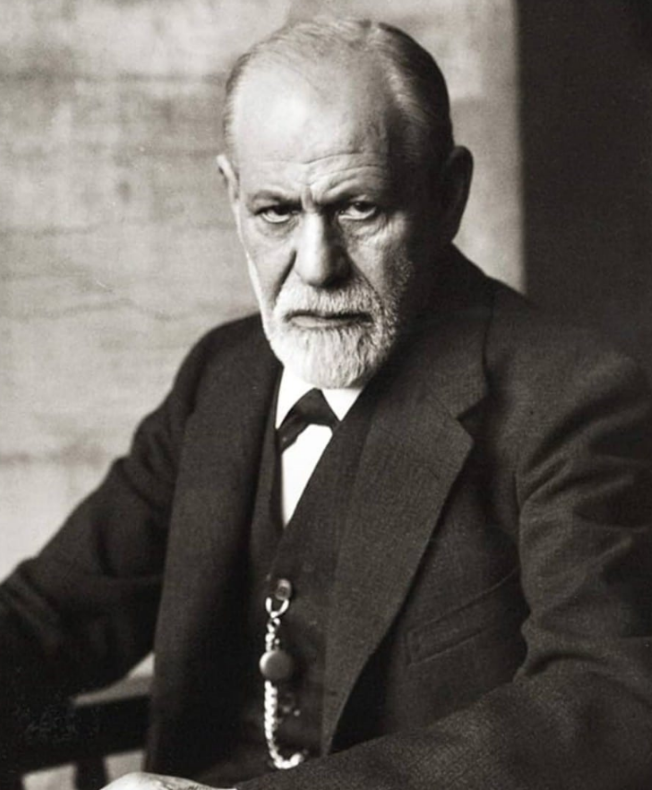
La théorie de la contrainte non choisie, où : pourquoi dire "non" ?
Le 09/05/2024
Il existe un lien de cause à effet entre ne pas savoir dire « non » et le harcèlement moral et affectif.
Ce lien, nous le subissons tous mais à divers degrés. C’est pour cela que certaines personnes sont plus affectées que d’autres.
Ce lien est subtil, implicite, ténu voire malsain. C’est ce que j’appelle la théorie de la contrainte non-choisie. C’est le fait d’imposer à l’autre une tâche, un service alors qu’il existe d’autres possibilités. C’est rendre l’autre redevable pour se déresponsabiliser et se placer en position de dominant, pour avoir un ascendant sur l'autre.
Par exemple, un petit groupe de personnes reviennent d’un café et l’une d’elles (personne A) demande à une autre (personne B) de lui déposer son téléphone et son gobelet de boisson à son bureau, le temps qu’elle se rende aux toilettes. Ça s’apparente à un service tout à fait banal, mais l’autre possibilité eut été que la personne A dépose elle-même ses affaires à son bureau pour aller ensuite aux toilettes, sans avoir à solliciter la personne B.
Si la personne B accepte de rendre ce service, elle accepte alors implicitement une relation de subordination qui se répètera forcément parce qu’elle sera vue comme serviable. Sauf que si ce type de services se multiplie, cela provoquera un stress chez la personne A qui pourrait devenir délétère à la longue.
Autre exemple avec les aventuriers de Koh-Lanta, lorsqu’au moment des nominations l’un des aventuriers dit à un autre : « j’ai éliminé 2 amis à moi alors que ça me déchirait le cœur. Là, je te demande simplement aujourd’hui de faire la même chose avec untel. »
Ce type de demande crée un lien de subordination insidieux qui vous place en position de devoir effectivement réaliser ce service pour l’autre. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, l’autre n’est pas démuni d’un intérêt personnel, d’une intention qui est manipulatrice pour autant qu’elle n’ait pas d’autre solution que de vous solliciter.
La racine du mot « contrainte » est CONSTRINGERE qui désigne ce qui est enserré par des liens, enchaîné, entravé, dominé. Une contrainte, ce sont des règles attribuées auxquelles le sujet doit se conformer, qui lui indiquent ce qu’il doit ou ne doit pas faire. « La notion de contrainte implicite met l’accent sur les inférences du sujet à partir d’une activité de compréhension des contraintes explicitent (cairn.info). »
Une contrainte choisie rend la personne qui l’accepte actrice de son choix, c’est intentionnel. L’inverse lui confère un rôle passif, de soumission car ce sera un choix non intentionnel.
C’est facilement compréhensible lorsque vous devez signer un contrat de travail ou un prêt financier.
Savoir dire « non » vous permet de ne pas accepter le stress inhérent et possiblement les conséquences qui peuvent en résulter. C’est vous protéger.

Narcisse ou Don Juan ? Perversion ou perversité ?
Le 30/12/2023
Nous sommes tous, à un moment donné, dans une dynamique de séduction avec l’autre et quelque soit l’environnement, le contexte et c’est normal, c’est bien, c’est la vie, c’est le jeu des relations sociales. Une fois cet apophtegme, ce précepte posé, il est important de ne pas sombrer dans l’excès.
Savoir analyser et reconnaître lorsqu’il y a un excès dans ce fonctionnement va vous permettre une meilleure maîtrise de la situation.
Voyons cela…
Une personnalité narcissique devient pathologique lorsque les traits du comportement altèrent le quotidien. Elle se classe en deux catégories :
- par excès d’amour de soi (mégalomanie),
- par insuffisance d’amour de soi.
Le narcissisme pathologique se caractérise par le besoin d’être admiré par les autres pour réparer une carence de son amour pour soi. Donc besoin de séduire l’autre mais ce qui ne veut pas forcément dire passage à l’acte, d’où la différence entre Narcisse et Don Juan.
Il y a donc une érotisation de l’autre d’un côté et une sexualisation de l’autre d’un autre côté. Narcisse est la duplication de l’image de soi dans l’autre pour se rassurer alors que Dom Juan accepte de passer par l’acte pseudo-sexuel pour satisfaire son besoin de maîtrise.
Cependant, ni l’un ni l’autre ne peuvent supporter l’idée que l’autre les asservisse à son propre narcissisme à elle. Ils veulent avoir la main sur l’autre, garder le contrôle.
A la suite de cette séduction narcissique, la personne “objet” peut être triple :
- la personne séduite n’a aucune “originalité” et peut se contenter d’une relation pseudo amoureuse. Elle ne tient pas plus que ça à cette relation et sait y mettre un terme le moment venu, laissant le séducteur libre de répéter son schéma avec une autre personne “objet”.
- la personne séduite est, elle aussi, une carencée narcissique. Lorsque la magie de la rencontre opère et qu’elle aura contenté les deux Narcisses alors chacun pourra reprendre son chemin. Mais chacun est aussi libre de conduire le même schéma parallèlement à la relation.
- enfin, il se peut que la personne séduite ait l’espoir d’une pleine relation et devienne ainsi exigeante d’un point de vue investissement personnel.
La personnalité pathologique narcissique se croit unique, spéciale, et a un besoin excessif d’être admirée et croit que tout lui est dû. Elle entretient des fantasmes irréalistes et idéalisés de pouvoir, de succès, d’amour ou de beauté.
Pour distinguer ces deux personnalités - lorsqu’elles sont à un niveau pathologique, j’insiste - et faire la différence entre la maladie (perversion) et le vice (perversité), il est nécessaire d’effectuer un examen complet de l’individu (anamnèse) et du mobile de son comportement. La recherche de cette différence est fondamentale en matière judiciaire parce qu’elle permet l’imputation des responsabilités. Seuls les professionnels de la santé mentale sont capables de le faire.
Mais brièvement, la perversité renvoie au plaisir de manipuler l’autre pour avoir une emprise. Il n’y a pas de satisfaction sexuelle dans la perversité.
La perversion, quant à elle, fait référence à une pathologie nommée paraphilie. Il s’agit d’une structure de la personnalité qui renvoie classiquement à des conduites sexuelles déviantes (je vous laisse le soin de rechercher ce qu’est une conduite sexuelle déviante).
Il est important pour tout à chacun d’avoir conscience du rôle qu’il joue dans sa relation avec l’autre et que l’autre joue avec soi. Analyser froidement la situation, en mettant de côté ses émotions, va permettre une meilleure authenticité et surtout de mener sa barque comme VOUS l’entendez.
A vous de jouer…
La jalousie vue par la psychologie évolutionniste
Le 11/08/2023
La jalousie est une forme d’adaptation, une solution développée au fil du temps en réponse à un problème récurrent qui menace la pérennité de l’espèce. Elle nous pousse à tenir éloigné nos rivaux à distance. Elle empêche notre partenaire de s’éloigner grâce à une vigilance constante ou à un maximum d’affection. Elle induit l’idée d’engagement à un partenaire hésitant (jalousie hors pathologie évidemment).
Mais il faut faire la distinction entre la jalousie sexuelle et sentimentale. Les hommes sont plus enclins à s’imaginer faire l’amour à plusieurs partenaires mais sans engagement, alors que les femmes s’engagent dans une relation physique généralement lorsqu’elles ressentent des sentiments.
C’est une lapalissade que de dire que les femmes ont besoin de 9 mois pour produire un enfant, alors que les hommes n’ont besoin que de quelques minutes pour produire ce même enfant. L’investissement parental est donc biaisé dès le départ. « Un gouffre sépare donc l’effort consenti par les hommes des neufs mois que consacrent les femmes à l’éclosion d’une nouvelle vie » (Buss).
La stratégie d’unions occasionnelles est donc plus profitable, a priori, aux hommes qu’aux femmes sur le long terme, dans le but de multiplier ses gènes. Tout au moins pour ceux qui séduisent le plus grand nombre de partenaires plutôt que ceux qui ont un nombre limité de partenaires.
Pour celles qui choisissent néanmoins d’avoir plusieurs partenaires, le bénéfice perçu doit être suffisamment important pour justifier la prise de risque et ses conséquences.
Un premier avantage est le gain de ressources fourni par ses partenaires occasionnels (diners, cadeaux, sorties, voyages…).
Un second avantage est un bénéfice génétique. Les femmes choisissent généralement pour amant des hommes plutôt symétriques et en bonne santé, gage de transmission de patrimoine génétique sain. Les femmes qui ont aussi des amants sont aussi celles qui sont susceptibles de produire des enfants avec une plus grande diversité génétique.
Un troisième avantage est ce que David Buss appelle l’« assurance partenaire ». C’est-à-dire la possibilité de se remettre avec quelqu’un rapidement en cas de défaillance du premier (maladie, décès, guerre, séparation…). Baher et Bellis (« Human sperm competition », 1995) ont montré que les femmes infidèles ont tendance à faire coïncider leurs aventures extra conjugales avec leur période d’ovulation, alors que les relations sexuelles avec leur mari le sont en dehors de cette période. Il a été également constaté que la rétention du sperme est plus importante avec l’amant que le mari.
Pour quelles raisons avoir une relation extra conjugale ?
Avant d’apporter une réponse Darwinienne, replaçons le couple à notre époque individualiste. Hommes et femmes vont voir ailleurs parce que les uns comme les autres ne trouvent pas leur compte dans leurs relations sexuelles. Ce peut être en termes de quantité, en termes de qualité, de désir ou encore dans l’éventail des positions et/ou des pratiques acceptées, toute paraphilie mise de côté. Lorsque l’un ou l’autre se trouve lésé ou non contenté, il peut gérer la frustration jusqu’à un certain seuil au-delà duquel il y a un risque potentiel. Il est donc important d’être à l’écoute de l’autre et de son plaisir.
Suite aux divers travaux de David Buss et ses collègues, les stratégies reproductrices reposent sur le court terme et sur le long terme. Pour le court terme, les hommes veulent une variété de matrices pour multiplier les possibilités de produire des enfants (en plus de la diversité recherchée des pratiques sexuelles). Pour les femmes, c’est la possibilité de multiplier la variété génétique (en plus de la diversité des pratiques sexuelles).
Les critères de préférence dans le choix d’un partenaire pour le long terme sont pour les femmes le statut social, la capacité de travail et les perspectives financières. Il est donc plus profitable pour une femme d’épouser un homme moins beau que la moyenne mais qui saura lui apporter une stabilité émotionnelle, financière et qui saura prendre soin de leur progéniture.
Pour les hommes, c’est l’attrait physique qui compte et ce sont des critères universels, nonobstant quelques variations culturelles pour des critères comme le poids, la couleur des cheveux et la taille (Ford et Beach, 1951, « patterns of sexual behaviour », New York).
Mais pour qu’une relation dure, il faut des signes d’engagement, accorder du temps et des efforts, de l’attention de la part des deux partenaires. Après la fiabilité (critère partagé par l’homme et la femme), c’est celui de la maturité émotive qui est attendu avec un bon caractère (Buss et col., n = 9474 issus de 37 cultures différentes, 1990, « international preferences in selecting mates : a study of 37 cultures », Journal of psychology, 21, 5-47).
Une femme peut également se servir d’une liaison pour rompre avec son mari. Grâce à une estime de soi reboostée, un gain de confiance, une sensation de pouvoir encore séduire et jouir. Ce sera le premier pas vers l’autonomie.
Pourquoi la femme n’épouse-t-elle pas l’homme qu’elle a eu pour amant ?
Parce que dans le long terme, il n’est pas pourvoyeur de ressources stables, son investissement parental serait moins optimal que celui de son mari. D’autant que la décision de se mettre en couple est toujours une incertitude et que certains hommes profitent de cette incertitude pour multiplier les conquêtes et potentiellement un nombre important de « matrices ».
Les personnes jalouses se montrent très sensibles aux changements comportementaux et physiques, tout autant qu’aux indices laissés involontairement ici et là. La jalousie se déclenche souvent par des circonstances qui signalent une menace bien réelle pesant sur le couple. Lorsqu’on se pose la question, c’est qu’il y a déjà des signes avant-coureurs. Ça ne veut pas dire que la tromperie a été réalisée, mais l’envie et le désir sont là.
Daly et Wilson (Université de McMaster – Ontario) définissent la jalousie comme un « état déclenché par la perception d’une menace pesant sur une relation ou une position importante et qui motive un comportement destiné à contrer cette menace. »
Une émotion peut être vue comme une adaptation qui sert à identifier une menace. Cette émotion attire notre attention sur l’origine de la menace et stocke l’information dans notre mémoire, ainsi que le comportement qui s’ensuit.
Shackelford, Buss et Bennett (1999, « sex differences in responses to a partner’s infidelity ») ont montré que les hommes se sentent plus en détresse psychologique face à une infidélité sexuelle, alors que les femmes le seront face à une infidélité affective. L’homme se montrera plus agressif pour stopper la tromperie (33 féminicides depuis le début de l’année, 208 000 victimes en 2021, 87% de femmes) et la croyance de tromperie, la femme sera plus dans le déni, dans le rendu coup pour coup, ou dans l’acceptation du fait du coût de l’investissement.
La jalousie est donc un moyen de défense contre la tromperie et l’abandon. Il y a toujours de fausses alertes mais statistiquement, l’histoire nous montre que les signes précurseurs étaient déjà présents. Si l’on se montre à l’écoute de l’autre intellectuellement, émotionnellement et sexuellement, il n’y a pas de raison pour que l’on aille voir ailleurs. Mais cela suppose de l’abnégation et des efforts.