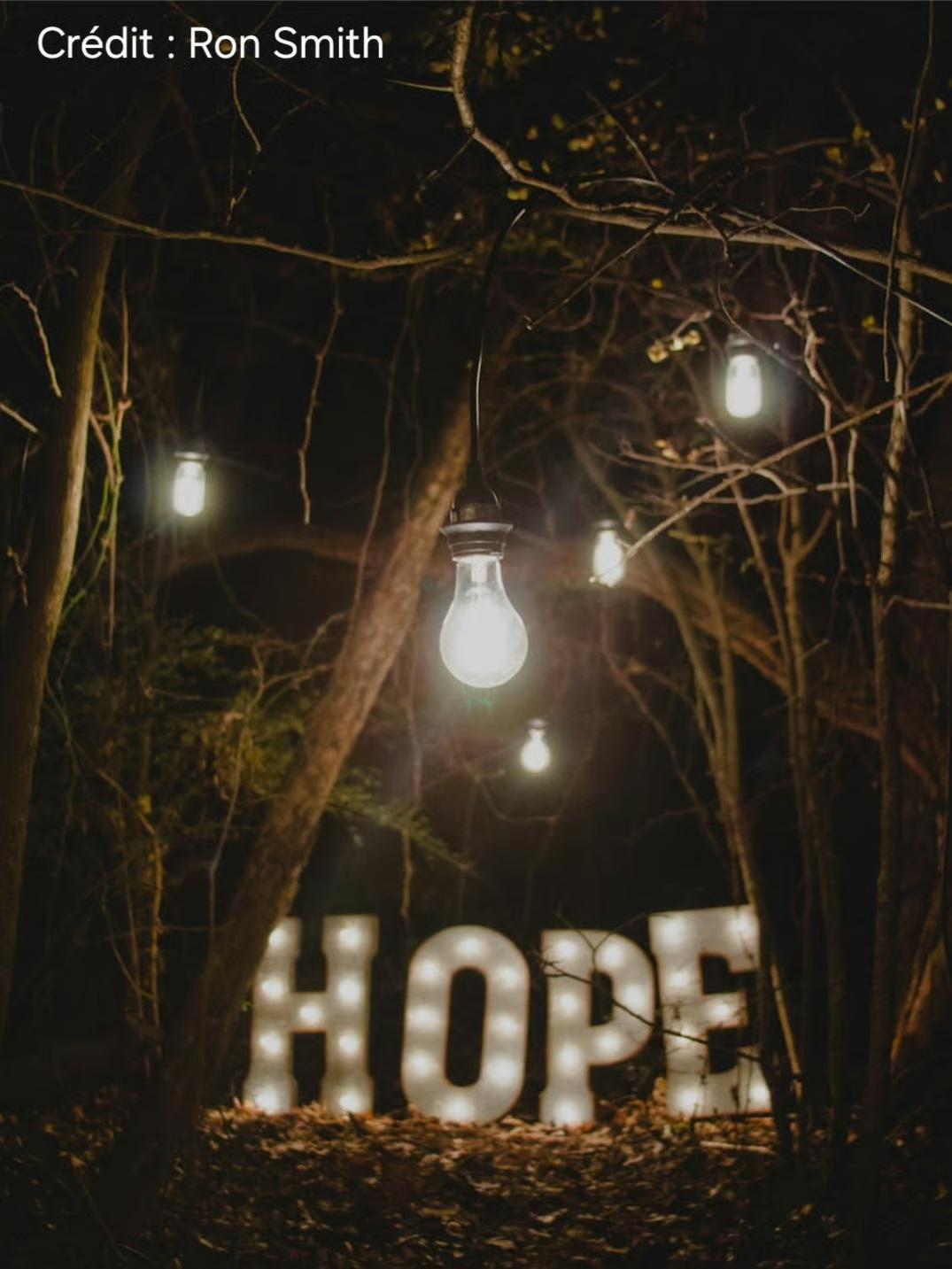L'angoisse du vide
Dans nos relations, nous pouvons souvent entendre cette plainte : "Je ne sers à rien", "Ma vie est vide", "À quoi bon ?". Ce n'est pas un hasard si les statistiques sur l'épuisement professionnel, la dépression et la quête de sens au travail explosent dans les sociétés occidentales. Derrière ces maux contemporains se cache une question fondamentale : comment exister quand on ne se sent utile à rien ni personne ?
Le sentiment d'inutilité n'est pas qu'un inconfort passager. C'est une menace existentielle qui peut mener à l'effondrement psychique. À l'inverse, se sentir utile - avoir l'impression que notre présence au monde produit quelque chose de valable - constitue un rempart puissant contre l'angoisse. Plus encore : c'est porteur d'espoir, car contrairement à d'autres besoins fondamentaux, nous disposons d'une certaine capacité à agir sur ce sentiment.
Explorons pourquoi l'utilité est un besoin psychique fondamental, comment elle se construit, quels pièges elle recèle, et surtout comment cultiver un sentiment d'utilité sain qui donne du sens à notre existence sans nous enfermer dans des défenses rigides.
L'utilité comme besoin fondamental
- Deux niveaux distincts
Il faut d'abord distinguer deux choses qui se confondent souvent : *être utile* et *se sentir utile*. Le premier relève d'une réalité objective - j'accomplis des tâches, je produis des effets, j'ai une fonction dans un système. Le second est une construction subjective - je me perçois comme ayant de la valeur à travers mes actions.
Ces deux dimensions ne se recouvrent pas toujours. On peut être objectivement utile (un soignant qui sauve des vies) tout en se sentant vide et insignifiant. À l'inverse, on peut se sentir profondément utile dans des activités dont l'utilité objective est questionnable. Ce qui compte pour l'équilibre psychique, c'est avant tout le sentiment subjectif, l'expérience vécue d'être agent productif dans le monde.
- Une perspective évolutionniste
D'un point de vue darwinien, la contribution au groupe a toujours représenté un avantage adaptatif majeur. Nos ancêtres qui participaient activement à la survie collective - chasse, cueillette, protection, soin aux enfants - avaient plus de chances de transmettre leurs gènes. Le besoin de se sentir utile pourrait donc être ancré dans notre architecture psychique comme mécanisme favorisant la coopération.
Cette lecture évolutionniste explique pourquoi l'exclusion du groupe, l'inutilité sociale, provoque une souffrance si intense. Être inutile, c'était historiquement être éjecté du groupe, donc condamné. L'angoisse que nous ressentons face à notre propre inutilité n'est peut-être que l'écho lointain de cette menace primordiale.
- Une défense mature
Du point de vue psychanalytique, l'utilité peut fonctionner comme une défense mature contre l'angoisse existentielle. Freud parlait de sublimation : transformer nos pulsions en réalisations socialement valorisées. Faire quelque chose d'utile, c'est donner forme à notre énergie psychique, la canaliser vers des buts constructifs plutôt que de la laisser se retourner contre nous en symptômes.
Bergeret distinguerait probablement les organisations de personnalité selon leur rapport à l'utilité. Une personnalité bien structurée peut investir des projets utiles avec souplesse, en tirant satisfaction de l'action elle-même. Une organisation plus fragile risque de faire de l'utilité un rempart désespéré : "je n'existe que si je sers". Dans le premier cas, c'est une défense mâture. Dans le second, une défense rigide qui peut se retourner en pathologie.
- Le caractère et ses projets
René Le Senne, philosophe du caractère, voyait dans les projets et réalisations le moyen par lequel la personne se construit et se définit. Le caractère n'est pas une essence figée, mais une structure dynamique qui se forge à travers ce que nous faisons du monde et ce que le monde fait de nous.
Être utile, dans cette perspective, c'est inscrire sa marque dans le réel. C'est sortir de soi pour agir sur l'environnement, et en retour être transformé par cette action. Le sentiment d'utilité serait alors le témoin subjectif de cette inscription réussie : je ne suis pas un spectateur passif, je suis acteur de ma propre existence et, modestement, de celle du monde.
- La transition nécessaire
Ces cadres théoriques - darwinien, psychanalytique, caractérologique - convergent vers une idée centrale : l'utilité répond à un besoin psychique profond. Mais ils ne disent pas comment, concrètement, on construit ce sentiment. Comment passe-t-on du besoin d'être utile à l'expérience effective de l'utilité ? C'est là qu'intervient un concept plus opérationnel : l'agentivité.
L'agentivité : le moteur de l'utilité
- Bandura et le sentiment d'efficacité personnelle
Le psychologue Albert Bandura a introduit un concept qui éclaire puissamment notre propos : l'agentivité (agency en anglais), ou sentiment d'efficacité personnelle (self-efficacy). Il s'agit de la capacité à se vivre comme cause de ses propres actions et de leurs effets sur le monde.
Ce n'est pas exactement "être utile aux autres". C'est plus fondamental : c'est produire des effets voulus, transformer le réel par son action, se percevoir comme agent causal plutôt que comme objet passif des événements. Vous pouvez être agent sans être utile à quiconque - un ermite qui construit sa cabane dans les bois fait preuve d'agentivité. Et inversement, vous pouvez être utile sans aucune agentivité - un esclave est utile à son maître mais ne choisit ni ses actions ni leurs finalités.
L'utilité devient porteuse de sens quand elle s'articule avec l'agentivité. Non pas "on se sert de moi", mais "je choisis d'agir et mes actions produisent des effets que je valorise". C'est cette combinaison - action + intention + effet + valeur - qui nourrit le sentiment d'utilité profond.
- Les quatre sources du sentiment d'efficacité
Bandura identifie quatre sources qui construisent notre sentiment d'efficacité personnelle :
- Les expériences de maîtrise : la plus puissante. J'ai réussi à faire quelque chose, j'en ai vu les résultats concrets. Cette expérience s'inscrit en moi et renforce ma conviction que je peux agir efficacement. Un parent qui voit son enfant progresser grâce à son accompagnement, un artisan qui contemple l'objet qu'il a fabriqué, un bénévole qui constate l'amélioration du lieu qu'il a nettoyé - toutes ces expériences nourrissent l'agentivité.
- Les expériences vicariantes : j'observe quelqu'un qui me ressemble réussir. Si elle y arrive, pourquoi pas moi ? C'est pourquoi les modèles identificatoires sont cruciaux. Voir d'autres personnes ordinaires accomplir des choses utiles élargit notre champ des possibles et stimule notre propre désir d'agir.
- La persuasion verbale : quelqu'un en qui j'ai confiance me dit que je suis capable, que mon action a de la valeur. Ce feedback externe peut renforcer temporairement le sentiment d'efficacité, à condition d'être crédible et étayé par des faits. Les encouragements vides ont peu d'effet ; la reconnaissance précise et ajustée, beaucoup.
- Les états physiologiques et émotionnels : quand je me sens calme, énergique, confiant, mon sentiment d'efficacité augmente. À l'inverse, l'anxiété, la fatigue, le stress le diminuent. C'est un facteur souvent sous-estimé : prendre soin de son état physique et émotionnel est une condition de l'agentivité.
- Le cercle vertueux action-maîtrise
Bandura décrit un cercle vertueux : le sentiment d'efficacité conduit à l'action, l'action à la maîtrise, la maîtrise renforce le sentiment d'efficacité. À l'inverse, le sentiment d'impuissance conduit à l'évitement, l'évitement à la perte de compétences, qui renforce l'impuissance. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise.
Le sentiment d'utilité s'inscrit dans cette dynamique. Quand je me vis comme agent efficace, j'ose entreprendre des actions utiles. Quand ces actions produisent des effets positifs, mon sentiment d'utilité se renforce. Quand ce sentiment est fort, j'ose davantage. Et ainsi de suite.
- L'antidote à la rumination
Pourquoi l'agentivité protège-t-elle de l'angoisse ? Parce que l'action structure, oriente, ancre dans le présent. L'angoisse, à l'inverse, se nourrit de rumination, d'anticipation catastrophique, de ressassement. Quand j'agis - vraiment, avec intention et attention - je sors de ma tête. Je suis confronté au réel, à ses résistances, à ses réponses. Je ne peux pas ruminer en même temps que je construis, répare, crée, soigne, enseigne.
Paul Watzlawick, théoricien de la communication, affirmait qu'on ne peut pas ne pas communiquer. De même, on ne peut pas ne pas agir - même l'inaction est une forme d'action. Mais l'agentivité, c'est agir *avec intention*, pas subir passivement le cours des choses. C'est ponctuer la séquence des événements en se positionnant comme sujet actif plutôt que comme objet passif.
- Du besoin à la pratique
L'apport de Bandura est de rendre opérationnel ce qui pourrait rester abstrait. Le besoin d'utilité ne se satisfait pas par décret ou par introspection. Il se construit par l'action répétée, par l'accumulation d'expériences de maîtrise, par le feedback du réel. Ce n'est pas "penser qu'on est utile", c'est *faire des choses utiles et en constater les effets*.
Cette perspective est libératrice : elle sort du registre du jugement moral ("tu devrais te sentir utile") pour entrer dans celui de la pratique ("que peux-tu faire aujourd'hui qui te donnera cette expérience ?"). C'est en cela qu'elle est porteuse d'espoir.
Les pièges et dérives
Mais attention. Le sentiment d'utilité, comme tout besoin psychique, peut déraper en pathologie quand il devient rigide, exclusif, désespéré. Il faut examiner les pièges pour mieux les éviter.
- Le paradoxe de la quête désespérée
Cliniquement, on observe un paradoxe cruel : ceux qui cherchent le plus désespérément à se sentir utiles deviennent souvent contre-productifs. Le codépendant qui anticipe tous les besoins de l'autre avant même qu'ils ne s'expriment, le collègue qui s'impose dans tous les projets pour "aider", le parent qui surprotège son enfant au point de l'étouffer - tous cherchent à se sentir indispensables et tous créent, à terme, de la dépendance, du rejet, de l'inefficacité.
Pourquoi ? Parce que leur "utilité" ne sert pas vraiment l'autre, elle sert leur propre besoin de se sentir nécessaires. L'autre le sent, consciemment ou non, et finit par fuir ou se rebeller. Certains ont tellement besoin de se sentir utiles qu'ils deviennent l'équivalent humain d'un spam : techniquement présents, objectivement superflus, subjectivement agaçants.
Le vrai service, l'utilité ajustée, suppose une écoute de l'autre, une conscience de ses besoins réels, et surtout l'acceptation qu'on n'est pas toujours nécessaire. Paradoxalement, ceux qui sont les plus utiles sont ceux qui peuvent tolérer de ne pas l'être tout le temps.
- L'utilité comme tyrannie
Autre dérive : faire de l'utilité une condition d'existence. "Je ne vaux que ce que je produis", "je n'ai le droit d'exister que si je sers à quelque chose". Cette croyance sous-tend le workaholisme, le syndrome du sauveur, l'épuisement professionnel.
On rencontre souvent cette configuration chez des personnalités qui ont intériorisé très tôt qu'elles ne seraient aimées que pour ce qu'elles apportent, pas pour ce qu'elles sont. L'utilité devient alors une monnaie d'échange désespérée contre la reconnaissance et l'amour. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais en faire assez. La dette est infinie. L'épuisement guette.
Bergeret parlerait peut-être d'une défense contre l'angoisse abandonnique : "si je suis indispensable, on ne pourra pas me quitter". Mais cette défense est coûteuse. Elle ne laisse aucun répit, aucun espace pour simplement être, sans faire. Elle transforme la vie en performance anxieuse.
- La confusion valeur et fonction
Troisième piège, sociétal celui-là : confondre notre valeur avec notre fonction. Les sociétés productivistes nous poussent dans ce sens. On nous juge à notre CV, notre rendement, notre employabilité. Quand on perd son travail, on dit qu'on "n'a plus rien" - comme si notre emploi épuisait notre identité.
Cette confusion a des conséquences ravageuses. Elle rend insupportable toute période d'inactivité - retraite, maladie, chômage. Elle disqualifie tous ceux qui ne produisent pas selon les critères dominants - personnes handicapées, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de précarité. Elle alimente le sentiment d'inutilité et, par extension, la honte et le désespoir.
Or nous ne sommes pas réductibles à notre fonction. Notre valeur en tant qu'êtres humains est inconditionnelle, elle ne dépend pas de notre productivité. Distinguer "ce que je fais" et "ce que je suis" est une nécessité psychique. On peut perdre sa fonction sans perdre sa valeur. On peut être utile de mille manières qui ne passent pas par l'utilité économique.
- Les limites objectives
Dernier point, crucial : ne pas nier les déterminismes et les limites objectives. Tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources pour développer son agentivité. Une personne en dépression sévère, par exemple, n'a tout simplement pas l'énergie psychique disponible pour s'engager dans l'action. Lui dire "il suffit d'agir pour aller mieux" relève du déni cruel.
De même, les contextes sociaux, économiques, les discriminations, les handicaps, les traumatismes créent des obstacles réels à l'agentivité. On ne peut pas ignorer ces réalités au nom d'un optimisme béat. L'agentivité n'est pas que affaire de volonté individuelle, elle dépend aussi des possibilités objectives qu'offre l'environnement.
Reconnaître ces limites n'est pas du fatalisme, c'est de la lucidité. Cela permet d'ajuster nos attentes, de chercher des marges de manœuvre réalistes, et d'éviter la culpabilisation toxique de ceux qui ne parviennent pas à "se sentir utiles" parce que leur contexte de vie ne le permet tout simplement pas.
Comment cultiver un sentiment d'utilité sain
Passons maintenant à la dimension pratique. Comment développer un sentiment d'utilité qui nourrisse sans dévorer, qui structure sans rigidifier ?
- Commencer petit : les micro-actions
L'erreur courante est de viser trop grand : "je vais sauver le monde", "je vais révolutionner mon entreprise". Ces projets grandioses échouent souvent et renforcent le sentiment d'impuissance. Bandura insiste sur l'importance des expériences de maîtrise progressives.
Commencez par des actions minuscules dont vous pouvez constater les effets rapidement. Préparer un repas équilibré et le savourer. Ranger un espace qui était en désordre. Répondre attentivement à un message d'un proche. Arroser une plante. Réparer un objet cassé. Ces micro-actions produisent des effets mesurables, immédiats, tangibles.
L'accumulation de ces petites expériences de maîtrise reconstruit peu à peu le sentiment d'efficacité. C'est comme un muscle atrophié qu'on réhabilite doucement. On commence par soulever des poids légers avant d'augmenter progressivement la charge. L'utilité se cultive de même : par petites touches, jour après jour.
- Diversifier les sources
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si toute votre utilité repose sur votre travail, que se passe-t-il en cas de licenciement, de retraite, de burnout ? Si elle repose exclusivement sur votre rôle parental, que se passe-t-il quand les enfants partent ?
Diversifiez vos domaines d'investissement : travail, famille, activités associatives, créations personnelles, transmissions de compétences, engagement citoyen, soin à l'environnement, pratiques artistiques ou manuelles... Plus vos sources d'utilité sont variées, plus vous êtes résilient face aux aléas de la vie.
Cette diversification a un autre avantage : elle permet de nourrir différentes dimensions de votre identité. Vous n'êtes pas seulement un professionnel, un parent, un ami. Vous êtes tout cela à la fois, et chaque rôle peut être investi de manière utile.
- Accepter l'imperfection
L'utilité relative vaut mieux que l'inutilité absolue. Vous n'avez pas besoin de changer le monde, de guérir tous les maux, de résoudre toutes les souffrances pour vous sentir légitimement utile. Faire un petit pas dans la bonne direction, c'est déjà beaucoup.
Cette acceptation de l'imperfection protège du découragement. Beaucoup de personnes abandonnent leurs projets utiles parce qu'elles constatent que leur action ne règle pas tout. Mais c'est un critère absurde. Personne n'a ce pouvoir. Ce qui compte, c'est l'orientation, le mouvement, la contribution modeste mais réelle.
Un exemple clinique : une patiente dépressive se reprochait de ne pas être "assez présente" pour ses amis. En thérapie, nous avons redéfini ce qu'était une présence suffisamment bonne - répondre aux messages quand elle le pouvait, même brièvement. Pas besoin d'être toujours disponible 24h/24. Cette redéfinition réaliste lui a permis de se sentir à nouveau utile dans ses amitiés, au lieu de s'enfermer dans la culpabilité et le retrait.
- Distinguer contrôle et influence
Nous ne contrôlons pas tout, mais nous influençons beaucoup. Cette distinction, popularisée par les thérapies cognitivo-comportementales, est fondamentale pour maintenir un sentiment d'agentivité sain.
Je ne contrôle pas si mon enfant réussira sa vie, mais j'influence ses chances en l'éduquant avec attention. Je ne contrôle pas l'issue d'une crise écologique, mais j'influence marginalement les choses par mes choix quotidiens. Je ne contrôle pas si mon action sera reconnue, mais j'influence la probabilité en communiquant clairement.
Accepter qu'on ne contrôle pas tout évite le sentiment de toute-puissance et la culpabilité démesurée en cas d'échec. Reconnaître qu'on influence quand même maintient l'agentivité et le désir d'agir. C'est un équilibre subtil, mais essentiel.
- Des exemples concrets
Quelles actions concrètes nourrissent le sentiment d'utilité ? Voici une liste non exhaustive, pour stimuler votre réflexion :
- Transmission de compétences : enseigner quelque chose que vous savez faire, formellement ou informellement. Mentorat, tutorat, partage de savoir-faire.
- Soin aux autres : écouter un proche en difficulté, accompagner une personne âgée, soutenir un collègue. Attention : sans tomber dans le piège du sauveur.
- Engagement associatif ou citoyen : bénévolat, participation à des projets collectifs, implication dans la vie de la cité.
- Création : écrire, dessiner, composer, construire. Toute création laisse une trace dans le monde, produit quelque chose qui n'existait pas.
- Maintien et soin de l'environnement : jardiner, nettoyer un espace public, trier ses déchets, réparer plutôt que jeter. Ces gestes modestes inscrivent notre action dans le réel.
- Travail bien fait : quelle que soit votre profession, la faire avec conscience et compétence. L'utilité ne réside pas nécessairement dans la grandeur de la tâche, mais dans la qualité de l'exécution.
- Cuisiner : préparer des repas sains pour soi et ses proches. Geste humble, quotidien, mais profondément nourricier au sens propre et figuré.
- Écoute active : simplement être présent à l'autre, sans jugement, sans chercher à tout résoudre. C'est une forme d'utilité souvent sous-estimée.
L'essentiel est de trouver ce qui résonne avec votre tempérament, vos compétences, vos contraintes. Il n'y a pas d'utilité noble et d'utilité indigne. Toute action qui produit du sens pour vous et un effet positif dans le monde mérite d'être valorisée.
- Le rôle du feedback
Bandura insiste sur l'importance du feedback - ces informations qui nous reviennent sur les effets de nos actions. Sans feedback, impossible de savoir si on est efficace, donc impossible de développer le sentiment d'efficacité.
Cherchez activement ce feedback. Demandez à vos proches, vos collègues, les bénéficiaires de vos actions comment ils perçoivent votre contribution. Pas pour quémander des compliments, mais pour ajuster votre action et en mesurer les effets réels.
Apprenez aussi à vous auto-évaluer de manière réaliste. Qu'ai-je accompli aujourd'hui ? Quel effet cela a-t-il eu ? Tenir un journal peut aider : noter chaque jour trois actions utiles accomplies. Cette pratique simple renforce la conscience de sa propre agentivité.
Attention toutefois à ne pas dépendre exclusivement du feedback externe. Certains environnements sont avares en reconnaissance. Si vous attendez toujours qu'on vous dise que vous êtes utile, vous risquez l'épuisement et la frustration. Il faut aussi développer une capacité à reconnaître soi-même la valeur de ses actions, indépendamment du regard d'autrui.
- Créer des boucles de rétroaction positives
Enfin, pensez systémiquement. Comment créer des situations où votre action utile produit des effets qui, en retour, vous encouragent à continuer ? C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive.
Exemple : vous commencez à jardiner. Vous voyez les plantes pousser grâce à vos soins. Cette croissance visible vous encourage à continuer. Vous apprenez, vous progressez, votre jardin s'embellit. Des voisins vous complimentent. Vous leur donnez des conseils. Ils jardinent à leur tour. Le quartier se végétalise. Vous vous sentez partie prenante d'un mouvement positif. Votre sentiment d'utilité s'approfondit.
Ces boucles vertueuses ne se créent pas toujours spontanément. Parfois, il faut les amorcer consciemment : choisir des actions dont on pourra constater les résultats, s'entourer de personnes qui valorisent le type d'utilité qu'on cherche à déployer, s'inscrire dans des collectifs où l'entraide et la reconnaissance mutuelle sont la norme.
L'utilité comme espoir
Revenons à l'intuition initiale : pourquoi le sentiment d'utilité est-il porteur d'espoir ?
Parce que, contrairement à d'autres besoins psychiques fondamentaux - être aimé, être reconnu, être valorisé - qui dépendent largement des autres et échappent en grande partie à notre contrôle, l'agentivité et le sentiment d'utilité relèvent en partie de nous.
On ne peut pas *décider* d'être aimé. On ne peut pas *forcer* les autres à nous reconnaître. Mais on peut *agir* pour se sentir utile. On peut choisir des actions, constater leurs effets, ajuster, recommencer. C'est un domaine où nous disposons d'une marge de manœuvre réelle.
Cette marge de manœuvre est précisément ce qui fonde l'espoir. Pas un espoir naïf du type "tout dépend de moi", mais un espoir réaliste : "je ne suis pas totalement impuissant, je peux faire quelque chose, même modeste, et cela compte".
Face à l'absurde, face à la finitude, face aux multiples sources d'angoisse qui traversent l'existence humaine, l'action utile est une réponse. Elle ne résout pas tout, elle ne supprime pas l'angoisse existentielle, mais elle la rend supportable. Elle donne une direction, un sens, une raison de se lever le matin.
C'est en cela que le sentiment d'utilité est un besoin fondamental : il nous permet de sortir de la position victimaire, de la passivité désespérée, pour retrouver une posture d'agent. Non pas tout-puissant, mais capable. Non pas contrôlant, mais influent. Non pas sauveur du monde, mais contributeur modeste au bien commun.
L'espoir, dans cette perspective, n'est pas l'attente passive que les choses s'arrangent. C'est la conviction active que nous pouvons, à notre échelle, participer à ce que les choses s'arrangent. Ou au moins, à ce qu'elles ne s'arrangent pas trop mal.
Et peut-être, finalement, est-ce là la définition d'une vie réussie : non pas une vie exceptionnelle, admirée, spectaculaire, mais une vie où l'on s'est senti, la plupart du temps, utile à quelque chose ou à quelqu'un. Une vie où l'on a agi plutôt que subi. Une vie où l'on a laissé, ici et là, de petites traces positives.
Ce n'est pas grand-chose, direz-vous. C'est tout, répondrai-je.
Cet article n'a pas la prétention d'épuiser la question du sentiment d'utilité, ni de fournir des recettes miracle. Il vise simplement à ouvrir une réflexion sur un besoin psychique trop souvent négligé, et à suggérer quelques pistes praticables. Si une seule idée vous inspire une action, même minuscule, alors cet article aura été utile. Ce qui, vous en conviendrez, serait satisfaisant.