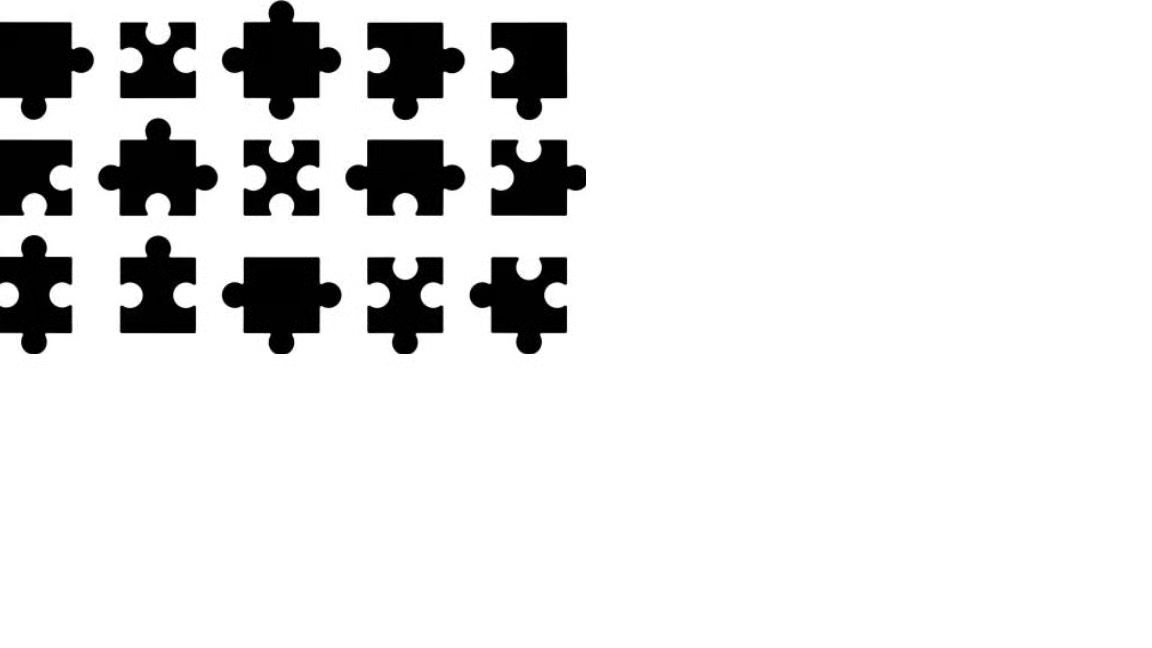Précision liminaire
Je pratique une branche de la psychologie - la caractérologie - notamment celle de Le Senne. Mais il faut être clair sur ce qu'elle apporte par rapport aux tests conventionnels de personnalité.
Les tests standardisés (MBTI, Big Five, DISC, etc.) produisent des profils statiques et descriptifs. Ils photographient un état supposé stable, catégorisent, et souvent promettent de prédire les comportements. Leur logique est celle du catalogue : vous êtes ceci, donc vous êtes susceptibles de faire cela.
La caractérologie fonctionne autrement. Elle n'est pas prédictive mais compréhensive.
Elle offre un langage pour saisir les tendances d'une personne – son rapport à l'émotion, à l'action, au temps – non pas pour l'enfermer dans une case, mais pour comprendre comment elle se défend, comment elle entre en relation, comment elle souffre. C'est un outil d'intelligibilité du fonctionnement psychique, pas un verdict.
Surtout, la caractérologie que je pratique n'est jamais isolée du contexte relationnel et systémique. Savoir qu'un sujet est "colérique" ou "sentimental" ne dit rien de sa relation à l'autre tant qu'on n'analyse pas « comment » ces tendances s'actualisent dans l'interaction concrète. C'est une grille de lecture parmi d'autres, pas une vérité finale.
L'appel du catalogue
La tentation est compréhensible. Face à un couple en crise ou une équipe dysfonctionnelle, pouvoir consulter une matrice croisant les profils psychologiques pour prédire qui "fonctionne" avec qui procurerait une illusion rassurante de maîtrise. Les tests de personnalité en recrutement, les applications de rencontre basées sur des algorithmes de compatibilité, les conseils conjugaux simplistes oscillant entre "les opposés s'attirent" et "qui se ressemble s'assemble" témoignent de ce fantasme prédictif.
Le marché regorge de ces outils : MBTI, ennéagramme (j’y suis formé moi-même), DISC (j’y suis moi-même certifié), et même des réappropriations sauvages de typologies cliniques comme celle de Le Senne. Tous promettent la même chose : anticiper le fonctionnement relationnel en additionnant des caractéristiques individuelles. C'est séduisant, c'est vendeur, et c'est fondamentalement erroné.
Bergeret : la structure se révèle dans le lien
Jean Bergeret nous rappelle que la structure de personnalité n'est pas un objet fixe qu'on "apporterait" dans la relation comme un bagage préexistant. Elle se révèle, se mobilise et se transforme *dans* l'interaction.
Prenons un exemple : un sujet à fonctionnement obsessionnel ne "sera" pas le même avec un partenaire hystérique qu'avec un autre obsessionnel. Ce n'est pas une simple addition de traits (obsessionnel + hystérique = X). C'est un processus relationnel où chacun convoque chez l'autre certaines défenses, certains modes de fonctionnement plutôt que d'autres.
Avec un partenaire hystérique, l'obsessionnel pourra se rigidifier davantage pour contenir l'émotion débordante de l'autre, ou au contraire découvrir une souplesse insoupçonnée face à la séduction. Avec un autre obsessionnel, il pourra entrer dans une compétition féroce pour le contrôle, ou trouver un confort dans la prévisibilité partagée. Ce qui émerge n'est pas prédictible par une matrice mais par l'analyse du système défensif activé « entre » ces deux personnes-là, dans ce contexte-là.
La personnalité se co-construit dans le lien. Vouloir prédire la relation à partir des individus isolés, c'est comme vouloir prévoir la mélodie en examinant séparément chaque note.
Darwin : l'adaptation contextuelle prime
Charles Darwin nous enseigne que la sélection naturelle ne favorise pas « le meilleur » ou le plus « fort » en absolu, mais l'adéquation au milieu. Transposé aux relations humaines : il n'existe pas de combinaison caractérielle universellement fonctionnelle.
Un couple formé de deux sujets "colériques" (au sens de Le Senne : émotifs, actifs, primaires) peut être parfaitement adapté dans un contexte d'adversité nécessitant de l'action rapide et de l'intensité – gérer une entreprise en crise, affronter une maladie grave, traverser une période d'instabilité sociale. Le même couple, placé dans un contexte de stabilité et de routine quotidienne, peut devenir dysfonctionnel par surinvestissement énergétique sans exutoire.
Inversement, deux « flegmatiques » (non-émotifs, actifs, secondaires) excelleront dans la consolidation tranquille d'un projet à long terme mais risquent l'enlisement face à une urgence requérant réactivité émotionnelle.
L'environnement – matériel, social, temporel – détermine quelle configuration relationnelle sera adaptative. Une matrice de compatibilité fige ce qui est par nature évolutif et contextuel. Elle présuppose un essentialisme des caractères là où règne le mouvement adaptatif.
Watzlawick : la circularité contre la causalité linéaire
Paul Watzlawick et l'école de Palo Alto démolissent définitivement l'idée qu'on pourrait prédire une interaction en additionnant des caractéristiques individuelles. Leur apport majeur : substituer la causalité circulaire à la causalité linéaire.
La pensée linéaire dit : "A est dominateur, donc B devient soumis". La pensée circulaire dit : "A et B co-créent un pattern complémentaire de domination/soumission, chacun renforçant le comportement de l'autre dans une boucle sans origine assignable". Qui a commencé ? Question absurde. Le système interactionnel précède les positions individuelles.
Les patterns relationnels – complémentaires (différence acceptée) ou symétriques (égalité revendiquée) – émergent de l'interaction. Ils ne préexistent pas dans les "caractères" des protagonistes. Un même individu développera des patterns radicalement différents selon son interlocuteur et le contexte communicationnel.
Le paradoxe devient alors évident : chercher LA bonne combinaison de profils empêche précisément de voir COMMENT fonctionne le système relationnel réel. On cherche la cause dans les individus alors qu'elle réside dans la structure de leur interaction.
Vouloir établir une matrice de compatibilité, c'est comme vouloir prédire une partie d'échecs en examinant séparément les pièces blanches et noires, sans considérer le jeu lui-même.
Implications pratiques
En thérapie conjugale
Le couple qui consulte en disant "nous ne sommes pas compatibles" exprime souvent un renoncement à comprendre ce qui se joue entre eux. Le travail thérapeutique consiste alors à déplacer la question : non pas "sommes-nous faits l'un pour l'autre ?" mais "que jouons-nous ensemble et pouvons-nous jouer autrement ?"
Explorer les patterns circulaires, identifier les double-liens, mettre au jour les bénéfices secondaires des dysfonctionnements : voilà le travail clinique. Une matrice de compatibilité court-circuite cette élaboration en offrant un verdict pseudo-scientifique là où il faudrait une analyse.
En intervention systémique (équipes, organisations)
En contexte professionnel, l'illusion est encore plus prégnante. Les outils RH promettent de composer "l'équipe idéale" en croisant des profils. Résultat : on constitue des groupes sur le papier harmonieux qui dysfonctionnent dans la réalité, parce que personne n'a pensé à la régulation systémique nécessaire.
Une équipe n'est pas une collection d'individus mais un système avec ses règles implicites, ses coalitions, ses boucs émissaires, ses non-dits. La vraie question n'est pas "qui avec qui ?" mais "quelles régulations mettre en place pour que la diversité devienne ressource plutôt que handicap ?"
Un sujet à structure limite peut être toxique dans une équipe sans cadre, et précieux dans une équipe fortement structurée où son intensité émotionnelle apporte du liant. Un obsessionnel sera paralysant dans un contexte exigeant de la réactivité, et salvateur dans un projet nécessitant rigueur et anticipation.
Conclusion : de la carte au territoire
Les outils typologiques – que ce soit Le Senne, le Big Five, le MBTI ou tout autre système classificatoire – ont leur utilité comme « cartes heuristiques » pour penser. Ils permettent de nommer, de différencier, de conceptualiser des tendances caractérielles. Ce sont des instruments d'intelligibilité, pas des GPS prédictifs.
L'erreur catastrophique consiste à les transformer en matrices de compatibilité, c'est-à-dire en instruments prédictifs d'appareillage relationnel. C'est confondre la carte avec le territoire, le concept avec le réel, la typologie avec la clinique.
La vraie expertise du praticien – thérapeute, coach, consultant – ne réside pas dans la maîtrise d'un catalogue de profils, mais dans sa capacité à analyser finement ce qui se joue « ici et maintenant » entre CES personnes-là, dans CE contexte-là. C'est plus exigeant intellectuellement, plus inconfortable pour le praticien/consultant et pour le patient ou client, mais c'est la seule voie cliniquement honnête.