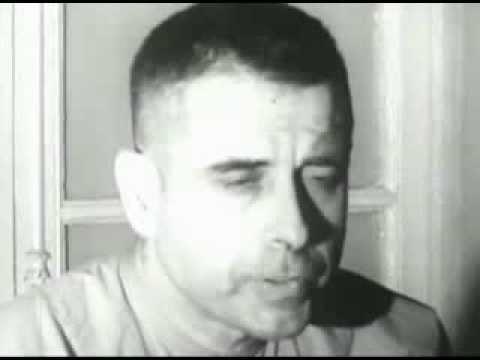émotion
Du passage à l'acte à l'acting out
Le 25/05/2025
Le comportement humain ne naît pas au hasard. Il résulte d’une interaction complexe entre trois grandes dimensions : cognitive (les pensées et représentations mentales), affective (les émotions et sentiments), et biologique (l’état physique, le fonctionnement cérébral, etc.). Ces trois éléments forment ce qu’on appelle une causalité triadique : un modèle qui montre que nos actions sont le produit de plusieurs influences simultanées et interdépendantes, je n’évoque pas l’influence de l’environnement ici.
De cette interaction peut émerger un moteur essentiel à l’action : la motivation. Cette dernière ne se résume pas à une simple envie passagère ; elle repose sur quatre caractéristiques principales :
- L’intentionnalité : c’est le fait que des états mentaux tels que percevoir, croire, désirer, craindre et avoir une intention, se réfèrent toujours à quelque chose.
- La pensée anticipatrice : ici, les événements futurs imaginés servent à la fois à nous pousser à agir (motivation) et à ajuster notre comportement en fonction de ce qui est attendu (régulation).
- L’auto-réactivité : cela correspond à notre aptitude à nous autoréguler, c’est-à-dire à gérer nous-mêmes notre motivation, nos émotions et nos actions.
- La réflexivité : pour ajuster son comportement de manière fine, il est essentiel d’avoir un certain recul sur soi, d’être capable de s’observer, de s’analyser et de se remettre en question.
Pour comprendre pourquoi une personne agit comme elle le fait, il faut prendre en compte ce mélange subtil entre pensées, émotions, état physique et capacité à se projeter. C’est dans cet équilibre que naît la motivation, ce moteur discret mais fondamental de nos comportements.
Ce cadre permet aussi d’éclairer certains comportements impulsifs ou violents, comme ce que l’on appelle en psychologie l’acting out. Il s’agit d’un passage à l’acte souvent brutal, où une tension interne – émotionnelle ou psychique – n’est pas verbalisée, mais exprimée directement par le comportement. Lorsqu’une personne n’a pas accès à la réflexivité ou à l’autorégulation, ou lorsque la pensée anticipatrice est court-circuitée par une charge affective trop intense, l’acting out peut devenir une manière de "dire sans mots".
Deux exemples concrets (soft) :
- Un adolescent en colère après une dispute avec ses parents claque violemment la porte, renverse des objets et quitte la maison sans prévenir. Il ne parvient pas à exprimer verbalement ce qu’il ressent, et son passage à l’acte devient le seul moyen d’extérioriser sa frustration.
- Un patient en thérapie, submergé par une émotion qu’il ne parvient pas à formuler, interrompt brusquement la séance en lançant une remarque blessante, puis quitte le cabinet. Là encore, le comportement agit comme un exutoire émotionnel, en l’absence de mots disponibles pour canaliser la tension.
Ces exemples montrent que l’acting out est souvent un signal de détresse, et qu’il peut être compris comme une tentative de rétablir un équilibre intérieur perdu.
L’acting out se définit par un acte impulsif en lien avec la dynamique relationnelle. Porot (1969) le définit comme un passage à l’acte réservé aux actes violents et agressifs à caractère impulsif et délictueux. Pour lui, le terme de « passage à l’acte » correspond plutôt à l’agir, c’est-à-dire à l’ensemble des actes, de l’impulsif aux conduites organisées.
Dans les éléments qui, conjugués entre eux favorisent cet acting out selon Vercier (1938), nous retrouvons l’infantilisme psychique, la faiblesse du jugement, le défaut d’autocritique, l’absence de gestion des émotions. Tardif (1998) y ajoute l’alexithymie, c’est-à-dire une incapacité à développer une activité symbolique, par l’inhabilité à mettre en mots et à différencier émotions et sensations corporelles et par un appauvrissement de la vie fantasmatique/phantasmatique ( on distingue « fantasme » qui est un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, d'une façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient et « phantasme » qui désigne le fantasme inconscient). « Le problème de l’alexithymique ne réside pas dans la propension à décharger les émotions mais dans l’impossibilité de tolérer les affects et les informations significatives qui y sont liés, ce qui génère une incapacité à élaborer ce qu’il ressent » (Tardif, 1998).
Ce mode de fonctionnement primaire caractérise une incapacité à freiner l’impulsivité, à tolérer la frustration. C’est prendre un raccourci entre ressenti et comportement, ce qui évite de passer par une phase d’élaboration intellectuelle, trop coûteuse, trop vorace en énergie.
En compensation de cet acting out, c’est un sentiment d’impunité, d’omnipotence, de toute puissance mais il s’agit en arrière-plan d’une réactualisation des conflits internes avec une compulsion de répétition. C’est un mode d’expression d’enfant en bas âge envahi par la honte, le désespoir, et l’incapacité de résilience… leurs tensions psychologiques sont déplacées vers des voies moins coûteuses en énergie, en effort, en remise en question…
Ces individus qui font de l’acting out leur mode d’expression courante, cachent des squelettes émotionnels (voire pire) dans un placard qu’ils ne veulent surtout pas ouvrir. Pas très valorisant mais lorsque l’éducation fait montre d’un manque flagrant de limite et d’obligation, de la dévalorisation du débat contradictoire et d’une absence totale de la recherche de sources fiables, il ne faut pas s’étonner. Le goût de l’effort devrait être un pilier dans l’éducation, et nous sommes tous acteurs de nos vies…
« Le recours à l’acte, à la violence, est une réalisation narcissique de puissance pour échapper à la menace de vide narcissique créée par la captation spéculaire. Le retournement de la passivité en activité et, inversement, la cyclicité de ces processus se réfèrent à une angoisse de passivation et d’anéantissement, l’acte criminel sauvant d’un effondrement insupportable » (Balier, Zagury, Meloy).
Sources :
Raoult, P.-A. (2006). Clinique et psychopathologie du passage à l'acte. Bulletin de psychologie, Numéro 481(1), 7-16. https://doi.org/10.3917/bupsy.481.0007.
Vercier (V.). – Les états de déséquilibre mental, Thèse de médecine, Paris, 1938.
Tardif (Monique). – Le déterminisme de la carence d’élaboration psychique dans le passage à l’acte, dans Millaud (F.), Le passage à l’acte. Aspects cliniques et psychodynamiques, Paris, Masson, 1998, p. 25-40.
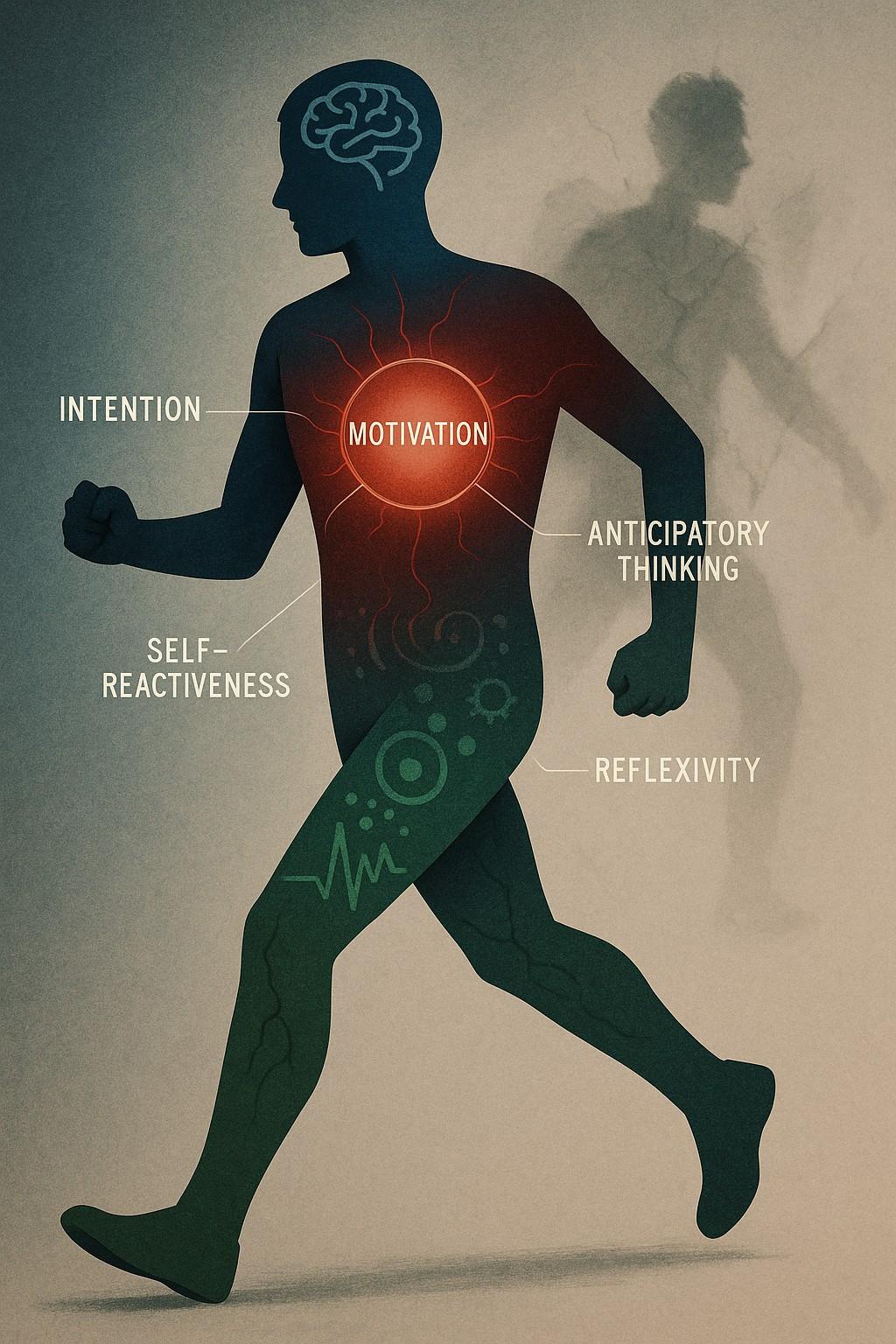
Narcissique extraverti ou introverti ?
Le 21/04/2025
Tous les narcissiques ne sont pas de grandes gueules extraverties, il existe aussi des manipulateurs cachés dans la plupart des cercles sociaux.
Il semble que le nombre de narcissiques ait très fortement augmenté et c’est devenu une sorte de label dont certain(e)s se servent concernant leur ex, leur patron, même certains membres de leur famille.
On pense tous avoir déjà rencontré un narcissique (qui relève de la pathologique psychiatrique bien sûr) mais il n’est pas si évident à identifier que ça, selon de récentes recherches. La pathologie narcissique affecte environs 1 personne sur 20, c’est une estimation. Ils ont un sentiment de grandeur, de supériorité et possèdent un faible niveau d’empathie. Ils ont besoin qu’on les admire constamment et se montrent facilement cassant.
Il est d’autant plus difficile à débusquer qu’il existe un autre type de narcissiques dits « vulnérables », qui ne sont pas dans l’extériorisation, l’arrogance, ni la grandiloquence. Ce sont plutôt des personnes introverties, pas habilles socialement, insécures, sur la défensive et angoissées. Ils essaient constamment de cacher leurs failles, leur tristesse. « Il a tendance à être fragile et ne peut pas faire de critique, » explique Hart (an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton).
Contrairement à leurs pairs, les narcissiques vulnérables sont convaincus qu’ils n’ont pas le statut social qu’ils méritent alors que ce n’est pas une volonté de leurs pairs. Il n’est pas question pour eux d’être en compétition s’ils sont convaincus qu’ils vont perdre. « Ça provoquerait un stress accru et un fort sentiment de honte, » dit Hart.
Les narcissiques vulnérables sont moins enclin à fantasmer sur leur supériorité, cependant leur réaction défensive peut être violente en cas de critique, et vous ne savez pas à quel moment ils vont exploser, et ça se fera derrière votre dos, lorsque vous ne vous y attendrez pas. Ils ne se contentent pas de collecter quelques informations personnelles sur vous pour s’en servir contre vous. Pour y arriver, ils vont vous confier des informations personnelles sur eux, vraies ou pas, mais ça vous donnera l’impression qu’ils sont dignes de confiance et donc de confidences. Manipulation !
De toute évidence, les deux types ont tendance à répondre aux personnes qui les entourent de manière antagoniste – des niveaux élevés de narcissisme ont été liés à l’intimidation, à la violence et à l’agression, directe et indirecte. Mais le narcissique vulnérable peut le faire pour des raisons différentes de celles du grandiose. « Ils peuvent intimider ou perpétrer de la violence parce qu'ils sont incertains d'eux-mêmes, » dit Hart.
Dans une relation avec l’un d’eux, sans surprise, les narcissiques grandioses sont toujours à l’affût de quelqu’un de mieux – ils ont l’impression de mériter le meilleur – ce qui conduit souvent à tricher, à mentir. « Les narcissiques vulnérables ont toutefois tendance à être beaucoup plus nécessiteux, mais peuvent aussi contrôler et manipuler de manière moins évidente, » explique Hart.
Vous êtes probablement convaincu que quelqu'un dans votre vie est un narcissiste déguisé, plein de force et sans filtre, cependant ils ne sont peut-être pas affectés par un trouble de la personnalité, donc de la pathologie qui relève de la psychiatrie.
Il est important de garder à l'esprit que les traits narcissiques peuvent aller et venir, cela concerne chacun de nous en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce qui peut conduire à ce que les autres se trompent et nous prennent parfois pour des narcissiques pathologiques.
Il y a des circonstances qui font ressortir le pire en nous tous – déchaînant ce que la recherche appelle le « narcissisme contextuel ». Tout le monde existe quelque part sur le spectre. Les traits de personnalité narcissique peuvent devenir plus forts ou plus faibles au fil du temps, être déclenchés par certaines situations et s'exprimer différemment chez différentes personnes. Cela signifie que nous sommes tous narcissiques – dans une certaine mesure.
Contrairement aux personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique diagnostiqué, les personnes ayant des niveaux élevés de traits de personnalité narcissique peuvent être en mesure de composer avec ces tendances dans certaines situations, comme autour de leur famille.
Contrairement au trouble clinique, les traits narcissiques sont très communs, et ils le deviennent de plus en plus dans de nombreux endroits à travers le monde – certainement en rapport avec la prépondérance du rapport à l’image aujourd’hui, que dis-je, la suprématie de l’ego.
Une étude réalisée par l’équipe de Heym suggère que les narcissiques ont la capacité d'empathie, mais choisissent simplement d’en faire fi la plupart du temps. Et c'est logique, si votre principal intérêt est votre GRANDE et IMPORTANTE personne, et que vous êtes prêt à exploiter et tromper les autres pour vous améliorer, éteindre votre capacité d'empathie est un avantage.
Une équipe de chercheurs a suivi des enfants sur une période de deux ans et constaté que ceux dont les parents les surévaluaient, les louant d'être exceptionnels et supérieurs à d'autres enfants, étaient plus susceptibles de montrer par la suite des signes de narcissisme.
Ils ont également découvert que les enfants qui recevaient une rétroaction incohérente, parfois surévaluée, démesurée ou sous-évalués, étaient plus susceptibles de développer un narcissisme vulnérable. Aaahhh, les enfants rois…
J'insiste (encore !) mais il est important de rappeler de ne pas confondre la « perversion narcissique » et la « personnalité narcissique » qui, elle, est structurelle et qui est intégrée dans le manuel de diagnostic psychiatrique DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) et classée dans les « Troubles de la personnalité ».
Le trouble de la personnalité narcissique (donc la pathologie) se caractérise par au moins 5 de ces critères de diagnostics :
- Mégalomanie (sens exagéré de leur importance et de leurs talents),
- Une obsession de fantasmes de succès, d’influence, de pouvoir, d’intelligence, de beauté, ou d’amour parfait,
- La conviction d’être spécial et unique et de fréquenter uniquement des personnes hors normes,
- Un besoin inconditionnel d’être admiré,
- La conviction de disposer de droits sur l’autre,
- L’exploitation des autres pour atteindre leurs propres objectifs,
- Un manque d’empathie,
- Sentiment que les autres les envient,
- L’arrogance et la fierté.
Si cinq ou plus de ces traits de personnalités deviennent chroniques et interfèrent avec la vie personnelle ou professionnelle, le diagnostic du trouble de la personnalité narcissique est posé.
La perversion narcissique quant à elle décrit un comportement manipulateur et destructeur associé au narcissisme.
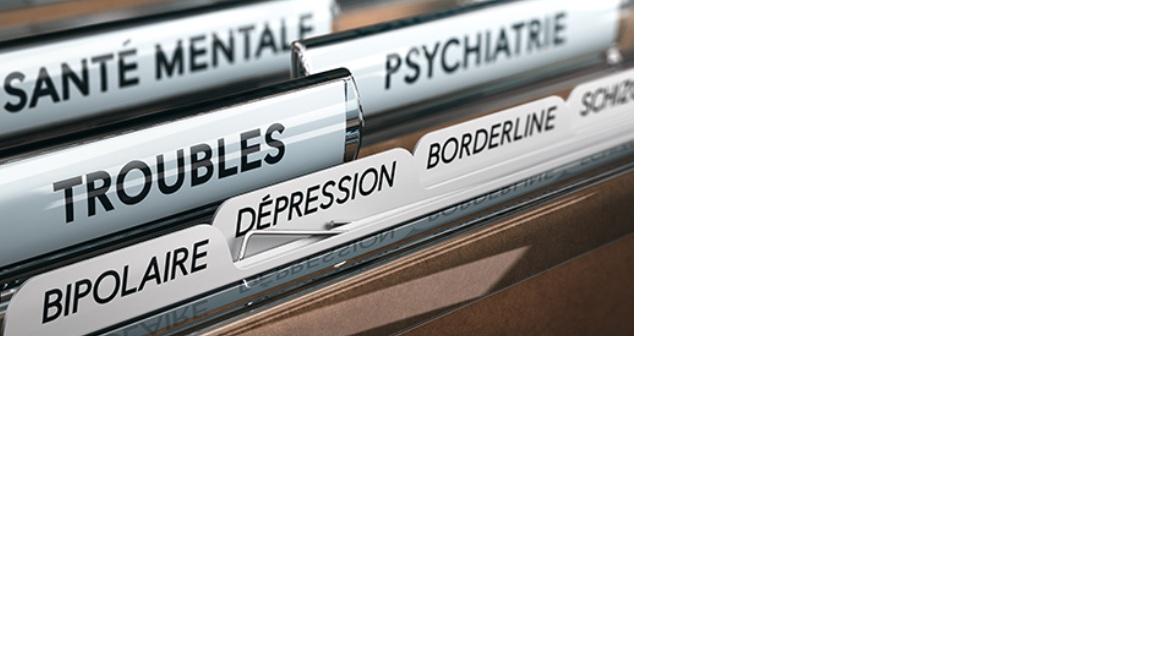
Source: « How to spot the 'covert narcissists' hiding in your life » Myriam Frankel, september 16, 2024, BBC Science Focus
About our experts
Dr Claire Hart is an Associate Professor of Psychology at the University of Southampton. Her work has been published in Sex Roles, Computers in Human Behavior, and Journal of Personality Assessment.
Nadja Heym is an Associate Professor of personality psychology at Nottingham Trent University. Her work has been published in Psychology & Neuroscience, Current Opinions in Behavioural Sciences, and Forensic Science International: Mind & Law (to name a few).
Synchronisation et empathie
Le 16/04/2025
Apprendre à décoder, à analyser le langage non-verbal en se limitant strictement à l’interprétation de certains éléments est pour le moins réducteur mais surtout, sujet à d’énormes erreurs (et j’en vois de belles sur Instagram, You Tube). Ca ne fait pas de vous un expert mais plus vraisemblablement un insctinctif. Vous n’aurez pas plus de réussite que la chance.
Pour faire la différence et passer de la version « instinctive » à la version « expert », il est impératif de tenir compte du contexte, des habitudes corporelles de chacun, et des états émotionnels de chacun.
Si la possibilité vous est offerte au cours d’un échange, lorsque vous pensez qu’il y a un hïatus dans la communication, c’est-à-dire que le verbal est décorrélé des gestes, qu’une expression faciale illustre l’inverse du discours, il vous faut tirer cela au clair en questionnant ! Si vous restez sur vos impressions, vous ne faites que jeter la pièce en l’air…
Si vous voulez comprendre une situation, si vous voulez savoir si votre date vous correspond, si vous voulez savoir pourquoi votre couple bat de l’aile ou simplement en savoir plus : discutons-en et allons comprendre ensemble les « intentions » de l’autre (ou les votres) !
Mail : contact@ds2c.fr / frantz.bagoe@gmail.com
Whatsapp/Message : 06 13 68 38 65
Instagram : ds2c.Analyse.Comportementale
En attendant, je vous partage une étude scientifique de 2012 sur notre capacité à appréhender les émotions des autres. Bonne lecture !
Le partage des états émotionnels des autres peut faciliter la compréhension de leurs intentions et de leurs actions. Les réseaux d'aires cérébrales « fonctionnent ensemble » chez les participants de cette étude qui voient des événements émotionnels similaires dans un film. L'activité cérébrale des participants a été mesurée avec l'IRM fonctionnelle pendant qu'ils regardaient des films représentant des émotions désagréables, neutres et agréables. Après le scan, les participants ont regardé les films à nouveau et ont évalué en continu leur expérience de l'agrément/désagrément et de l'excitation/calme.
Pendant le visionnage du film, les chercheurs ont constaté que l'activité cérébrale des participants a été synchronisée dans les aires sensorielles et dans les circuits émotionnels. En améliorant la synchronisation de l'activité cérébrale chez les individus, les émotions peuvent favoriser l'interaction sociale et faciliter la compréhension interpersonnelle.
Les émotions humaines sont très contagieuses. Les sentiments de colère et de haine peuvent se propager rapidement lors d'une manifestation de protestation pacifique et la transformer en une émeute violente, alors que des sentiments intenses d'excitation et de joie peuvent passer rapidement des joueurs aux spectateurs lors d'une finale de football par exemple.
Il est bien documenté que l'observation d'autres personnes dans un état émotionnel particulier déclenche rapidement et automatiquement la représentation comportementale et physiologique correspondante de cet état émotionnel chez l'observateur. Les études de neuroimagerie ont également révélé une activation neurale commune pour la perception et l'expérience d'états tels que la douleur, le dégoût et le plaisir.
Des données récentes suggèrent que, dans les situations sociales, une telle synchronisation de l'activité cérébrale de deux individus peut effectivement se produire au sens littéral.
Une stimulation naturelle prolongée, comme la visionnement d'un film ou l'écoute d'un récit, donne lieu à des cours temps de réponse et sélectifs sur le plan fonctionnel. C’est ce qu’il se passe lorsque 2 personnes, qui ne se connaissent pas, se rencontrent pour la première fois et que le « courant passe » entre elles.
Cette synchronisation de l’activité cérébrale s’étend jusqu’aux zones impliquées dans la vision et l’attention de haut niveau et a été interprétée comme reflétant la similitude du traitement de l’information cérébrale entre les individus.
En plus de refléter les réponses sensorielles, l'activité synchronisée pourrait aussi aider les gens à assumer les perspectives mentales et corporelles des autres et à prévoir leurs actions.
La synchronisation entre le locuteur et l'auditeur est associée à une compréhension réussie d'un message verbal, de la communication non verbale et des expressions faciales.
Après avoir été scannés, les participants ont revisionné les films et évalué leurs expériences subjectives de valence (plaisir/désagrément) et d'éveil (calme/activation).
Les chercheurs ont également évalué et établi qu’il y avait bien une corrélation entre une tendance auto-déclarée à l'empathie, c'est-à-dire la disposition à reconnaître les états émotionnels chez les autres, et la synchronisation intersubjective.
Partager les états émotionnels d'autres individus permet de prédire leur comportement, et les représentations affectives, sensorielles et attentionnelles partagées peuvent fournir la clé pour comprendre les autres.
Grâce à ce type de simulation mentale, nous pouvons estimer plus précisément les objectifs et les besoins des autres et adapter notre propre comportement en conséquence, soutenant ainsi l'interaction sociale et la cohérence entre les individus.
Source : « Emotions promote social interaction by synchronizing brain activity across individuals", 18/04/2012, L. Nummenmaa, doi.org/10,1073/pnas.1206095109

Droits d'auteur "La belle et le clochard" : Walt Disney Productions
Avoir des pensées sombres ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère
Le 22/03/2025
Voici un article court que je souhaitais vous partager parce que je l'ai trouvé instructif, intéressant et déculpabilisant pour les femmes concernées.
Bonne lecture !
Les pensées soudaines négatives voire effrayantes, non désirées, qui mettent en scène votre nourrisson sont presque universelles, en particulier pour le premier enfant.
Et pourtant, elles sont rarement étudiées, expliquent Susanne Schweizer et Bronwyn Graham dans un article de Science Advances Focus, qui fait partie d'un numéro spécial axé sur la santé des femmes.
La plupart du temps, ces pensées sont des accidents qui arrivent à votre bébé, comme imaginer qu’il tombe d’une table à langer.
Mais environ la moitié des femmes qui viennent d'accoucher ont des pensées intrusives sur le fait de nuire intentionnellement à leur enfant.
Ces pensées sont en totale opposition avec tout votre système de croyances, avec tout votre système de valeurs - ce qui, en psychologie, est appelé ego dystonique - et c'est ce qui les rend si bouleversant.
Dans une vision évolutive, avoir de telles pensées pourrait rendre une personne "extrêmement vigilante" sur toutes sortes de dangers auxquels l'enfant pourrait faire face.
Il est important de noter qu'elles ne sont pas associées à un préjudice réel pour l'enfant, les études n'ont pas permis de trouver des liens, par exemple, entre les pensées intrusives et l'agression parentale envers les nourrissons.
Cependant, elles ne sont certainement pas inoffensives, la faible quantité de recherches effectuées jusqu'à maintenant indique qu'elles sont associées à l'anxiété et à la dépression post-partum.
C'est aussi probablement parce que certaines personnes sont prédisposées à des schémas de pensées qui exacerbent le stress de telles pensées.
" Si je peux accepter cette pensée comme simplement une pensée intrusive sur laquelle je n'ai aucun contrôle, ... alors je peux lâcher prise", dit Schweizer.
"Mais si je considère cette pensée comme "je suis une mauvaise mère... je ne peux pas vraiment aimer mon enfant si j'ai une pensée comme ça", ces évaluations inadaptées rendront ces pensées plus affligeantes", poursuit-elle.
Bien que ces pensées soient bouleversantes, le fait qu'elles ne soient pas associées à la violence envers les enfants pourrait aider à réduire la détresse qu'elles causent ainsi que la stigmatisation qui empêche les mères de les divulguer, surtout lorsqu'elles impliquent des pensées de préjudice intentionnel.
Source : Perinatal intrusions: A window into perinatal anxiety disorders | Science Advances
Prendre une décision sur la base de l'intuition ou de la réflexion ?
Le 25/01/2025
Focus sur : « La Force de l'intuition » de Malcolm Gladwell
Gladwell explore la manière dont notre esprit prend des décisions rapides et intuitives, souvent en quelques secondes, et comment ces jugements peuvent être aussi fiables, voire plus, que des décisions réfléchies et analytiques. Gladwell introduit le concept de « thin-slicing », qui désigne notre capacité à saisir l'essence d'une situation ou d'une personne en se basant sur de brefs instants ou des informations limitées.
Gladwell illustre cette idée à travers diverses anecdotes et études. Par exemple, il mentionne le chercheur John Gottman, capable de prédire avec une précision de 90 % si un couple va divorcer en analysant seulement 15 minutes de leur conversation. Gottman et Amber Tabares, une de ses étudiantes, ont remarqué que chez les couples qui devaient par la suite divorcer, quand l’un des conjoints demandait à l’autre de l’approuver, il n’obtenait jamais satisfaction. Chez les couples plus heureux, au contraire, le conjoint répondait à la demande en disant simplement « oui, oui » ou en hochant la tête.
Gladwell souligne également que ces jugements instantanés sont souvent inconscients. Il cite l'exemple de l'entraîneur de tennis Vic Braden, qui pouvait prédire quand un joueur commettrait une double faute avant même que le service ne soit exécuté, sans pouvoir expliquer comment il arrivait à cette conclusion. Cela démontre que notre subconscient joue un rôle majeur dans nos décisions rapides.
Attention aux biais
Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers potentiels de ces jugements intuitifs, notamment lorsqu'ils sont influencés par des stéréotypes ou des préjugés inconscients. Il aborde le concept de « priming » psychologique, où des associations subconscientes peuvent affecter nos perceptions et décisions.
Gladwell discute également de la notion de « paralysie par l'analyse », où un excès d'informations peut nuire à la qualité de nos décisions. Il affirme que, dans de nombreux cas, disposer de moins d'informations mais savoir identifier les éléments pertinents permet de prendre de meilleures décisions. Cette idée est illustrée par des exemples dans divers domaines, tels que la médecine, où des diagnostics basés sur des informations clés peuvent être plus précis que ceux fondés sur une multitude de données.
Dans le cadre de l’analyse des décisions intuitives, Gladwell fait écho au modèle RPD (Recognition-Primed Decision), un cadre développé par le psychologue Gary Klein pour expliquer comment les experts prennent des décisions dans des situations complexes ou stressantes. Ce modèle repose sur l’idée que les décisions intuitives ne sont pas des actes de hasard, mais le fruit de la reconnaissance rapide d’un schéma familier dans une situation donnée. Lorsqu’une personne expérimentée est confrontée à un problème, son cerveau identifie immédiatement une solution en se basant sur des expériences similaires passées, sans qu’il soit nécessaire de comparer systématiquement toutes les options. Ce processus d’intuition experte permet des réponses rapides et adaptées, particulièrement dans des domaines où le temps est un facteur critique, comme la médecine d’urgence, la gestion de crise, ou encore les opérations militaires.
Quels champs d’application ?
Les champs d’application du modèle RPD sont variés. Le RPD intervient dans un contexte où la contrainte de temps est importante, où il est nécessaire d’avoir de l’expérience opérationnelle, dans des conditions dynamiques avec des objectifs non quantifiables.
Par exemple, les pompiers qui évaluent une scène d’incendie peuvent, en quelques secondes, identifier le danger principal et ajuster leurs actions en conséquence. De même, un chirurgien chevronné peut instinctivement détecter une complication potentielle au cours d’une opération grâce à des signaux subtils qu’un novice pourrait ignorer. Ce modèle met en lumière l’importance de l’expérience dans l’efficacité des décisions intuitives, tout en soulignant que les erreurs peuvent survenir lorsque des biais ou des préjugés influencent le jugement initial.
En résumé
Le modèle RPD complète l’analyse de Gladwell en démontrant comment les décisions rapides reposent sur une base solide d’apprentissage et de reconnaissance, en s’avérant souvent supérieures dans des environnements dynamiques et exigeants.
Mais allons encore plus loin, jusqu’à Husserl
La corrélation entre la force de l’intuition de Malcolm Gladwell et l’intentionnalité de Husserl est une réflexion fascinante qui lie deux domaines apparemment distincts : la psychologie intuitive et la phénoménologie.
L’intentionnalité chez Husserl
L’intentionnalité, au cœur de la phénoménologie d’Edmund Husserl, désigne le fait que toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Cela signifie que la pensée humaine n’est jamais isolée ou abstraite, mais qu’elle vise toujours un objet ou une situation spécifique. Pour Husserl, cette orientation intentionnelle n’est pas seulement un acte mental délibéré, mais aussi une manière dont notre esprit se dirige spontanément vers le monde, en saisissant les phénomènes dans leur immédiateté.
Intuition dans La Force de l’intuition
Chez Gladwell, l’intuition est décrite comme une capacité du cerveau à prendre des décisions rapides en s’appuyant sur des signaux inconscients et des expériences passées. Cette forme de cognition repose sur une saisie immédiate de l’essence d’une situation (le "thin-slicing"), souvent sans analyse consciente détaillée.
La corrélation : une saisie intuitive de l’essence
Ces deux perspectives peuvent se rejoindre dans l’idée que l’intuition, comme l’intentionnalité, est un mode de rapport immédiat au monde :
1. Saisie directe de l’objet : L’intuition de Gladwell peut être vue comme une application pratique de l’intentionnalité husserlienne, dans laquelle l’esprit, dirigé vers un phénomène, en capte l’essence essentielle sans médiation analytique. Par exemple, un expert en art peut reconnaître instinctivement un faux tableau, tout comme l’intentionnalité husserlienne permet de saisir directement les qualités d’un phénomène.
2. Pré-réflexivité : Husserl souligne que de nombreuses perceptions intentionnelles se déroulent sans réflexion consciente. De la même manière, Gladwell montre que l’intuition opère souvent en arrière-plan, mobilisant des processus inconscients basés sur des expériences accumulées.
3. Le rôle du contexte : Dans les deux approches, le contexte joue un rôle clé. Husserl insiste sur le fait que chaque intention est ancrée dans un horizon de signification, tout comme Gladwell démontre que l’intuition se nourrit des expériences vécues dans des contextes particuliers.
Applications communes
1. Psychologie : En psychologie appliquée, les deux notions renforcent l’idée que nos jugements ne sont jamais neutres ou désincarnés. Ils sont enracinés dans notre expérience du monde et influencés par l’environnement et le vécu.
2. Éthique et prise de décision : La réflexion sur l’intentionnalité peut éclairer les limites de l’intuition. Par exemple, si une intuition est biaisée par des stéréotypes (comme Gladwell le montre), elle pourrait être réexaminée à travers l’analyse intentionnelle husserlienne pour mieux comprendre les structures qui influencent ce jugement.
3. Phénoménologie de l’action : Les deux approches mettent en lumière la manière dont nos actions (qu’elles soient intuitives ou réfléchies) sont toujours orientées vers une finalité, qu’elle soit consciente ou inconsciente.
En conclusion
L’intuition, telle que décrite par Gladwell, peut être interprétée comme une forme d’intentionnalité pré-réflexive. Là où Husserl se concentre sur la manière dont la conscience oriente et constitue les phénomènes, Gladwell explore les manifestations pratiques de cette orientation dans nos jugements rapides. Cette mise en relation ouvre des perspectives intéressantes pour comprendre comment nos décisions intuitives sont enracinées dans notre expérience phénoménologique du monde.
La peur de l'abandon : explications !
Le 05/10/2024
La peur de l’abandon est un thème central dans le champ de la psychanalyse, car elle touche au cœur des dynamiques inconscientes qui structurent la relation à l'autre et au soi. En psychanalyse, cette peur est souvent analysée en relation avec les premières expériences de séparation, notamment celles vécues avec les figures parentales, et elle se manifeste dans des angoisses profondes liées à la perte d’amour ou de sécurité. Explore la peur de l’abandon à travers plusieurs concepts psychanalytiques centraux, en se basant sur les travaux de Freud, Melanie Klein, Winnicott et Bowlby.
La peur de l'abandon et la psychanalyse freudienne
Freud (1915) a exploré les racines des angoisses fondamentales dans ses travaux sur l'inconscient, en particulier dans ses théories du développement infantile. Dans "Inhibition, Symptôme et Angoisse", Freud introduit la notion d’angoisse primaire, qu'il relie à l’expérience de séparation d’avec la mère. Cette angoisse originelle constitue une base pour comprendre la peur de l’abandon. Freud théorise que le premier lien entre l'enfant et sa mère est essentiel, car c'est la mère qui satisfait les besoins primaires de l’enfant. Lorsqu’il y a une séparation, l'enfant peut ressentir une profonde détresse. La rupture de ce lien est alors vécue comme un abandon, une perte d’objet (la mère en tant qu'objet d'attachement). Freud a également souligné l'importance de la "perte de l'objet d'amour" qui, dans son modèle pulsionnel, est un thème récurrent dans le développement de la névrose. L’enfant, privé de cet amour, peut développer une angoisse qui se manifeste plus tard sous diverses formes. L’idée centrale est que la peur de l’abandon est intimement liée à la perte de l’objet d'amour.
L’angoisse de persécution et l'angoisse dépressive
Melanie Klein (1935) a étendu la compréhension des processus inconscients chez l'enfant, notamment à travers l'idée de positions psychiques. Pour Klein, la peur de l'abandon est liée à deux formes d'angoisse : l'angoisse persécutrice et l'angoisse dépressive, qui caractérisent respectivement la "position paranoïde-schizoïde" et la "position dépressive" chez l'enfant. Dans la position paranoïde-schizoïde, l'enfant projette ses sentiments agressifs et destructeurs sur l'objet (la mère), ce qui crée une angoisse persécutrice. L'enfant craint que l'objet ne revienne pour le persécuter ou le détruire. Par extension, cette peur peut se transformer en une peur d’être abandonné par cet objet si investi, car l’enfant craint que sa propre agressivité ne l’ait détruit. Dans la position dépressive, l’enfant commence à percevoir l’objet comme étant entier, à la fois bon et mauvais. L’angoisse de persécution se transforme alors en angoisse dépressive : l'enfant craint d’avoir endommagé l'objet d’amour à cause de ses impulsions destructrices. Cette culpabilité conduit à une peur plus subtile de l’abandon, car l’enfant ressent une angoisse liée à la perte de l'objet entier (la mère) qu'il aime et déteste à la fois. Cette compréhension kleinienne nous permet de voir comment la peur de l’abandon est non seulement liée à la séparation physique, mais aussi à une séparation psychique interne due à l’agressivité et à la culpabilité.
L’objet transitionnel
Winnicott (1953), en s’intéressant à l’individuation et au développement émotionnel de l’enfant, a proposé la théorie des objets transitionnels et de l’espace transitionnel. Selon lui, la peur de l’abandon est fortement liée à l'expérience de séparation progressive entre l'enfant et sa mère. Winnicott souligne que l’enfant, dans les premiers mois de sa vie, ne distingue pas clairement entre lui-même et le monde extérieur. Il vit dans une sorte de fusion avec sa mère. La tâche développementale majeure est alors de permettre à l'enfant de se séparer progressivement de la mère, tout en maintenant un sentiment de sécurité interne. C’est là que l’objet transitionnel (comme un doudou, une peluche) joue un rôle crucial, car il permet à l'enfant de tolérer la séparation sans vivre une angoisse trop écrasante. Cet objet devient un substitut temporaire de la mère, facilitant ainsi l’autonomisation progressive. Dans cette perspective, la peur de l’abandon peut surgir lorsque ce processus de séparation ne se passe pas en douceur, soit parce que la mère est trop absente ou, au contraire, trop présente, empêchant ainsi l'enfant de développer un sens solide de soi. Si l’enfant ne peut pas internaliser un "objet bon" suffisamment sécurisant, il est condamné à vivre des angoisses d'abandon récurrentes, cherchant constamment un objet externe pour apaiser son anxiété.
L’attachement
La théorie de l’attachement développée par John Bowlby (1969, 1973) offre une autre perspective psychanalytique sur la peur de l’abandon. Bowlby, bien qu’influencé par Freud et Klein, a développé une approche fondée sur l’observation des interactions réelles entre les enfants et leurs figures d’attachement, principalement la mère. Pour Bowlby, les premières expériences d’attachement sont cruciales pour le développement de la personnalité et influencent la capacité à former des relations sécurisantes à l’âge adulte. Un attachement sécurisant, où l’enfant sait que sa figure d’attachement reviendra toujours, permet à l’enfant de développer une confiance fondamentale. En revanche, un attachement insécurisant, où la présence de la mère est imprévisible ou incohérente, entraîne chez l’enfant une peur constante d’être abandonné. Bowlby a identifié plusieurs styles d’attachement, dont l’attachement anxieux-ambivalent, où l’enfant développe une peur chronique de l’abandon à cause d’une figure d’attachement imprévisible. À l’âge adulte, cette peur se manifeste souvent par des comportements de dépendance, un besoin excessif de réassurance et une peur constante de perdre les relations importantes.
Le narcissisme et la peur de l’abandon
La psychanalyse a également exploré la peur de l’abandon dans le cadre des troubles narcissiques. Dans ses travaux sur le narcissisme, Freud (1914) a proposé que l’amour-propre ou narcissisme est une forme d’attachement à soi-même qui est une réponse au risque d’abandon. L’enfant, dans ses premiers mois, est centré sur lui-même. C’est ce que Freud appelle le narcissisme primaire. À mesure que l’enfant se développe, il commence à déplacer une partie de cet amour-propre vers des objets externes, principalement ses parents. Si ce déplacement est entravé, par exemple par une figure d’attachement trop instable ou absente, l’enfant peut retourner à un état de narcissisme primaire comme défense contre la peur de l’abandon. Dans les cas de narcissisme pathologique, la peur de l’abandon est particulièrement aiguë. Le narcissique cherche désespérément à être aimé et admiré par les autres pour combler un vide interne. Cependant, ce besoin compulsif d'attention masque une fragilité sous-jacente : la personne narcissique craint constamment d’être rejetée ou abandonnée. L’amour des autres est essentiel pour maintenir une image idéalisée de soi, et toute menace d'abandon est vécue comme une blessure narcissique.
Le manque fondamental
Jacques Lacan a abordé la question du manque et du désir comme centrales à l’expérience humaine. Pour Lacan (1959), le désir humain est toujours marqué par une quête de complétude, une complétude qui reste à jamais hors de portée. Le désir est lié à ce qu'il appelle "l’Autre" (l’Autre symbolique), une figure qui incarne le manque fondamental autour duquel se structure la subjectivité. Dans cette optique, la peur de l’abandon peut être vue comme une manifestation du désir insatiable de combler ce manque originel. L’être humain, selon Lacan, est fondamentalement marqué par une absence – une séparation primordiale qui survient dès l’entrée dans le langage. La peur de l’abandon est ainsi enracinée dans une quête illusoire d’unité avec l’Autre, une unité qui, en réalité, est impossible à réaliser. Toute relation, en ce sens, porte en elle la possibilité de l'abandon, car elle est fondée sur un manque impossible à combler.
Personnellement, je n’ai plus de doudou depuis longtemps et pour remédier à cet état de manque, cette peur d’être abandonné, j’aime poser ma tête sur le ventre de ma femme : c’est rassurant et plus profond, plus satisfaisant qu’un hug.

L’importance de l’étayage parental à travers la vie d’Armin Meiwes
Le 21/07/2024
Armin Meiwes : une vie marquée par l’horreur
Enfance et relations familiales
Surnommé « le cannibale de Rotenburg », Armin Meiwes est né le 1er décembre 1961 à Kassel, en Allemagne. Sa jeunesse a été marquée par une relation difficile avec ses parents. Son père, un policier autoritaire, était souvent absent et a fini par quitter la famille lorsque Armin avait huit ans. Cette séparation a eu un impact profond pour lui, le laissant avec un sentiment d’abandon. Sa mère décrite comme possessive et dominante, a élevé Armin dans un environnement strict, le contrôlant étroitement. Isolé, Armin développait un monde imaginaire où il se réfugiait pour échapper à la solitude et à la rigueur de sa vie domestique.
Scolarité et adolescence
Armin Meiwes était un élève moyen, mais il n’avait pas beaucoup d’amis. Ses camarades de classe le décrivaient comme un garçon timide et introverti. A l’adolescence, il commença a fantasmer sur le cannibalisme, utilisant ces pensées pour combler son besoin d’intimité et de contrôle, conséquences directes de son éducation perturbée.
Les circonstances du crime
Les fantasmes d’Armin Meiwes se sont intensifiés avec le temps, jusqu’à ce qu’il passe à l’acte en 2001. Il publia une annonce sur un forum en ligne dédié aux fétiches extrêmes, recherchant un volontaire pour être tué et consommé. A la surprise générale, un homme du nom de Bernd Jürgen Brandes répondit favorablement.
Le 9 mars 2001, Brandes se rendit au domicile de Meiwes à Rotenburg. Les deux hommes eurent des relations sexuelles avant que Meiwes ne coupe le pénis de Brandes, un acte que ce dernier avait souhaité. Brandes saigna abondamment mais, sous l’effet de puissants sédatifs, il continua à coopérer jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Meiwes, selon ses propres aveux, attendit plusieurs heures avant de le tuer en lui tranchant la gorge. Il enregistra la totalité de l’acte sur vidéo, un élément clé lors de son procès.
Conséquences légales et psychologiques
Armin Meiwes fut arrêté en décembre 2002 après que la police eut découvert la vidéo du meurtre. Son procès, qui débuta en décembre 2003, attira une attention internationale en raison de la nature macabre du crime. Meiwes fut d’abord condamné à huit ans et demi de prison pour homicide involontaire, la cour considérant que Brandes avait consenti à sa propre mort. Cependant, après un appel, il fut rejugé en 2006 et condamné à la perpétuité pour meurtre et perturbation de la paix des morts.
Le cas d’Armin Meiwes soulève des questions profondes sur les limites du consentement et les aspects psychologiques de comportements extrêmes. Son enfance marquée par l’isolement et une relation dysfonctionnelle avec ses parents, combinée à des fantasmes déviants, ont abouti à un crime qui restera dans les anales de la criminologie moderne.
Pourquoi, selon Bowlby, l’étayage maternel est-il si important pour le petit enfant ?
Selon John Bowlby, l’étayage maternel, ou l’attachement à la figure maternelle, est crucial pour le développement psychologique et émotionnel du petit enfant pour plusieurs raisons fondamentales :
- Sécurité émotionnelle : la présence constante et rassurante de la mère ou de la figure d’attachement principale fournit à l’enfant un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité est essentiel pour que l’enfant puisse explorer son environnement en toute confiance, sachant qu’il peut revenir à une base sûre en cas de besoin.
- Développement de la confiance : l’attachement sécurisant permet à l’enfant de développer une confiance en lui-même et en ses capacités. La mère, en répondant de manière prévisible et sensible aux besoins de l’enfant, aide celui-ci à comprendre qu’il est digne d’amour et de soin, ce qui favorise une estime de soi positive.
- Régulation des émotions : les interactions avec la figure d’attachement aident l’enfant à apprendre à réguler ses émotions. Par exemple, lorsque l’enfant est stressé ou effrayé, la présence et les réponses apaisantes de la mère aident à calmer l’enfant, lui enseignant progressivement comment gérer ses propres émotions.
- Modèles de relations futures : l’attachement initial sert de modèle pour toutes les relations futures de l’enfant. Un attachement sécurisant favorise des relations interpersonnelles saines et stables à l’âge adulte, tandis qu’un attachement insécurisant peut mener à des difficultés relationnelles.
- Base de développement cognitif : un environnement sécurisant permet à l’enfant de se concentrer sur l’apprentissage et l’exploration plutôt que sur la survie ou la recherche de réconfort. Cela encourage le développement cognitif et la curiosité, facilitant l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances.
- Prévention des troubles psychologiques : un attachement sécurisant est associé à une moindre prévalence de troubles psychologiques. Les enfants qui ont bénéficié d’un bon étayage maternel sont moins susceptibles de développer des troubles de l’anxiété, de la dépression, ou des problèmes de comportement.
En résumé, l’étayage maternel est fondamental car il forme la base sur laquelle l’enfant peut construire sa compréhension du monde, développer des compétences émotionnelles et sociales, et établir des relations saines et stables tout au long de sa vie.

La théorie de la contrainte non choisie, où : pourquoi dire "non" ?
Le 09/05/2024
Il existe un lien de cause à effet entre ne pas savoir dire « non » et le harcèlement moral et affectif.
Ce lien, nous le subissons tous mais à divers degrés. C’est pour cela que certaines personnes sont plus affectées que d’autres.
Ce lien est subtil, implicite, ténu voire malsain. C’est ce que j’appelle la théorie de la contrainte non-choisie. C’est le fait d’imposer à l’autre une tâche, un service alors qu’il existe d’autres possibilités. C’est rendre l’autre redevable pour se déresponsabiliser et se placer en position de dominant, pour avoir un ascendant sur l'autre.
Par exemple, un petit groupe de personnes reviennent d’un café et l’une d’elles (personne A) demande à une autre (personne B) de lui déposer son téléphone et son gobelet de boisson à son bureau, le temps qu’elle se rende aux toilettes. Ça s’apparente à un service tout à fait banal, mais l’autre possibilité eut été que la personne A dépose elle-même ses affaires à son bureau pour aller ensuite aux toilettes, sans avoir à solliciter la personne B.
Si la personne B accepte de rendre ce service, elle accepte alors implicitement une relation de subordination qui se répètera forcément parce qu’elle sera vue comme serviable. Sauf que si ce type de services se multiplie, cela provoquera un stress chez la personne A qui pourrait devenir délétère à la longue.
Autre exemple avec les aventuriers de Koh-Lanta, lorsqu’au moment des nominations l’un des aventuriers dit à un autre : « j’ai éliminé 2 amis à moi alors que ça me déchirait le cœur. Là, je te demande simplement aujourd’hui de faire la même chose avec untel. »
Ce type de demande crée un lien de subordination insidieux qui vous place en position de devoir effectivement réaliser ce service pour l’autre. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, l’autre n’est pas démuni d’un intérêt personnel, d’une intention qui est manipulatrice pour autant qu’elle n’ait pas d’autre solution que de vous solliciter.
La racine du mot « contrainte » est CONSTRINGERE qui désigne ce qui est enserré par des liens, enchaîné, entravé, dominé. Une contrainte, ce sont des règles attribuées auxquelles le sujet doit se conformer, qui lui indiquent ce qu’il doit ou ne doit pas faire. « La notion de contrainte implicite met l’accent sur les inférences du sujet à partir d’une activité de compréhension des contraintes explicitent (cairn.info). »
Une contrainte choisie rend la personne qui l’accepte actrice de son choix, c’est intentionnel. L’inverse lui confère un rôle passif, de soumission car ce sera un choix non intentionnel.
C’est facilement compréhensible lorsque vous devez signer un contrat de travail ou un prêt financier.
Savoir dire « non » vous permet de ne pas accepter le stress inhérent et possiblement les conséquences qui peuvent en résulter. C’est vous protéger.

Comprendre et traiter l'inhibition
Le 07/04/2024
Comprendre l’inhibition et ses mécanismes
L'inhibition, en psychologie, fait référence à un processus mental qui consiste à supprimer ou à restreindre une pensée, un comportement ou une émotion. Cela peut se produire de différentes manières, telles que l'inhibition cognitive, émotionnelle ou comportementale. L'inhibition peut être à la fois bénéfique et nuisible, en fonction du contexte et de la manière dont elle est utilisée.
L'inhibition cognitive, par exemple, peut être utile pour se concentrer sur une tâche spécifique en ignorant les distractions. Cependant, une inhibition excessive peut également entraver la créativité et la flexibilité mentale. De même, l'inhibition émotionnelle peut être nécessaire pour contrôler ses réactions dans des situations sociales, mais elle peut également conduire à une suppression excessive des émotions, ce qui peut être préjudiciable à long terme.
En psychologie, l'étude de l'inhibition est importante pour comprendre comment les individus régulent leur comportement et leurs émotions. Les chercheurs s'intéressent également à la manière dont l'inhibition peut être perturbée dans des troubles tels que l'anxiété, la dépression ou le trouble de stress post-traumatique.
Comment l'inhibition, en psychologie, peut-elle être perturbée par des troubles comme l'anxiété et la dépression ?
L'inhibition peut être perturbée par des troubles tels que l'anxiété et la dépression de plusieurs manières.
Dans le cas de l'anxiété, une inhibition excessive peut se produire en raison d'une hyperactivation du système de réponse au stress. Cela peut entraîner une inhibition cognitive, où les pensées négatives et les préoccupations anxieuses dominent l'esprit, entravant la capacité à se concentrer sur des tâches importantes.
De plus, l'anxiété peut également entraîner une inhibition émotionnelle, où les émotions sont refoulées ou supprimées pour éviter les situations stressantes, ce qui peut conduire à une détresse émotionnelle accrue à long terme.
En ce qui concerne la dépression, l'inhibition peut être perturbée par une diminution de la motivation et de l'énergie, ce qui peut entraîner une inhibition comportementale. Les individus déprimés peuvent avoir du mal à initier des actions ou à s'engager dans des activités sociales, ce qui peut renforcer le sentiment de désespoir et d'isolement.
De plus, la dépression peut également entraîner une inhibition émotionnelle, où les émotions positives sont supprimées ou atténuées, ce qui peut contribuer à un sentiment général de vide et de détachement.
En conclusion, l'inhibition est un processus complexe et multifacette qui joue un rôle crucial dans la régulation du comportement et des émotions. L'anxiété et la dépression peuvent perturber l'inhibition en modifiant la manière dont les individus régulent leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements.
Comprendre ces mécanismes peut être crucial pour développer des interventions efficaces pour traiter ces troubles et améliorer le bien-être mental des individus concernés.
Je suis un psychopathe endormi !
Le 29/09/2023
Le sociopathe se caractérise par l’inobservation des obligations sociales, l’indifférence pour autrui, une violence intuitive ou une froide insensibilité. Le comportement est peu modifiable par l’expérience, y compris suite à des sanctions. Les sujets de ce type sont souvent inaffectifs et peuvent être anormalement agressifs ou irréfléchis. Ils supportent mal les frustrations, accusent les autres ou fournissent des explications spécieuses pour les actes qui les mettent en conflit avec la société. La caractéristique essentielle est l’existence de conduites antisociales répétées, apparues avant l’âge de 15 ans et persistant à l’âge adulte, avec une incapacité à conserver une insertion professionnelle régulière, en dehors de tout contexte schizophrénique, maniaque ou déficitaire (retard mental).
Une méta-analyse de 16 études (entre 1985 et 2017) vise à vérifier qu’on retrouverait plus de gauchers chez les personnes atteintes de schizophrénie et de dépression. Il en est de même pour le faible poids et les complications à la naissance, un stress prénatal, ce qui suggère que la non-droitisation pourrait être liée à une perturbation du développement cérébral pré et périnatal.
Pour le sujet qui nous intéresse, même si l’origine des troubles mentaux n’est pas entièrement claire, les psychopathes devraient donc être majoritairement non-droitiers si leur problème venait principalement d’un trouble mental, selon les chercheurs. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme neurologiquement sains et la perspective de stratégie adaptative est privilégiée.
Les chercheurs ont examiné l’association entre la psychopathie et le fait d’être droitier pour un total de 1818 participants. En fin de compte, il n’y avait pas de différence dans les taux de non-droitier entre les participants à haut et bas niveau de psychopathie, et entre les patients psychopathes et non psychopathes. En revanche, les auteurs ont noté une tendance pour les délinquants ayant un score plus élevé dans la dimension comportementale de la psychopathie à être davantage non-droitiers ; c’est l’inverse pour les délinquants ayant un score plus élevé dans la dimension interpersonnelle/affective de la psychopathie.
La dimension comportementale de la psychopathie peut être « conceptuellement plus proche du trouble de la personnalité antisociale », rapportent les chercheurs. La psychopathie a toujours été considérée comme un trouble mental, mais de plus en plus d'éléments indiquent qu'il pourrait s'agir d'une stratégie adaptative conçue par la sélection naturelle.
Pourquoi les sociopathes sont présents dans notre société alors que la sélection naturelle aurait dû les éliminer ?
Tout d’abord, la société sait faire avec ceux qui ne respectent pas les règles, les lois. Ils sont arrêtés, jugés voire emprisonnés selon le délit, le crime. 60% des prisonniers de sexe masculin montrent des signes de personnalités antisociale (Moran, 1999). Nos ancêtres ne plaisantaient pas, la mort, la torture, l’exil, le bannissement prévalaient et c’est toujours le cas chez d’autres animaux comme les lions et les loups.
Dans notre société, « punir » un antisocial, un psychopathe est un facteur favorisant la coopération au sein du groupe. C’est une réponse au service de la survie et de la reproduction par le biais de la coopération.
Ensuite, l’antisocial est un membre à part entière de la société, du groupe, il n’est pas vu comme un étranger. Comme il s’agit d’un membre intra groupe, il sera jugé comme tel.
Enfin, le sociopathe ne peut pas agir différemment, il ne changera pas quoiqu’on fasse ! Il y a 2 critères importants dans le passage à l’acte : la capacité à tromper autrui, ce qui demande maîtrise de soi et anticipation ; et l’impulsivité qui est une incapacité à planifier à long terme.
La sélection naturelle, au niveau du groupe, a autorisé l’expression du comportement antisocial à la condition que l’impulsivité restreigne la capacité à tricher. On peut penser aussi que ceux qui ne sont pas impulsifs vont demeurer toute leur vie non découverts (Mc Guire & Troisi, 1998) tant qu’ils ne cèdent pas à l’impulsivité.
Les antisociaux, les psychopathes ne sont pas prêts de ne plus exister dans notre société dans la mesure où les impulsifs sont arrêtés, jugés et emprisonnés, et que les non impulsifs en tirent parti et transmettent leurs gênes (parce qu’ils ne sont pas pris ou qu’ils ne commettent pas de délis). Pour nos ancêtres, être rejetés du groupe s’avérait être fatal, c’était la mort assurée puisque plus de moyen de subsistance. Donc certains ont appris à s’adapter en se contrôlant et ont transmis leur patrimoine génétique.
Que serait une société sans psychopathe ?
Ce serait une société extrêmement coopérative au point d’être exploitée jusqu’à la lie par une autre société qui n’aurait pas le même comportement coopératif. Alors que la présence d’un psychopathe pousse le groupe à s’adapter en trouvant des solutions pour s’en protéger. La sociopathie est un ensemble simple et assez bien défini de comportements caractérisés par une incapacité à participer honnêtement aux différentes interactions sociales.
Axelrod concluait que la réciprocité et ce qu’il a appelé la « gentillesse » étaient généralement des stratégies nécessaires et requises pour les acteurs sociaux. Pour rappel, le dilemme du prisonnier caractérise une situation dans laquelle des acteurs économiques concurrents, qui ne communiquent pas entre eux, prennent des décisions rationnelles basées sur la recherche de leur propre intérêt mais qui, ce faisant, desservent l’intérêt collectif.
En revanche, ce qu’Axelrod n’a pas souligné, c’est que la tricherie, la non-réciprocité est une stratégie gagnante pour les personnes qui ne s’engagent pas dans de longues interactions et qui privilégient la stratégie r. Une stratégie dont l’environnement est variable ou perturbé, une stratégie d’opportunisme.
Les tricheurs ne reculent jamais, minimisant ainsi leur risque immédiat de rencontrer le même partenaire deux fois de suite, ils changent de groupe régulièrement ce qui génère un coût pour lui puisqu’il est obligé de changer régulièrement d’environnement social pour pouvoir mentir et profiter d’un nouveau groupe. Plus un tricheur interagit avec le même groupe de congénères, plus il est susceptible d’être confondu par le groupe. De ce fait, ils ne sont pas détectables par des instruments (verbal, non verbal…) couramment disponibles à ses congénères.
Les tricheurs sont des bonimenteurs ou doués d’empathie cognitive, c’est-à-dire la capacité à comprendre les états mentaux de l’autre, sa façon de réfléchir, ses inflexions.
Les antisociaux, les psychopathes n’ont-ils pas d’empathie ?
Une caractéristique également fréquemment admise comme faisant partie du tableau clinique de base du psychopathe est le manque d’empathie. Ce concept est souvent utilisé de façon superficielle. L’empathie est à la compréhension et la connaissance ce que la sympathie est à la compassion et l’attention au bien-être de l’autre. La connaissance issue du processus empathique est intuitive et implicite.
Posons la question différemment : est-ce que les autistes ont de l’empathie ?
Dans une étude de 2022, les perceptions au sein d’un groupe de participants avec Trouble du Spectre Autistique ont été comparées à celles d’un groupe témoin reflétant la population générale. Cette approche inédite reposait sur un questionnaire photographique en ligne incluant divers organismes allant des plantes aux êtres humains. Des paires de photographies d’organismes étaient tirées au sort
et présentées aux participants qui devaient alors désigner celle pour laquelle ils pensaient être le mieux à même de comprendre les émotions.
À partir de ces nombreux « matchs » entre paires de photographies, il a été possible d’attribuer un score d’empathie à chaque espèce. Les résultats obtenus ont montré que si les perceptions au sein du groupe de participants avec TSA sont globalement similaires à celle de la population générale, le score de compréhension empathique qu’ils attribuent à l’être humain est étonnamment faible.
Ces résultats indiquent que les difficultés empathiques des personnes avec TSA seraient propres aux relations interhumaines. Celles-ci pourraient donc ne pas tant résulter de l’altération de la perception ou de la lecture d’expressions émotionnelles fondamentales, que de difficultés à leur donner du sens dans un contexte global. Percevoir une expression émotionnelle (reconnaître ou être affecté par un rire, un pleur ou un froncement de sourcils…) n’implique pas nécessairement une compréhension correcte de l’état mental qui en est la cause : hors contexte, ces signaux peuvent être déconcertants ou trompeurs (par exemple, des larmes de joie ou des rires nerveux).
Avec ou sans TSA, les perceptions empathiques des deux groupes de participants sont très similaires pour la majorité des espèces, à une exception près : les scores de compréhension empathique que les personnes avec TSA attribuent à notre espèce sont très faibles.
Les particularités empathiques des personnes avec TSA pourraient s’expliquer par le fait que si les autres espèces peuvent sembler moins expressives et plus difficiles à interpréter intuitivement, leur expression émotionnelle est en revanche plus déterministe, spontanée et stéréotypée. L’état mental d’un animal pourrait donc être perçu par les personnes avec TSA comme relativement transparent, pour peu d’être attentif à leurs signaux comportementaux et d’avoir appris à les interpréter.
Au contraire, dans bien des situations, les humains sont habitués à feindre, à détourner ou à contenir
leur expression émotionnelle, qu’il s’agisse de préserver leur intimité, de se conformer aux conventions sociales, par stratégie de bluff ou par comédie. Ils pourraient donc, d’une certaine façon, être considérés comme étant bien plus complexe à comprendre à que d’autres animaux. Suite à ces résultats, nous pouvons arguer que les antisociaux, les psychopathes sont bien pourvus d’empathie au moins cognitive.
L’empathie implicite, en tant que faculté intuitive de se représenter le vécu d’autrui (que ce soit au niveau émotionnel, sentimental ou cognitif), lorsqu’elle est défaillante, indique plutôt un diagnostic de psychose que de psychopathie. En revanche, nous pouvons parler d’un « trouble de la sympathie ». Le psychopathe n’a pas de difficulté à identifier le vécu d’autrui, il n’accorde aucune importance à ce vécu en termes de bien-être pour autrui. L’analyse d’autrui et de son vécu est strictement utilitaire et n’est pas source de préoccupation ou d’attention. Un psychopathe peut par exemple décrire la souffrance de ses victimes (il fait alors preuve d’empathie) et peut expliquer que cela lui importe peu (il n’éprouve pas de sympathie).
Le psychopathe présente un trouble de la sympathie, c’est-à-dire qu’il a la faculté de se représenter l’éprouvé émotionnel de l’autre sans en être affecté, grâce à une gestion « froide » de l’émotion. Cette logique a foncièrement une dimension adaptative dans des circonstances extrêmes. Considérer que la psychopathie présente une dimension adaptative implique qu’il soit cohérent de retrouver ce fonctionnement psychologique en dehors du parcours judiciaire. Cette dimension adaptative révélée par la « froideur émotionnelle » est évidente dans de nombreuses situations de notre société économique moderne. On peut également penser que, lors d’une invasion ennemie en temps de guerre, il est bien plus adapté de présenter des conduites de chosification de l’alter ego, une absence de sympathie tout en conservant une compréhension empathique de l’autre, que d’être foncièrement bienveillant et altruiste.
Les antisociaux, les psychopathes sont donc un mal nécessaire… peut-être en côtoyez-vous sans le savoir…
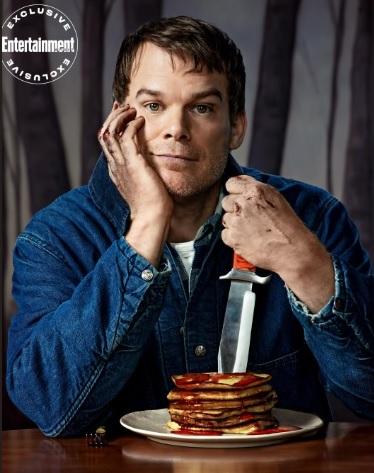
Sources :
https://doi.org/10.1177/14747049211040447
Psychiatrie, Guelfi, Boyer, Consoli, Olivier-Martin – puf Fondamental
Moran P (1999). The epidemiology of antisocial personality disorder. Social Psychiatrie and Psychiatric Epidemiology, 34 : 231 – 242
Mc Guire & Troisi (1998). Darwinian Psychiatry. Oxford University Press. New York, Oxford.
Is Psychopathy a Mental Disorder or an Adaptation ? Evidence From a Meta-Analysis of the Association Between Psychopathy and Handedness, Lesleigh E. Pullman, Nabhan Refaie, […], and DB Krupp
Troubles de personnalité & évolution. Dragoslav Miric, Mardaga, 2012.
The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Self-perceived empathic abilities of people with autism towards living beings mostly differs for
Humans
MacArthur, R. and Wilson, E. O. (1967). The Theory of Island Biogeography, Princeton University Press (2001 reprint), ISBN 0-691-08836-5
Miralles A., Grandgeorge M., Raymond M. - Scientific Reports volume 12, Article number: 6300 (15
April 2022)
Showtime – New Blood : Dexter
La jalousie vue par la psychologie évolutionniste
Le 11/08/2023
La jalousie est une forme d’adaptation, une solution développée au fil du temps en réponse à un problème récurrent qui menace la pérennité de l’espèce. Elle nous pousse à tenir éloigné nos rivaux à distance. Elle empêche notre partenaire de s’éloigner grâce à une vigilance constante ou à un maximum d’affection. Elle induit l’idée d’engagement à un partenaire hésitant (jalousie hors pathologie évidemment).
Mais il faut faire la distinction entre la jalousie sexuelle et sentimentale. Les hommes sont plus enclins à s’imaginer faire l’amour à plusieurs partenaires mais sans engagement, alors que les femmes s’engagent dans une relation physique généralement lorsqu’elles ressentent des sentiments.
C’est une lapalissade que de dire que les femmes ont besoin de 9 mois pour produire un enfant, alors que les hommes n’ont besoin que de quelques minutes pour produire ce même enfant. L’investissement parental est donc biaisé dès le départ. « Un gouffre sépare donc l’effort consenti par les hommes des neufs mois que consacrent les femmes à l’éclosion d’une nouvelle vie » (Buss).
La stratégie d’unions occasionnelles est donc plus profitable, a priori, aux hommes qu’aux femmes sur le long terme, dans le but de multiplier ses gènes. Tout au moins pour ceux qui séduisent le plus grand nombre de partenaires plutôt que ceux qui ont un nombre limité de partenaires.
Pour celles qui choisissent néanmoins d’avoir plusieurs partenaires, le bénéfice perçu doit être suffisamment important pour justifier la prise de risque et ses conséquences.
Un premier avantage est le gain de ressources fourni par ses partenaires occasionnels (diners, cadeaux, sorties, voyages…).
Un second avantage est un bénéfice génétique. Les femmes choisissent généralement pour amant des hommes plutôt symétriques et en bonne santé, gage de transmission de patrimoine génétique sain. Les femmes qui ont aussi des amants sont aussi celles qui sont susceptibles de produire des enfants avec une plus grande diversité génétique.
Un troisième avantage est ce que David Buss appelle l’« assurance partenaire ». C’est-à-dire la possibilité de se remettre avec quelqu’un rapidement en cas de défaillance du premier (maladie, décès, guerre, séparation…). Baher et Bellis (« Human sperm competition », 1995) ont montré que les femmes infidèles ont tendance à faire coïncider leurs aventures extra conjugales avec leur période d’ovulation, alors que les relations sexuelles avec leur mari le sont en dehors de cette période. Il a été également constaté que la rétention du sperme est plus importante avec l’amant que le mari.
Pour quelles raisons avoir une relation extra conjugale ?
Avant d’apporter une réponse Darwinienne, replaçons le couple à notre époque individualiste. Hommes et femmes vont voir ailleurs parce que les uns comme les autres ne trouvent pas leur compte dans leurs relations sexuelles. Ce peut être en termes de quantité, en termes de qualité, de désir ou encore dans l’éventail des positions et/ou des pratiques acceptées, toute paraphilie mise de côté. Lorsque l’un ou l’autre se trouve lésé ou non contenté, il peut gérer la frustration jusqu’à un certain seuil au-delà duquel il y a un risque potentiel. Il est donc important d’être à l’écoute de l’autre et de son plaisir.
Suite aux divers travaux de David Buss et ses collègues, les stratégies reproductrices reposent sur le court terme et sur le long terme. Pour le court terme, les hommes veulent une variété de matrices pour multiplier les possibilités de produire des enfants (en plus de la diversité recherchée des pratiques sexuelles). Pour les femmes, c’est la possibilité de multiplier la variété génétique (en plus de la diversité des pratiques sexuelles).
Les critères de préférence dans le choix d’un partenaire pour le long terme sont pour les femmes le statut social, la capacité de travail et les perspectives financières. Il est donc plus profitable pour une femme d’épouser un homme moins beau que la moyenne mais qui saura lui apporter une stabilité émotionnelle, financière et qui saura prendre soin de leur progéniture.
Pour les hommes, c’est l’attrait physique qui compte et ce sont des critères universels, nonobstant quelques variations culturelles pour des critères comme le poids, la couleur des cheveux et la taille (Ford et Beach, 1951, « patterns of sexual behaviour », New York).
Mais pour qu’une relation dure, il faut des signes d’engagement, accorder du temps et des efforts, de l’attention de la part des deux partenaires. Après la fiabilité (critère partagé par l’homme et la femme), c’est celui de la maturité émotive qui est attendu avec un bon caractère (Buss et col., n = 9474 issus de 37 cultures différentes, 1990, « international preferences in selecting mates : a study of 37 cultures », Journal of psychology, 21, 5-47).
Une femme peut également se servir d’une liaison pour rompre avec son mari. Grâce à une estime de soi reboostée, un gain de confiance, une sensation de pouvoir encore séduire et jouir. Ce sera le premier pas vers l’autonomie.
Pourquoi la femme n’épouse-t-elle pas l’homme qu’elle a eu pour amant ?
Parce que dans le long terme, il n’est pas pourvoyeur de ressources stables, son investissement parental serait moins optimal que celui de son mari. D’autant que la décision de se mettre en couple est toujours une incertitude et que certains hommes profitent de cette incertitude pour multiplier les conquêtes et potentiellement un nombre important de « matrices ».
Les personnes jalouses se montrent très sensibles aux changements comportementaux et physiques, tout autant qu’aux indices laissés involontairement ici et là. La jalousie se déclenche souvent par des circonstances qui signalent une menace bien réelle pesant sur le couple. Lorsqu’on se pose la question, c’est qu’il y a déjà des signes avant-coureurs. Ça ne veut pas dire que la tromperie a été réalisée, mais l’envie et le désir sont là.
Daly et Wilson (Université de McMaster – Ontario) définissent la jalousie comme un « état déclenché par la perception d’une menace pesant sur une relation ou une position importante et qui motive un comportement destiné à contrer cette menace. »
Une émotion peut être vue comme une adaptation qui sert à identifier une menace. Cette émotion attire notre attention sur l’origine de la menace et stocke l’information dans notre mémoire, ainsi que le comportement qui s’ensuit.
Shackelford, Buss et Bennett (1999, « sex differences in responses to a partner’s infidelity ») ont montré que les hommes se sentent plus en détresse psychologique face à une infidélité sexuelle, alors que les femmes le seront face à une infidélité affective. L’homme se montrera plus agressif pour stopper la tromperie (33 féminicides depuis le début de l’année, 208 000 victimes en 2021, 87% de femmes) et la croyance de tromperie, la femme sera plus dans le déni, dans le rendu coup pour coup, ou dans l’acceptation du fait du coût de l’investissement.
La jalousie est donc un moyen de défense contre la tromperie et l’abandon. Il y a toujours de fausses alertes mais statistiquement, l’histoire nous montre que les signes précurseurs étaient déjà présents. Si l’on se montre à l’écoute de l’autre intellectuellement, émotionnellement et sexuellement, il n’y a pas de raison pour que l’on aille voir ailleurs. Mais cela suppose de l’abnégation et des efforts.
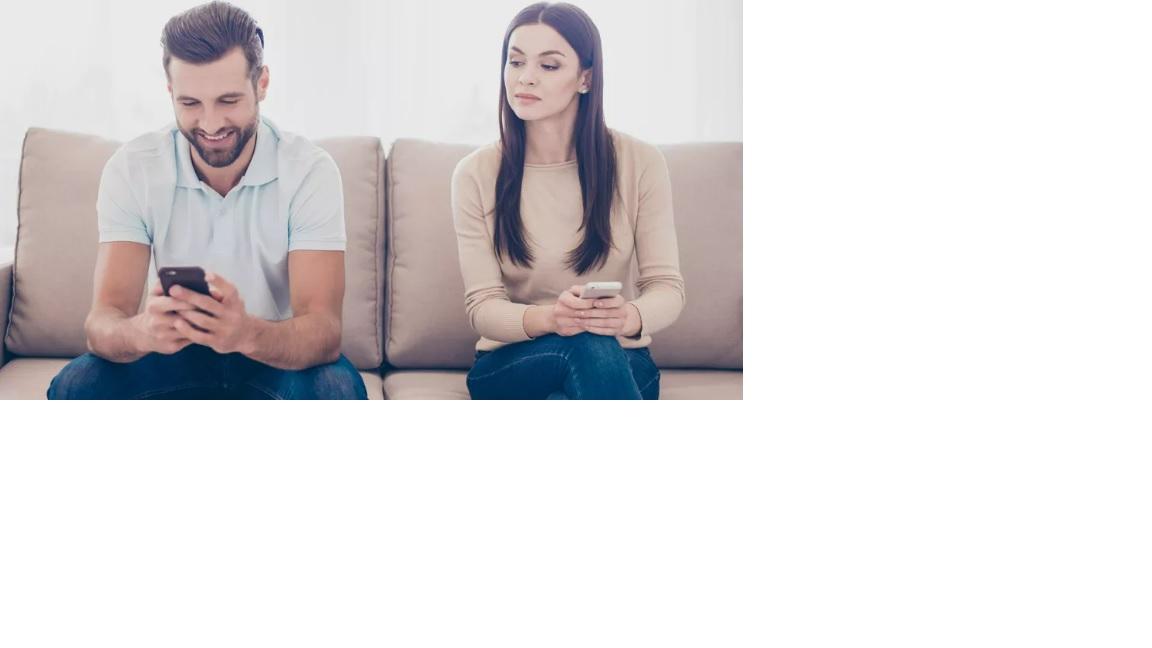
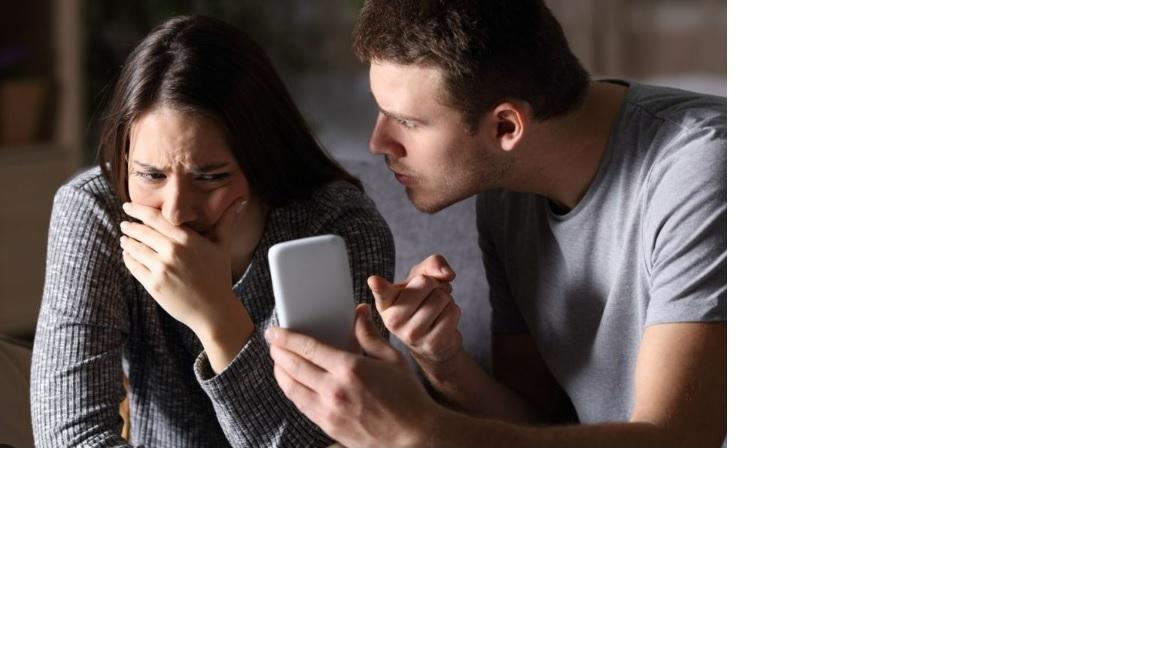
Une distance analytique
Le 23/07/2023
Un certain nombre de personnes m’ont souvent reproché d’être peu investi émotionnellement, d’être trop froid, de ne pas pouvoir « être lu », d’être trop distant. Alors au-delà du fait qu’il est difficile pour ces personnes d’échanger avec des arguments et de manière contradictoire, au-delà de ma particularité de « haut potentiel » teinté d’un trait autistique (C'est quoi un zèbre ? - Suivez le Zèbre (suivezlezebre.com), je me suis posé cette question :
Que signifie prendre de la distance par rapport aux évènements, à une situation ? Que ce soit dans un contexte familial ou professionnel en tant que psy par exemple.
Prendre de la distance c’est analyser froidement la situation, l’enchaînement des faits, des réactions, en mettant de côté les émotions. C’est imaginer toutes les options possibles sans se mettre de barrières. Barrières relatives à notre vécu, notre expérience qui nous a confrontés aux mêmes situations. C’est appliquer de la distanciation entre soi et la réalité afin d’aborder les choses avec objectivité, dénué d’affect, c’est considéré avec détachement pour apprécier de façon impartiale.
Sauf que nous n’avons vécu que NOS situations en relation avec NOTRE environnement direct, notre foyer, nos parents, nos amis… ce sont donc nos références, pas celles des autres. Notre expérience ne signifie rien chez l’autre qui a ses propres valeurs, qui a fait ses propres expériences. Ses réactions peuvent donc être totalement différentes des nôtres dans un même contexte, elles peuvent même être contradictoires avec les nôtres.
C’est ça qu’il faut garder à l’esprit, être ouvert et se dire que tout est possible, que la nature humaine peut être très créative en matière de fonctionnement et de réactions aux situations rencontrées.
Cette compétence de distanciation peut être consciente ou inconsciente mais elle est plus prégnante chez certains. C’est de l’empathie cognitive (Economie du sadisme ordinaire (ds2c.fr)), de la tempérance (Vers la tempérance... (ds2c.fr)), une lecture purement analytique et comportementaliste, dénué de jugement de valeur. C’est avoir la capacité de relativiser et de replacer toute chose dans son contexte. Mais c’est aussi vouloir se protéger de l’afflux d’informations, des émotions parce qu’on les perçoit plus finement que les autres. C’est rester dans un équilibre émotionnel qui donne la possibilité d’analyser la situation de façon plus distanciée et de pouvoir décider de façon plus efficiente.
Après tout ça, je suis un pur produit de John Broadus Watson, un neo behavioriste freudien !
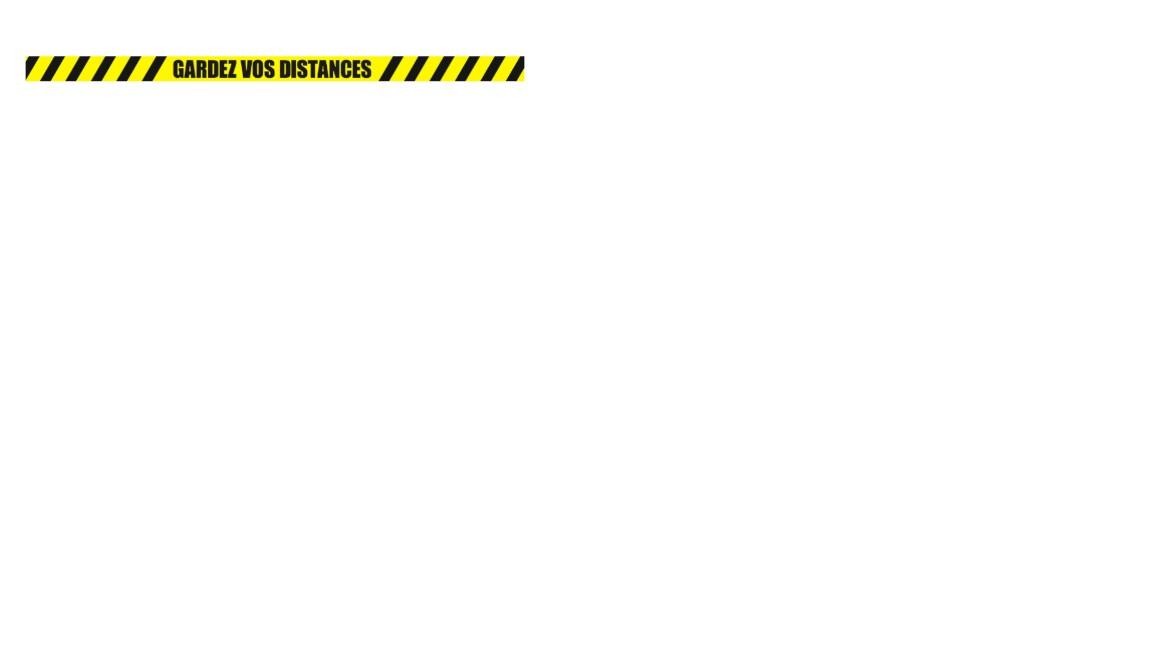
Pourquoi je me touche la barbe ?
Le 17/06/2023
Que se cache-t-il derrière la barbe ? Si je la caresse, la tire ou la gratte, qu’est-ce que ça veut bien dire ?
J’avais analysé les aspects sociaux et psycho évolutionnistes dans un précédent article consacré à cet attribut. En substance, pour ce qui est de son rôle social, la barbe est essentiellement un élément fort d’inclusion, c'est-à-dire du désir d’appartenance à un groupe, à une communauté (hippie, hipster, crossfit, religieuse…).
Si le groupe de référence auquel je souhaite appartenir et m’identifier se différencie des autres par le port de la barbe, je vais vouloir également la porter pour être reconnu et intégré à ce groupe dans lequel je me reconnais. Je vais personnifier ce groupe, j’en serai un digne représentant et mes valeurs seront alors visibles au premier coup d'œil.
Donc, si nous raisonnons par rapport à l’impact que nous souhaitons avoir auprès des autres, le port de la barbe est un indicateur fort et fiable d’appartenance.
Maintenant, la barbe cache une partie du visage et en particulier la bouche. La bouche est très importante pour communiquer des émotions, même si la personne ne parle pas. Elle s’étire, se crispe, ses lèvres rentrent dans la bouche, se mordillent, s’entrouvrent… Elle nous en dit long sur nos intentions.
Porter la barbe sert aussi à cacher des intentions que la personne n’assume pas réellement, ou qui ne veut pas les exprimer.
Par exemple, si une personne est timide mais physiquement athlétique, pour équilibrer son état d’esprit et ce que son corps renvoie comme image, la barbe peut être un bon moyen pour qu’elle se sente plus assurée.
A contrario, si une personne est a un caractère assertif mais physiquement frêle ou en surpoids, la barbe peut être un moyen pour se doter d’une image plus représentative de son caractère.
En psychologie évolutionniste, la barbe est un caractère sexuel secondaire qui joue un rôle majeur dans la compétition sexuelle (intra et inter).
“La sélection sexuelle est reconnue pour opérer principalement de deux façons. D’une part, avec la sélection intersexuelle, les femelles et les mâles cherchent le partenaire aux attributs les plus attirants. Cet attribut peut être physique (la queue du paon) ou comportemental (les danses nuptiales).
Et d’autre part, la sélection intrasexuelle qui favorise une compétition entre les individus de même sexe. Ce sont par exemple les mâles qui vont se battre entre eux pour l’obtention d’une femelle. C’est aussi les hiérarchies de dominance qui s’établissent chez plusieurs espèces et qui donnent un accès prioritaire aux individus du sexe opposé.”
Le port de la barbe est un outil d’aide pour améliorer, renforcer, la posture, l’assurance, le charisme.
Dans son livre "Evolution of human threat display organs" (1970), R. D. Guthrie a émis l'hypothèse que la barbe pouvait être utilisée pour intimider les rivaux masculins en augmentant la perception de la taille de la mâchoire et en renforçant les comportements agressifs. Des recherches ont révélé que les gens reconnaissent plus rapidement les expressions de colère sur un visage barbu que sur un visage rasé, mais qu'ils sont plus lents à reconnaître les expressions de bonheur ou de tristesse.
Les systèmes visuels humains ont évolué pour extraire des informations de l’environnement des informations pertinentes. En psycho évolutionniste, il est vital qu’un individu identifie très rapidement un ennemi potentiel. Logiquement, le visage, dans sa tâche de recherche visuelle au sein de la foule, est plus orienté à reconnaître la colère.
Dans 3 études (N = 419), des chercheurs ont testé si la pilosité faciale guidait l'attention dans la recherche visuelle et si elle influençait la vitesse de détection des expressions faciales de colère et de joie.
Dans la première étude, les participants étaient plus rapides à chercher, dans une foule rasée, à détecter des cibles barbues qu'à chercher dans une foule barbue et à détecter des cibles rasées.
Dans la seconde étude, les cibles étaient des visages en colère et des visages heureux présentés sur un fond neutre. La pilosité faciale des visages cibles a également été manipulée. Un effet de supériorité de la colère est apparu et a été renforcé par la présence d'une pilosité faciale, ce qui était dû à la détection plus lente de la joie sur les visages barbus.
Dans la troisième étude, les cibles étaient des visages heureux et en colère présentés sur des arrière-plans barbus ou rasés de près. La pilosité des visages de l'arrière-plan a également été systématiquement manipulée. Un effet significatif de supériorité de la colère a été révélé, bien qu'il n'ait pas été modéré par la pilosité faciale de la cible. Au contraire, l'effet de supériorité de la colère était plus important sur les visages rasés que sur les visages barbus.
L'ensemble des résultats suggère que la pilosité faciale influence la détection des expressions émotionnelles dans la recherche visuelle. Cependant, plutôt que de faciliter l'effet de supériorité de la colère en tant que système potentiel de détection des menaces, la pilosité faciale peut réduire la détection des visages heureux dans la foule.
La barbe joue un rôle important, mais nuancé, dans l'allocation de l'attention dédiée aux visages. Elle peut faciliter l'allocation de l'attention à une cible et ralentir la recherche visuelle lorsque les visages en arrière-plan sont barbus.
Les recherches actuelles présentent certaines limites importantes. Par exemple, un biais attentionnel peut se produire en faveur des stimuli émotionnels désagréables par rapport aux stimuli émotionnels agréables. La colère est une émotion à forte intensité négative qui vise à induire la soumission chez les autres, alors que le bonheur est une émotion à forte intensité positive, mais prosociale. Les effets de la barbe sur les taux de détection des expressions faciales menaçantes par rapport aux expressions prosociales peuvent refléter un biais attentionnel envers les stimuli désagréables.
Maintenant, abordons ce que la triturer veut dire, en tirer les poils, la caresser ou poser simplement sa main dessus.
Tout d’abord, la zone de contact est importante quant à la signification. Elle peut avoir un rapport avec un problème connu ou à résoudre (zone de la moustache), nous pouvons nous sentir concerné par les informations qui nous sont communiquées (zone de la joue, de la mâchoire), nous pouvons également nous sentir flattés (zone du menton) voir être tout à fait satisfait (zone sous la mâchoire).
Mais un geste d’auto-contact est avant tout un moyen pour rééquilibrer notre psyché, ce sont des gestes “contraphobiques”, ils nous aident à gérer notre stress.
Pour un profil psychologique du type “dominant” dont la préoccupation principale est le résultat, se gratter la barbe permettrait la réflexion pour une éventuelle riposte.
Pour un profil orienté vers la communication, ce geste permettrait de susciter l’imagination, la création.
Pour un profil plus analytique, ce serait un moyen de comprendre ce qui est dit.
Enfin, pour un profil plus relationnel, dont la préoccupation est l’équilibre avec les autres, ce serait un moyen de gérer le stress.
Le plus souvent, ce sont des micros-caresses que nous faisons sur la barbe (66%), puis loin derrière les micro-tractions (16%) et les micros-fixations (13%).
Concernant les micros-tractions, selon JP Brechon (synergologue) : “ce comportement serait un toc nommé la trichotillomanie et intéresse les profanes comme les scientifiques. Ce toc dont les causes sont peu connues viendrait de traumatismes provoquant des angoisses à répétitions mais la cause la plus certaine serait le stress d’où l’expression populaire (« avoir envie de s’arracher les cheveux ») mais l’angoisse et l’ennui peuvent également causer ce comportement. Ce n’est donc pas tout à fait un trouble obsessionnel compulsif mais plutôt un comportement procurant du plaisir, activant le circuit de la récompense dans le cortex préfrontal.”
Concernant les micros-fixations, “aucune référence scientifique nous permet d’expliquer, à ce stade, pourquoi les sujets fixent leurs mains sur leurs visages. Seules les associations d’items et le sens de l’observation nous permettent de déterminer que la plupart des sujets sont soit en attente de quelque chose lorsqu’ils sont émetteurs silencieux, soit ils lancent « un pavé dans la mare » afin de voir qu’elle sera la réaction de leur interlocuteur, soit ils réfléchissent à un sujet et attendent la fin de leur réflexion avant de parler.”
Enfin, la micro-caresse est le geste qui est le plus souvent effectué sur la barbe. Elle permettrait de se calmer, de se recentrer sur la conversation.
Vous ne regarderez plus un barbu de la même façon maintenant et tout un tas de questions émergeront !
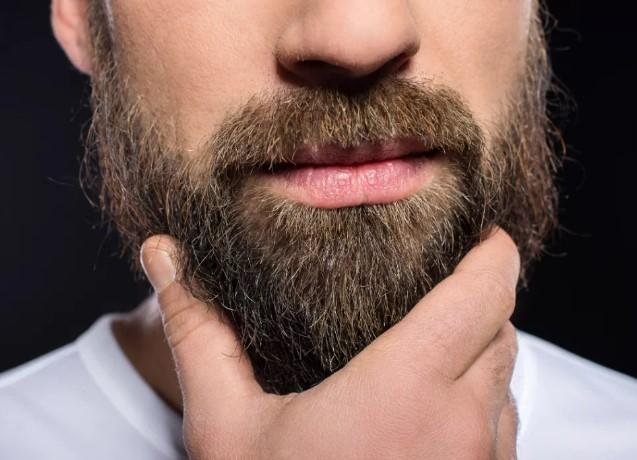
Réf. :
Dixson, B.J.W., Spiers, T., Miller, P.A. et al. Facial hair may slow detection of happy facial expressions in the face in the crowd paradigm. Sci Rep 12, 5911 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-09397-1
Craig, B. M., Nelson, N. L., & Dixson, B. J. W. (2019). Sexual Selection, Agonistic Signaling, and the Effect of Beards on Recognition of Men’s Anger Displays. Psychological Science, 30(5), 728–738. https://doi.org/10.1177/0956797619834876
Baby shower
Le 30/05/2023
Baby Shower
En Amérique (du Sud et du Nord) et en Angleterre (ça arrive en France), il est commun que la future maman organise une « baby shower » autour du 7ème ou 8ème mois de grossesse pour célébrer la future naissance. C’est là une bien belle occasion d’offrir des cadeaux à la mère et au futur bébé.
La famille est donc ici réunie avec les amis, tous bien apprêtés et fins prêts pour la célébration. Le père est en veste bleue, la future maman est facilement reconnaissable avec son ventre bien rond et en background un homme en chemise rouge. Un ami de la famille je présume. A la gauche du mari, un homme avec une mallette (information capitale).
L’homme en chemise rouge met sa main droite devant sa bouche (40 sec) au moment où le mari, en veste bleue donc, dit qu’il a la preuve que ce n’est pas de 4 mois que sa femme est enceinte mais de 6 mois (on se trompe de 2 mois, ça peut arriver).
La main droite symbolise la relation que nous avons avec le monde extérieur et le geste de la porter devant sa bouche illustre l’idée qu’il vaut mieux se taire. L’homme s’empêche de parler, de réagir.
Le mari annonce à sa femme que se n’est pas possible qu’il soit le père, à cause de ces 2 mois d’erreur. Ce même homme en rouge se gratte la gorge (51 sec) lorsque la femme enceinte se lève pour dire à son mari de rester calme et tranquille. Son mari le lui confirme, qu’il est calme et tranquille.
Toujours de la main droite, le geste de la porter à sa gorge symbolise l’envie d’en parler mais que certaines difficultés, liées à l’environnement bien sûr et à la situation, limitent la communication. Peut-être serait-ce de bon ton de ne vraiment rien dire, isn’t it ?
L’homme en chemise rouge passe sa main sur son front et sa tête (1 min. 2 sec) quand l’avocat du mari montre l’ordinateur avec la vidéo de la femme enceinte et de son amant : l’homme en rouge. Le geste de la résignation, du dépit, du « comment vais-je m’en sortir ? ».
Il se pince enfin la gorge quand le mari évoque la vidéo de son meilleur ami et la trahison qui dure depuis des années. Clairement, il n’y a rien que l’« ami de longue date » ne puisse dire qui ne l’enfoncerait davantage !
Intéressant non ?
Lien vers la vidéo :
https://twitter.com/Youridefou/status/1662912254059192322?s=20
Les 4 phases de la tendance
Le 24/12/2022
Franz BRENTANO, philosophe et psychologue autrichien (fin XIXème, début XXème), est connu pour avoir développé le concept d’intentionnalité. Parmi ses élèves, nous retrouvons notamment Husserl, le père de la phénoménologie, rien de moins… Brentano avait mis au cœur de son programme philosophique une théorie des quatre phases de l’histoire de la philosophie.
“Cette théorie prend son point de départ dans l’observation de certaines régularités dans le cours de l’histoire de la philosophie et elle repose sur l’hypothèse que l’on peut identifier, au sein de chacune des trois grandes périodes de son histoire, c’est-à-dire l’Antiquité, le Moyen Age et la Modernité, quatre phases ou moments, la première étant ascendante, et les trois trois dernières marquant son déclin” (D. Fisette).
Ce qui est intéressant avec cette théorie est qu’elle peut également expliquer et mettre en lumière l’évolution d’une tendance. Qu’elle soit vestimentaire, capillaire, verbale ou comportementale, les quatre phases expliquent le chemin parcouru de l’ascension jusqu’à son remplacement par une autre tendance. Je dis “tendance”, mais ces phases fonctionnent avec à peu près tout, y compris les stratégies comportementales basées sur les émotions et sur les comportements qu’il est de bon ton d’adopter lorsque tel sujet est abordé (social, politique, religieux, économique, humanitaire…).
L’ascendance
Au départ, l’intérêt pour une coupe de cheveux, une façon de marcher, de parler et de s’habiller naît au sein d’un groupe identitaire.
Ce fut le cas pour la grosse moustache chez les homosexuels des 80’s, des blousons anglais “harrington” avec polo Fred Perry chez les skinheads, la démarche des rappeurs et le pan de pantalon remonté sur le mollet, la coupe de cheveux de Presnel Kimpembé… et je ne parle pas des tics de langage (“wesh”, “du coup”...) mais c’est encore plus prégnant avec la mode du tatouage.
Chacun de ces tics, chacune de ces tendances est née au sein d’une tribu, d’un groupe spécifique, identitaire puis ont été repris et démocratisés chez les tout-venants.
L’affaiblissement
L’intérêt pour le tic, la tendance, s’affaiblit au sein du groupe identitaire qui va se mettre à la recherche inconsciemment d’un autre signe distinctif. Lorsque le groupe voit que ses signes distinctifs sont un peu trop généralisés, la nécessité de se réaffirmer et de se reconnaître revient.
Évidemment, le précédent tic a été remarqué par le plus grand nombre, démocratisé, d’où une perte de rigueur et de précision quant à sa réelle définition, sa mise en pratique, sa spécificité. Il a perdu de sa substantifique moelle, comme un mot qui sonne creux, vide de sens.
Le tic est tombé dans le tout-venant par l’intermédiaire des réseaux sociaux, les influenceurs (le paroxysme du vide, je ris pardon, peu sont divertissants mais ceux-là s'inscrivent justement dans une démarche de création) et autres manifestations propres à chaque groupe.
La construction de dogmes
C’est à dire une proposition théorique établie comme une vérité indiscutable, autoritaire et normative, par l’autorité qui régit une certaine communauté ou groupe. Le tout-venant s’accapare ces tendances, ces tics et leurs inventent une nouvelle légitimité et paternité. Il spolie en quelque sorte le groupe initial. Chacun peut revendiquer d’être à l’origine du tic, de la tendance.
La dégénérescence
C'est-à-dire la perte des qualités intrinsèques et naturelles des caractéristiques initiales. L’intérêt tombe en désuétude pour le tout-venant qui cherche une autre façon d’exister, de se démarquer, de combler les vides de sa propre existence en reprenant à son compte d’autres expressions, d’autres coupes de cheveux qu’un authentique créatif aura lui, fait naître.
Voilà les quatre phases qui fonctionnent avec TOUTES les tendances dans la plus stricte tradition mercantile, c’est du business pour ceux qui surfent sur la vague ; c’est du social pour ceux qui s’y reconnaissent réellement. Le truc encore plus sophistiqué, mais les marques de cosmétique, de prêt à porter (entre autres) l’ont déjà bien compris, c’est de créer une pseudo-valeur identitaire autour de leur propre marque ou d’une tendance.
Si vous avez un ardent désir de vous reconnaître une identité, c’est légitime, essayez déjà de connaître vos valeurs propres. Il y a un effort d’introspection à faire.
Ensuite il est possible de rechercher quel groupe a en commun vos valeurs. Mon opinion est que trop souvent les individus cèdent à la facilité et ne cherchent pas à se connaître. Ils épousent donc un tic qui semble plaire au plus grand nombre et qu’en soi, ce doit être bon pour eux, pour leur ego… ce sont en réalité de faux-semblants ou biais de conformité.
Mais ce n'est que mon opinion ;-)
Que cache la barbe ?
Le 13/10/2022
Voici quelques idées préconçues à propos de la barbe sur lesquelles je ne vais absolument pas m'appesantir tellement ça n’a aucun intérêt - hormis celui de rechercher du clic :
- la barbe ça fait sale (je nettoie la mienne chaque jour avec un shampoing dédié…),
- la barbe ça n’est pas présentable (vous auriez dû me voir à mon mariage…),
- la barbe ça fait peur (quelle mauvaise expérience avez-vous eu avec un barbu ?),
- la barbe c’est incompatible avec le travail (peignée elle passe très bien),
- la barbe ça prend du temps à entretenir (le temps est une donnée relative),
- la barbe ça n’attire pas (l’attirance ne se commande pas).
Ce qui est plus intéressant en revanche, c’est d’analyser les aspects plus sociaux, psycho et psycho évo !
Pour ce qui est de son rôle social, la barbe est essentiellement un élément fort d’inclusion, c'est-à-dire du désir d’appartenance à un groupe, à une communauté.
Si le groupe de référence auquel je souhaite appartenir et m’identifier se différencie par le port de la barbe, je vais vouloir également la porter pour être reconnu et intégré à ce groupe. Je vais personnifier ce groupe, j’en serai un digne représentant et mes valeurs seront alors visibles au premier coup d'œil.
Par exemple, les beatniks (seconde moitié des années 1960) étaient des jeunes anticonformistes qui s’opposaient au pouvoir bourgeois de l’époque et à la société de consommation. Le port de la barbe était un élément de révolte.
Un peu plus tard, les hippies (1970) qui s’opposaient également à la société de consommation, prônant la liberté des mœurs et la non-violence, portaient des barbes bien fournies. L’image de la marguerite dans la barbe s’impose à votre cerveau.
Je peux évoquer également la mode hipster qui reprend des codes vestimentaires des années 30/40, anticonformistes (a priori) également, les hipsters ont démocratisé sérieusement le port de la barbe sous toutes ses formes. Là où dans les années 90 la barbe était mal perçue, sournoise, l’adopter devient alors très tendance et c’est encore le cas aujourd’hui. C’est la cool attitude.
Enfin, le port de barbe concerne également les communautés religieuses. Quelque soit les religions, les différents styles de barbes portés donnent des indications sur la tendance adoptée. Si je suis simple sympathisant, ma barbe pourra être moins fournie que si j’étais rigoriste voire ultra conservateur.
Donc si nous raisonnons par rapport à l’impact que nous souhaitons avoir auprès des autres, d’un groupe, le port de barbe est un indicateur important et fiable d’inclusion et d’appartenance.
Maintenant, la barbe (fournie ou non) cache une bonne partie du visage et en particulier la bouche. La bouche est très importante pour communiquer des intentions, même si la personne ne parle pas. Elle s’étire, se crispe, ses lèvres rentrent dans la bouche, se mordillent, s’entrouvrent… Elle nous en dit long.
Porter la barbe sert à cacher au premier abord des intentions. Je dis au premier abord car pour les plus téméraires ou les plus curieux, l’obstacle de la barbe passé, l’échange peut s’avérer très fructueux, plaisant, amusant… la barbe sert à faire un tri a priori des personnes qui ne nous semblent sans intérêts.
Ainsi, la barbe sert à cacher une énergie psychologique que la personne qui la porte n’assume pas réellement mais qui représente une valeur importante ou au contraire qui souhaite l’amplifier.
Par exemple, si je suis une personne très timide mais que physiquement je suis athlétique, pour équilibrer mon état d’esprit et ce que mon corps renvoie comme image, la barbe peut être un bon moyen pour moi, une aide, pour me sentir plus assuré.
A contrario, si je suis doté d’un caractère assertif mais que je suis une personne physiquement frêle ou en surpoids, la barbe peut être un moyen pour me doter d’une image plus représentative de mon caractère.
Ce ne sont que des exemples et tous les cas sont imaginables bien entendu.
En psychologie évolutionniste, la barbe est un caractère sexuel secondaire jouant un rôle majeur dans la compétition sexuelle (intra et inter).
“La sélection sexuelle est reconnue pour opérer principalement de deux façons. D’une part, avec la sélection intersexuelle, les femelles et les mâles cherchent le partenaire aux attributs les plus attirants. Cet attribut peut être physique (la queue du paon) ou comportemental (les danses nuptiales).
Et d’autre part, la sélection intrasexuelle qui favorise une compétition entre les individus de même sexe. Ce sont par exemple les mâles qui vont se battre entre eux pour l’obtention d’une femelle. C’est aussi les hiérarchies de dominance qui s’établissent chez plusieurs espèces et qui donnent un accès prioritaire aux individus du sexe opposé.”
En conclusion, le port de la barbe est un outil d’aide pour améliorer, renforcer, notre posture, notre assurance, notre charisme, notre inclusion mais elle sert également à véhiculer des valeurs et à attirer la gente féminine (Capsule outil: La sélection sexuelle et la théorie de l’investissement parental (mcgill.ca).
Jeffrey Dahmer : la recherche pathologique de contrôle
Le 19/08/2022
Jeffrey Dahmer - "le cannibale de Milwaukee" - est l’un des pires serial killers de l’histoire des États-Unis. Il a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Arrêté en 1991, puis condamné à 957 ans de prison, Dahmer a été assassiné dans sa cellule en 1994.
Issu d’une famille bourgeoise, évoluant dans un environnement aseptisé, Dahmer a déménagé à sept ans pour la ville de Bath Township (Ohio). Sa mère était névrosée et toujours énervée. Son père était pharmacien et passait beaucoup de temps à son travail. Aucun d’entre eux ne s’occupaient réellement de lui, ce qui l’a poussé à avoir des jeux solitaires et des “amis imaginaires”. Ses camarades d’école avaient peur de lui.
C’était un élève intelligent, brillant mais il agissait de façon impulsive. Vers l’âge de huit, la peur des autres et le manque de confiance en lui ont commencé à le perturber suffisamment pour qu’il ne veuille plus aller à l’école. Vers l’âge de 10 ans, son intérêt se porte sur les animaux morts. A 13 ans, il découvre son homosexualité. Sa vie fantasmatique se développe, s’enrichit et prend une tournure pathologique. Dahmer avait un frère plus jeune que lui, David, qui fut l’enjeu du divorce de ses parents, chacun s’en disputant la garde sans se préoccuper de Jeffrey (1978). Sa mère quitta le foyer avec David.
Dahmer a fait face à plusieurs situations potentiellement traumatisantes dans son enfance. L’une d’elles a été son opération d’une double hernie, alors qu’il avait 4 ans. Il était terrifié que son pénis ait été sectionné.
Jeffrey Dahmer : “(...) I wanted to have the person under my complete control.”
Dans cette interview, Dahmer évoque sa volonté de contrôle total sur l’autre. Au moment où il dit cela, il effectue un retrait de sa tête comme pour l’éloigner de ses propres propos. Ce geste traduit une volonté qu’il sait ne pouvoir satisfaire, qui lui échappe, donc qui est hors de contrôle et qui est du ressort psychologique de la pulsion.
Il y a trois principes à la pulsion : un principe de recherche de plaisir (et donc évitement de déplaisir) alors que ce plaisir est toujours satisfait dans le ventre de la mère. Un principe de réalité qui nécessite de s’ajuster au monde extérieur. Il s’agit donc de satisfaire cette pulsion par des voies détournées. Enfin, un principe de constance dans le sens où l’appareil psychique réduit toute excitation au seuil minima (homéostasie), ce qui entraîne par conséquent un passage à l’acte quel qu’il soit. Ce passage à l’acte est ainsi une décharge d’énergie qui va faire baisser la tension psychologique qui vient de l’intérieur de notre organisme (excitation endogène).
L’interviewer : “d’où vient ce besoin de contrôle ?”
Jeffrey Dahmer : “je sentais n’avoir aucun contrôle quand j’étais enfant ou adolescent et ça s’est mélangé à ma sexualité et j’ai fini par faire ce que je faisais, c’était ma façon de me sentir en contrôle total, au moins dans ce cas-là, en créant mon propre monde dans lequel j’avais le dernier mot.”
Cette réponse illustre parfaitement son besoin irrépressible du passage à l’acte, sa motivation. Il aurait pu faire du sport qui, par la technicité nécessaire le mette en confiance et ainsi lui faire apprécier qu’il pouvait avoir un contrôle sur un acte. Cependant, Dahmer n’a pas bénéficié d’une attention sécurisante de la part de ses parents, sa mère en particulier à qui revient en tout premier lieu la mise en sécurité et le réconfort de l’enfant.
Au cours de l’interview, Dahmer évoque à plusieurs reprises ce désir de contrôle et systématiquement, ses propos se terminent par une bouche en huître. C'est-à-dire que ses lèvres sont rentrées dans sa bouche illustrant une volonté de garder ses propos pour lui.
Cette bouche en huître et la façon dont son regard se défocalise consciemment de la relation, c’est-à-dire qu’il y a une rupture volontaire du lien avec l’autre, montrent qu’il se replonge dans ses souvenirs, dans ses actes et qu’il trie/choisit ses mots parce qu’il en a conscience.
0:15 - Bouche en huître lorsqu’il évoque son premier meurtre en 1978 : “j’ai eu l’impression de contrôler ma vie.”
0:33 - Position du buste sur la chaise dans une position de fuite (buste en arrière et penché sur sa gauche). Dahmer fait encore une bouche en huître à l’évocation de son second meurtre en 1984.
2:13 - Dahmer se mord la lèvre inférieure après avoir dit “j’avais l’impression que c’était incontrôlable.”
2:50 - “(...) Leur ethnie n’avait aucune importance, seule leur beauté comptait” dit-il en terminant à nouveau par une bouche en huître.
Lors de l’interview, Dahmer s’exprime essentiellement de sa main gauche, ce qui traduit une certaine spontanéité, une réactivité qui confirme qu’il ne sait pas se contrôler :
0:41 - Dahmer s’exprime avec sa main gauche tandis que sa main droite est simplement posée sur son genou, tenant un gobelet.
1:38 - Micro démangeaison avec son pouce gauche qui vient gratter sa narine droite. Le bras gauche vient donc en travers de son corps, c’est une forme de protection inconsciente. Le fait qu’il ait cette micro démangeaison montre que quelque chose le gêne soit chez son interviewer, soit dans le fait qu’il doive aborder certains évènements et ainsi se dévoiler.
2:23 - Sa main gauche s’active lorsqu’il évoque la place du sexe dans ses passages à l’acte. Ses doigts sont tendus, dressés, bien écartés les uns des autres. Il y a une certaine tension dans ce geste, une tension qui peut aussi s’apparenter à de l’excitation.
Immaturité sexuelle, sexualité perverse, frustration, passivité, la solitude, la peur de ne pas être acceptée par un monde hostile et un mélange de détachement émotionnel sont rencontrés dans la psychopathologie de la personnalité d'un tueur en série.
Souvent, comme dans le cas de Jeffrey Dahmer, son ambivalence quant à sa propre sexualité confuse et ses sentiments de rejet provoquent un comportement sexuel sadique, compulsif et destructeur de l'objet de son attention pseudo-sexuelle, la source détestable de son attirance et de son besoin de pouvoir et de contrôle.
Jeffrey Dahmer était un solitaire dans son enfance, grandissant dans une famille «dysfonctionnelle » en raison de fréquentes disputes entre sa mère et son père conduisant à
sentiments hostiles envers eux. Une mère névrosée et déprimée et un père souvent absent, absorbé par sa carrière, ne lui permettait pas d’identification masculine complète.
Son comportement destructeur et ses souvenirs fétichistes sont l'expression évidente de sa profonde ambivalence vis-à-vis de son propre homosexualité et de sa profonde hostilité/amour mêlés envers les objets de son intérêt. Indépendamment de ses sentiments d'amour exprimés pour elles, ses victimes n'étaient pas traitées comme des personnes mais comme des objets. Il en disposait comme un enfant le fait avec ses jouets, en les démontant pour voir comment ils sont faits mais également pour montrer qui avait le pouvoir, le contrôle de la situation.
Un ultime acte d'affirmation destructrice !
Liens :
(1) Jeffrey Dhamer Interview sous titres FR - YouTube
Jeffrey Dahmer - TUEURS EN SERIE.org
Jeffrey Dahmer: Psychopathy and Neglect (regis.edu)
Destructive Hostility: The Jeffrey Dahmer Case: A Psychiatric and Forensic Study of a Serial Killer (marquette.edu)

Le port du masque et la lecture des émotions
Le 11/08/2022
Le port de masques faciaux a été l'un des moyens essentiels pour prévenir la transmission du COVID. Il est évident que ça a affecté nos interactions sociales que ce soit dans le cercle privé, public et professionnel. Tout comme il a affecté les enfants qui ont eu du mal à lire les émotions sur le visage de leurs parents.
Nos visages fournissent des informations clés de notre identité, des informations socialement importantes comme la fiabilité, l'attractivité, l'âge et le sexe, des informations qui soutiennent la compréhension du discours, ainsi que des informations détaillées qui permettent de lire l'état émotionnel de l'autre via l'analyse de l'expression. La qualification des émotions par la lecture des expressions faciales est prépondérante pour pouvoir ajuster sa communication. C’est particulièrement vrai en entretien de recrutement en face à face, pire en visio, tout comme c’était le cas en réunion d’équipe où chacun doit redoubler d’attention et de concentration afin de ne pas faire de mauvaises interprétations.
Des chercheurs de l’Université de Bamberg (Allemagne) ont mené une expérience pour tester l'impact des masques faciaux sur la lisibilité des émotions. Les participants (N=41, calculé par un test de puissance a priori ; échantillon aléatoire ; personnes en bonne santé d'âges différents, 18-87 ans) ont évalué les expressions émotionnelles affichées par 12 visages différents. Chaque visage a été présenté au hasard avec six expressions différentes (en colère, dégoûté, craintif, heureux, neutre et triste) tout en étant entièrement visible ou partiellement couvert par un masque facial. Les résultats ont fait ressortir une précision moindre et une confiance moindre dans sa propre évaluation des émotions affichées.
La lecture émotionnelle était rendue très compliquée à cause de la présence du masque. Les chercheurs ont en outre identifié des schémas de confusion spécifiques, principalement dans le cas de l’expression du dégoût, de la colère, de la tristesse à l’exception des visages craintifs ou neutres.
Déjà que nous ne sommes pas forcément très bons pour qualifier correctement les émotions…
“En ce qui concerne l'analyse de l'expression, différentes études ont montré que nous sommes loin d'être parfaits dans l'évaluation de l'état émotionnel de notre vis-à-vis. C'est particulièrement le cas lorsque nous nous appuyons uniquement sur des informations faciales pures sans connaître le contexte d'une scène. Un autre facteur qui diminue notre performance à lire correctement les émotions des visages est la vue statique sur les visages sans aucune information sur la progression dynamique de l'expression vue ou une occlusion partielle du visage.”
Mais alors quelles actions compensatoires peuvent maintenir l'interaction sociale efficace (par exemple, le langage corporel, les gestes et la communication verbale), même lorsque les informations visuelles pertinentes sont considérablement réduites ?
C’est oublier un peu vite que nous disposons d’autres options tout à fait efficaces, comme observer le langage corporel… la personne a-t-elle recours inconsciemment à des micro démangeaisons, sur quelle zone ? La posture, les épaules sont-elles voûtées, tombantes, l’une plus haute que l’autre ? Le ton de la voix, l’inclinaison de la tête, vers la droite qui trahirait une certaine rigidité dans l’écoute, vers la gauche qui indiquerait une certaine confiance ? La gestuelle des mains qui accompagne le discours est-elle ample, contenue au niveau du tronc, inexistante, rigide, souple ? Est-ce que les mains tiennent un stylo, sont-elles posées sur la table, se raccrochent-elles à la table ?
Tous ces marqueurs gestuels (mi)-conscients permettent de qualifier l’état émotionnel de la personne. Votre expérience et la connaissance du contexte viendront valider votre analyse.
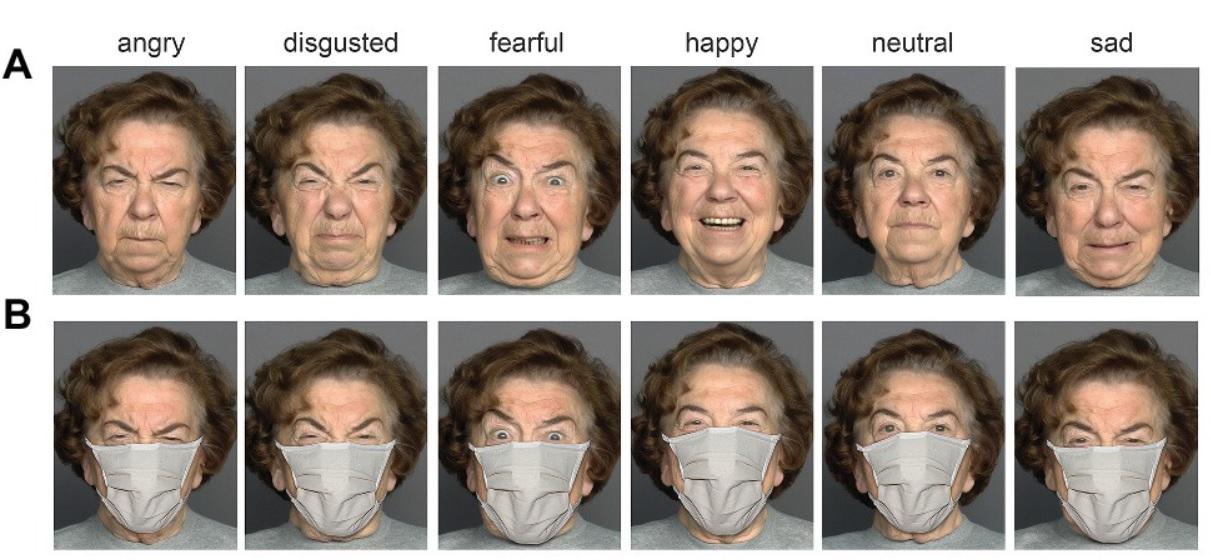
Frontiers | Wearing Face Masks Strongly Confuses Counterparts in Reading Emotions (frontiersin.org)
Bruce, V., and Young, A. (1986). Understanding face recognition. Br. J. Psychol. 77, 305–327. doi: 10.1111/j.2044-8295.1986.tb02199.x
Derntl, B., Seidel, E. M., Kainz, E., and Carbon, C. C. (2009). Recognition of emotional expressions is affected by inversion and presentation time. Perception 38, 1849–1862. doi: 10.1068/P6448
Aviezer, H., Hassin, R. R., Ryan, J., Grady, C., Susskind, J., Anderson, A., et al. (2008). Angry, disgusted, or afraid? Studies on the malleability of emotion perception. Psychol. Sci. 19, 724–732. doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02148.x
Bassili, J. N. (1979). Emotion recognition: the role of facial movement and the relative importance of upper and lower areas of the face. J. Pers. Soc. Psychol. 37, 2049–2058. doi: 10.1037/0022-3514.37.11.2049
Blais, C., Roy, C., Fiset, D., Arguin, M., and Gosselin, F. (2012). The eyes are not the window to basic emotions. Neuropsychologia 50, 2830–2838. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.08.010
Blais, C., Fiset, D., Roy, C., Saumure Régimbald, C., and Gosselin, F. (2017). Eye fixation patterns for categorizing static and dynamic facial expressions. Emotion 17, 1107–1119. doi: 10.1037/emo0000283
Do Masks Impair Children's Social and Emotional Development? | Psychology Today
Pourquoi je mens ?
Le 23/06/2022
Le 24 novembre 2016, dans la nuit, Sherri Papini est retrouvée au bord d’une route de Californie. Cette jeune femme est portée disparue depuis plus de 20 jours. Nez cassé, cheveux coupés, marquée par des brûlures, portant une camisole de force. Sherri Papini dit avoir été enfermée dans un placard durant tout ce temps et battue quotidiennement par deux femmes de type sud américain.
On est à Redding, Californie, USA.
Au cours de l’enquête, des doutes apparaissent dans le récit de la jeune femme. Mère de famille, mariée, deux enfants, elle part faire un jogging le 2 novembre et disparaît. Son mari, parti à sa recherche, ne retrouve que son téléphone avec ses oreillettes, des cheveux posés à côté.
Les enquêteurs ont l’intime conviction qu’il s’agit d’une mise en scène.
Une cagnotte en ligne est ouverte pour aider à trouver une piste qui permettrait de mener jusqu’à la jeune femme. Un site internet est ouvert et 24h après sa fermeture, Sherri Papini réapparaît. Elle ne donnera pas l’ombre d’une explication ce qui augmentera la suspicion.
Internet est un outil puissant et il existe une grande communauté d’internautes qui savent en tirer partie pour creuser, pour enquêter bien plus rapidement que les autorités.
Certains éléments vont desservir la jeune femme comme le fait que statistiquement, les enlèvements réalisés par des femmes sont rarissimes. On apprend que la mère de Sherri a décrit sa fille, lors d’un appel passé aux autorités en 2003, comme une mythomane qui a besoin d’être hospitalisée. A l’époque, elle se mutilait pour faire chanter sa mère.
En 2017, une nouvelle analyse ADN sur ses vêtements portées lors de l’enlèvement révèle un profil masculin, qui s’avèrera être le complice de Sherri Papini.
Le scénario machiavélique est avoué par la jeune femme, ses blessures elle se les ait infligées avec son complice... Son procès se tiendra cet été.
Après investigation auprès d’un expert psychiatrique - Dr Ian Lamoureux - Sherri Papini s’avère souffrir d’un désordre de la personnalité narcissique.
Pourquoi inventer des mensonges aussi énormes ? Le mensonge est un signe de détresse qu’envoie le menteur à celui qu’il veut berner. Mais pour quelles raisons ?
Le mensonge participe à l’organisation psychologique de l’enfant, ça le structure et il contribue (c’est contre intuitif) à faire le lien entre l’enfant et l’autre. Selon Winnicott, les enfants qui s’attendent à être persécutés tentent de résoudre leur problème par un mensonge subtil consistant à se plaindre sans que cette plainte soit l’objectif réel.
Lorsque l’enfant n’a pas pleinement profité du stade transitionnel, c’est-à-dire qu’il n’a pas su construire efficacement un espace psychique entre le dedans et le dehors. Cet espace transitionnel est là pour rappeler à l’enfant que la personne qui prend soin de lui est près de lui, quelque part, et ça le rassure. Ça fonctionne très bien avec le fameux ours en peluche, le doudou…
Sans cet espace transitionnel efficient, l’enfant conçoit le mensonge comme un facteur d’espoir. En mentant, il oblige l’environnement à le prendre en main pour le rassurer, lui montrer tout l’amour qu’il en attend, dont il a besoin impérieusement. Le mensonge a pour objectif de reconstruire l’aire transitionnelle. Le fait que l’autre tombe dans le panneau va créer le lien narcissique réparateur, ça va rassurer l’enfant menteur (ou l’adulte).
En réalité, c’est un jeu très enfantin comme Winnicott le décrit. C’est la nécessité paradoxale de se cacher pour être trouvé.
La question qui reste en suspens pour ma part est : quelle enfance Sherri Papini a-t-elle eue ?
Les clignements de paupières : un élément gestuel important
Le 01/02/2022
En 1965, Jeremiah Denton, officier dans la Navy, est capturé par les nord-vietnamiens. Un an plus tard, il est forcé de participer à une interview de propagande destinée à être diffusée aux Etats-Unis.
Lors de cette interview, il prétexte les lumières aveuglantes pour cligner des paupières de façon anormale. Lors de la diffusion, la Navy comprend rapidement que ses prisonniers détenus au Vietnam sont torturés. Jeremiah Denton, par ses clignements de paupières, avait transmis un message en morse : T.O.R.T.U.R.E.
Le clignement des paupières est un élément essentiel pour confirmer qu'une personne ressent effectivement une émotion, positive ou négative. Son intensité sera plus grande encore si l'émotion est spontanée que celle liée à un souvenir.
Il a plusieurs fonctions :
- Spontané, la fermeture est fugace et ne gène pas la vision. Elle assure la redistribution du film lacrymal et débarasse le film des impuretés.
- Réflexe, il s'agit de protéger l'oeil. On distingue le réflexe sensitif, à la percussion, optico-palpébral, auriculo-palpébral.
- Volontaire, plus long que le clignement réflexe, les causes sont variables selon les personnes et le contexte (A. Faucher - Univ. Sherbrooke).
Ce dernier est intéressant à observer. Dans un environnement relativement neutre, dénué de toute charge émotionnelle, il est admis qu'une personne cligne en moyenne 15 à 20 fois par minute (Univ. College of London - Current Biology, 2005).
Etre attentif à cet élément gestuel permet d'adapter notre communication pour apaiser l'interlocuteur, lui permettre de se recentrer pour retrouver ses moyens. Cela peut également nous permettre de postuler que notre interlocuteur masque ou modifie une partie de la véracité de son discours. Dans ce cas, il clignera moins parce que cela nécessite beaucoup de ressources cognitives. La personne sera donc concentrée à travestir son discours et l'absence, ou une baisse du nombre de clignements, l'isole du monde extérieur lui permettant ainsi de se focaliser sur son discours.
Lien :
Jeremiah Denton — Wikipédia (wikipedia.org)