- Accueil
- Blog
Blog
Le 08/11/2025
Echec épistémologique d'un champ athéorique
Le fantasme classificatoire
La criminologie moderne, particulièrement anglo-saxonne, s'est évertuée depuis quarante ans à catégoriser les tueurs en série avec l'espoir naïf qu'une bonne taxonomie révélerait la nature profonde du phénomène.
Trois approches dominent : Holmes & DeBurger (1988), David Canter (années 1990), et la position évolutive du FBI. Chacune échoue différemment, et cet échec nous renseigne davantage sur les limites de la pensée classificatoire que sur l'objet étudié.
Holmes & DeBurger : la tentation phénoménologique
Ronald Holmes et James DeBurger proposent en 1988 une typologie quadripartite basée sur la « motivation inférée du tueur :
- Le Visionnaire tue sous l'impulsion de voix, d'hallucinations, d'injonctions divines ou démoniaques. Break psychotique patent, structure délirantielle. Désorganisation comportementale majeure.
- Le Missionnaire possède une pseudo-rationalité : éliminer les prostituées, les homosexuels, les "parasites sociaux". Pas de psychose, mais rigidité idéologique extrême. L'acte est "nécessaire", pas jouissif.
- L'Hédoniste tue pour le plaisir, subdivisé en trois sous-types :
- Lust : gratification sexuelle directe
- Thrill : excitation, frisson, chasse
- Comfort : gain matériel (assurances, héritages)
- Le Dominateur cherche le contrôle absolu sur sa victime. Torture prolongée, humiliation, réduction à l'objet. La mort n'est que l'aboutissement regrettable de la domination totale.
Critique structurale
Ce modèle souffre d'un vice circulaire fondamental : on infère la motivation du comportement observé, puis on classe selon cette motivation inférée. Le raisonnement se mord la queue. Comment distinguer empiriquement un hédoniste-thrill d'un dominateur ? Les deux torturent, les deux prolongent, les deux jouissent du contrôle.
L'échantillon (110 cas environ) ne permet aucune validation statistique robuste. Plus grave : les catégories se chevauchent constamment. Un dominateur EST nécessairement hédoniste. Un missionnaire peut éprouver du thrill. La typologie ne découpe pas le réel, elle le quadrille arbitrairement.
Biais rétrospectif massif
Connaissant l'issue et les déclarations post-capture, on "trouve" facilement la motivation. Mais ce modèle n'a aucun pouvoir prédictif prospectif. C'est de l'herméneutique criminologique déguisée en science.
Plasticité ignorée
Un même individu peut passer d'un registre à l'autre selon les opportunités, l'évolution de sa pathologie, les contingences situationnelles. BTK était missionnaire au début (éliminer des familles "idéales" par jalousie), hédoniste-lust ensuite, dominateur toujours. Quelle est sa "vraie" catégorie ?
Intérêt résiduel
Utile comme heuristique grossière pour initier une réflexion, rien de plus. En pédagogie, peut-être. En investigation, dangereux : risque de biais de confirmation ("il doit être visionnaire, cherchons des signes de psychose").
David Canter : le behaviorisme statistique
David Canter, psychologue environnemental britannique, adopte une approche radicalement différente dans les années 1990. Pas de spéculation motivationnelle. Uniquement des variables comportementales observables, analysées statistiquement sur 100 tueurs britanniques via Smallest Space Analysis (analyse multidimensionnelle).
Les dimensions canteriennes
Canter refuse les types discrets. Il propose des continuums :
- Dimension 1 : Expressif vs Instrumental
- Expressif : violence excessive, mutilations, rage manifeste, désorganisation émotionnelle, overkill, acharnement post-mortem. Le crime exprime un affect débordant.
- Instrumental : violence minimale nécessaire, planification, froideur, dissimulation du corps, nettoyage de la scène. Le crime est un moyen, pas une fin émotionnelle.
- Dimension 2 : Conservateur vs Explorateur (cognitive)
- Conservateur : zone géographique restreinte, routines rigides, victimes du voisinage, territorialité, faible mobilité.
- Explorateur : mobilité élevée, adaptation, nouveaux territoires, victimes éloignées du domicile, flexibilité opportuniste.
Ces dimensions sont « orthogonales » : on peut être expressif-conservateur (rage locale) ou instrumental-explorateur (tueur itinérant froid).
Forces méthodologiques
Empirisme rigoureux. Données observables, reproductibles, mesurables. Pas d'inférence psychologique hasardeuse. Le modèle est prédictif pour le Geographic Profiling : un conservateur-expressif opérera probablement près de chez lui dans un rayon de 2-3 km.
Compatible avec une épistémologie behavioriste stricte : si on ne peut pas l'observer sur la scène de crime, on ne le modélise pas.
Limites épistémologiques
- Réductionnisme statistique : la singularité du cas disparaît dans les moyennes. Un tueur n'est jamais réductible à ses coordonnées sur deux axes.
- Athéorique : Canter décrit des patterns sans les expliquer. POURQUOI existe-t-il des expressifs et des instrumentaux ? Quelle étiologie développementale ? Quelle économie pulsionnelle ? Silence total.
- Culturellement situé : échantillon britannique, contexte légal et social spécifique. La généralisation aux USA ou ailleurs reste douteuse.
En termes Le-Senniens, Canter cherche les "caractères" (au sens caractérologie) mais sans théorie de la personnalité. C'est de la cartographie sans géologie. On sait où sont les montagnes, pas pourquoi elles sont là.
Le FBI : de l'enthousiasme typologique au pragmatisme radical
Phase 1 (1970s-80s) : l'âge d'or des profilers
Robert Ressler, John Douglas, Roy Hazelwood du Behavioral Science Unit lancent le Criminal Personality Research Project. Ils interviewent 36 tueurs en série (Bundy, Kemper, Gacy...) et forgent la dichotomie célèbre :
- Organisé : QI élevé, planification, contrôle de la scène, dissimulation du corps, socialement compétent, suit l'affaire dans les médias.
- Désorganisé : QI faible, impulsif, scène chaotique, corps abandonné, isolement social, pas de suivi médiatique.
Opérationnel, médiatique, séduisant. Adopté massivement par les départements de police. Un succès de communication criminologique.
Phase 2 (1990s) : la critique empirique
David Canter démontre que 75% des scènes de crime présentent des éléments des DEUX catégories. La dichotomie ne reflète pas un "type" de tueur mais plutôt :
- L'évolution dans la série (début désorganisé, apprentissage, devenir organisé)
- Les variations situationnelles (victime résiste = désorganisation)
- La séquence temporelle (planification organisée, exécution émotionnelle désorganisée)
Exemple paradigmatique : BTK (Dennis Rader). Planification obsessionnelle (organisé), mais lors du passage à l'acte, perte de contrôle émotionnelle, jouissance prolongée, désordre (désorganisé). Quelle est sa "vraie" nature ?
La dichotomie est un artefact classificatoire qui simplifie abusivement une réalité continue et contextuelle.
Phase 3 (2005-aujourd'hui) : l'abandon des typologies
En 2005, Robert Morton et Mark Hilts publient pour le FBI un rapport sévère : les typologies sont "artificielles et contre-productives". Position officielle actuelle du BAU (Behavioral Analysis Unit) :
- Principes directeurs
- Refus des catégories a priori. Chaque cas est analysé inductivement, sans grille préétablie.
- Focus sur les comportements observables uniquement :
- Modus operandi (MO) : techniques utilisées, évoluent avec l'expérience
- Signature : éléments psychologiquement nécessaires, stables, liés à la gratification
- Contrôle de la victime (verbal, physique, chimique)
- Niveau de risque pris
- Temps passé sur la scène
- Comportement post-offense
- Pas de profil psychologique spéculatif. Trop aléatoire, juridiquement fragile, scientifiquement invérifiable.
- Pragmatisme investigatif : ce qui n'aide pas à identifier ou capturer le suspect est écarté.
Lecture Watzlawickienne : les typologies créent ce qu'elles décrivent
Le FBI a compris, probablement sans le conceptualiser ainsi, un principe constructiviste fondamental : les classifications ne décrivent pas une réalité préexistante, elles la construisent.
- Effets circulaires observés
- Les interrogatoires biaisés ("Vous êtes organisé, n'est-ce pas ?") obtiennent des réponses conformes.
- Les médias reproduisent les catégories, créant des scripts culturels.
- Les criminels eux-mêmes se catégorisent, adoptent l'identité proposée, agissent en conséquence (effet copycat raffiné).
- Les enquêteurs cherchent des indices confirmant leur hypothèse typologique initiale (biais de confirmation).
- La prophétie autoréalisatrice en action. Les tueurs "organisés" existent parce qu'on a inventé cette catégorie et qu'elle circule dans l'imaginaire collectif.
- Le FBI a fait son épistémologie pragmatique à la Peirce : si ça n'a pas d'effet pratique différentiel, c'est une distinction vide. Et les typologies n'en avaient plus.
Constat d'échec : l'absence criante de théorie
Ces trois approches partagent un vide théorique abyssal concernant :
- L'étiologie développementale : Que s'est-il passé dans l'enfance, l'adolescence ? Quelle trajectoire d'attachement ? Quels traumas séquentiels ? Quelle construction de la mentalisation ? Bergeret aurait des choses à dire sur les états-limites et les structures psychotiques, mais personne ne l'invite dans ce champ.
- La neurobiologie : Anomalies préfrontales, dysrégulation sérotoninergique, hypersensibilité amygdalienne, déficit d'empathie cognitive vs affective. Données massives ignorées.
- L'économie pulsionnelle : Quel rapport à la pulsion de mort ? Quelle défaillance du Surmoi ? Quelle jouissance spécifique ? Le meurtre en série n'est pas un comportement, c'est une solution psychique à une problématique interne. Personne ne le traite comme tel.
- La fonction adaptative darwinienne : pourquoi ce répertoire comportemental existe-t-il dans l'espèce humaine ? Quelle pression de sélection, quelle niche écologique, quelle stratégie reproductive aberrante ?
On cartographie des surfaces sans explorer les profondeurs. C'est de la criminologie plate.
Vers une approche intégrative
Les taxonomies ont échoué parce qu'elles confondent « description » et « explication ». Holmes & DeBurger spéculent sans rigueur. Canter mesure sans théoriser. Le FBI observe sans interpréter.
Une approche authentiquement scientifique devrait :
1. Ancrer l'analyse dans une théorie développementale robuste (attachement, trauma, construction de la personnalité).
2. Intégrer les données neurobiologiques disponibles, sans réductionnisme.
3. Penser la fonction adaptative du comportement, même aberrant, dans une perspective évolutionniste.
4. Reconnaître la construction sociale du phénomène (Watzlawick) sans tomber dans le relativisme.
5. Accepter la singularité irréductible de chaque cas, tout en cherchant des patterns généralisables.
Ce champ reste un désert théorique. Les tueurs en série continuent d'être traités comme des curiosités à classer plutôt que comme des révélateurs de processus psychopathologiques fondamentaux.
Le prochain article abordera précisément ce qui manque : l'angle darwinien. Pourquoi l'évolution a-t-elle permis qu'existe dans le répertoire comportemental humain cette capacité au meurtre en série ? Quelle est sa fonction, son coût, sa niche écologique ? Qu'est-ce que cela révèle de notre espèce ?
Sources :
Holmes, R. M., & DeBurger, J. (1988). Serial Murder. Sage Publications.
Ressler, R. K., Burgess, A. W., & Douglas, J. E. (1988). Sexual Homicide: Patterns and Motives. Lexington Books.
Canter, D., & Wentink, N. (2004). "An empirical test of Holmes and Holmes's serial murder typology". Criminal Justice and Behavior, 31(4), 489-515.
Canter, D. (1994). Criminal Shadows. HarperCollins. (Vulgarisation de ses travaux)
Canter, D., & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology : Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Wiley.
Morton, R. J., & Hilts, M. A. (Eds.). (2005). Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators. Behavioral Analysis Unit, FBI.
Raine, A., Buchsbaum, M., & LaCasse, L. (1997). "Brain abnormalities in murderers indicated by positron emission tomography". Biological Psychiatry, 42(6), 495-508.
Raine, A. (2013). The Anatomy of Violence : The Biological Roots of Crime. Pantheon. (Synthèse accessible)
Cleckley, H. (1941). The Mask of Sanity. Mosby.
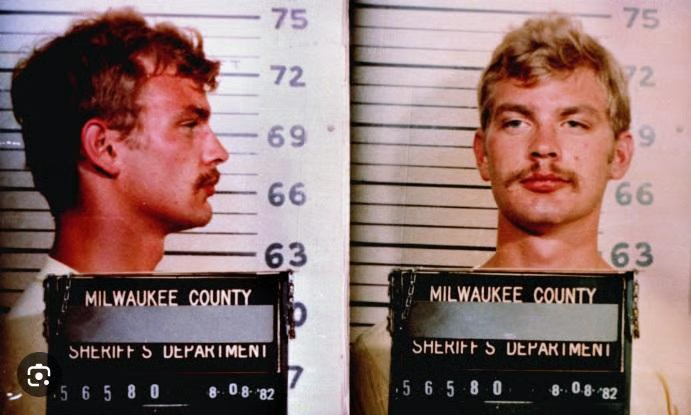
Le 01/11/2025
Anatomie de l'idéalisation narcissique pathologique
Quand l'amour devient tyrannie
« Je ne peux pas vivre sans toi. » Cette phrase, qui semble exprimer l'intensité d'un sentiment amoureux, révèle parfois une tout autre réalité : celle d'une dépendance narcissique où l'autre n'existe que comme prothèse psychique. L'idéalisation pathologique de l'objet n'est pas l'amour — c'est son ersatz, sa contrefaçon économique. Elle procède d'une confusion fondamentale : ce que le sujet prend pour de l'amour n'est qu'un investissement massif visant à combler une béance narcissique primitive.
Cette dynamique, que Freud identifiait dès 1914 dans « Pour introduire le narcissisme », pose une question centrale : comment distinguer l'investissement libidinal d'objet authentique de sa version pathologique, où l'autre devient le réceptacle projeté de ce que le sujet ne peut tolérer en lui-même ? L'idéalisation narcissique pathologique n'est pas un excès d'amour — c'est son impossibilité.
Genèse structurale : Les racines du mirage
Le narcissisme primaire et ses avatars
Pour comprendre l'idéalisation pathologique, il faut remonter à l'économie narcissique primitive. Le narcissisme primaire, état mythique de complétude originaire, reste un fantasme organisateur pour tout sujet. Mais chez certains, la blessure narcissique précoce — liée à une carence d'investissement maternel suffisamment bon, pour parler comme Winnicott, ou à une défaillance des fonctions pare-excitantes — laisse une cicatrice béante.
Le processus normal dans des circonstances optimales de l’enfance se déroule de la façon suivante : l’enfant éprouve peu à peu une déception devant l’objet idéalisé (qui est le parent idéalisé) à mesure que l’évaluation qu’il en fait devient plus réaliste. L’enfant se rend compte des failles du parent. Il se produit alors un retrait des investissements narcissiques envers ce parent idéalisé et leur intériorisation se fait progressivement pour mener à l’acquisition de structures psychologiques permanentes qui continuent, à l’intérieur de soi, les fonctions auparavant exercées par le fameux parent idéalisé.
Mais cette intériorisation n’aura pas lieu si la perte de l’objet (le parent idéalisé) a été traumatique. L’enfant n’acquiert pas la structure interne nécessaire et son psychisme reste fixé à cette étape traumatique et tout au long de sa vie, son psychisme sera dépendant d’autres personnes (idéalisées a priori) en tant que substituts des fragments absents du parent idéalisé disparu.
Bergeret décrit avec précision comment cette faille précoce empêche la constitution d'un Moi suffisamment solide. Le sujet reste alors fixé à une économie narcissique archaïque, où la différenciation Moi/non-Moi demeure fragile. L'autre n'est pas reconnu dans son altérité : il n'existe que comme prolongement fantasmé du Moi, support d'une projection massive.
L'échec de la triangulation œdipienne
L'Œdipe, lorsqu'il est traversé pathologiquement, laisse le sujet captif d'une relation duelle fusionnelle. La fonction paternelle — qui devrait opérer la séparation d'avec l'objet primaire et introduire la castration symbolique — échoue à s'installer. Le tiers manque, l’altérité manque. L’enfant cherche désespérément dans chaque relation à reconstituer cette unité perdue.
Cette fixation explique pourquoi il y a « idéalisation pathologique ». La jalousie y est délirante, car tout tiers est vécu comme menace vitale : il vient rappeler la séparation insupportable.
La défaillance des identifications structurantes
Le Senne nous rappelle que le caractère se forge dans la durée, par sédimentation d'expériences relationnelles. Or, chez le sujet à idéalisation pathologique, les identifications primaires sont défaillantes ou conflictuelles. Soit le modèle parental était lui-même trop fragile narcissiquement pour offrir un support identificatoire solide, soit les images parentales étaient clivées (toute-bonne/toute-mauvaise), empêchant l'intégration d'une représentation nuancée de l'autre.
Cette carence identificatoire laisse le Moi appauvri, contraint de chercher à l'extérieur ce qu'il ne peut générer en lui-même : une cohérence, une valeur, une consistance. D'où la nécessité vitale de l'autre idéalisé, qui vient compenser ce déficit structural.
« Comme toute la perfection et la puissance résident maintenant dans l’objet idéalisé, l’enfant se sent vide et impuissant quand il en est séparé, aussi tente-t-il de maintenir avec cet objet une union continue. » (« Le Soi », Heinz Kohut, puf 1971).
Mécanismes de fonctionnement : L'économie du mirage
Le choix d'objet narcissique
Freud distingue deux types de choix d'objet (une personne) : le choix par étayage (la personne choisie ressemble aux figures protectrices de l'enfance) et le choix narcissique (la personne représente ce que le sujet est, a été, voudrait être ou une partie de lui-même). Dans l'idéalisation pathologique, le choix est exclusivement narcissique : l'autre n'est choisi que pour ce qu'il représente fantasmatiquement.
La personne idéalisée incarne le Moi idéal archaïque — cette image grandiose de complétude que le sujet ne peut maintenir seul. Il porte la projection massive de toutes les qualités que le sujet s'est vu contraint de renoncer sous la pression de la réalité et du Surmoi. L'autre devient littéralement le dépositaire du narcissisme perdu.
La projection et l'identification projective
Le mécanisme central de l'idéalisation pathologique est la projection massive. Le sujet projette sur l'objet ses propres qualités fantasmées, ses aspirations inaccessibles, sa puissance imaginaire. Mais cette projection n'est pas une simple attribution externe : elle s'accompagne d'une identification projective, où le sujet tente de contrôler l'autre de l'intérieur, de le forcer à incarner réellement ce qui est projeté sur lui.
Watzlawick et l'école de Palo Alto nous aideraient ici à comprendre la dimension interactionnelle : le sujet envoie des messages paradoxaux (« sois ce que je projette sur toi, mais ne change pas »), créant un double bind qui rend l'autre captif d'une assignation impossible. La communication devient pathologique, circulaire, autoconfirmatrice.
Le déni de la réalité et le clivage
Pour maintenir l'idéalisation, le sujet doit dénier toute information contradictoire. Le clivage opère massivement : la personne est soit totalement bonne (idéalisée), soit totalement mauvaise (persécutrice). Pas de nuances. Cette économie psychotique du clivage révèle la fragilité de l'organisation défensive.
Le réel est constamment dénié au profit de la construction fantasmatique. Chaque indice qui viendrait contredire l'image idéale est soit scotomisé (nié parce qu’intolérable), soit rationalisé, soit projeté ailleurs (« c'est moi qui ne le comprends pas assez bien »). Cette distorsion systématique de la perception maintient le mirage au prix d'une dépense énergétique considérable.
L'économie libidinale : tout ou rien
L'investissement libidinal dans l'idéalisation pathologique est massif, exclusif, totalitaire. Le sujet désinvestit toute autre personne, tout autre intérêt, toute autre source de satisfaction narcissique. C'est une économie du « tout ou rien », sans régulation possible. La libido est captive, figée sur cet objet unique.
Cette économie est intrinsèquement instable. Elle ne peut se maintenir qu'au prix d'un effort constant de déni, de contrôle, de surinvestissement. Elle épuise les ressources psychiques du sujet, qui vit dans l'angoisse permanente de perdre cet objet dont il dépend vitalement.
Le cycle addiction/désillusion
Comme Darwin nous le rappellerait, les comportements se répètent s'ils ont une fonction adaptative — même pathologique. L'idéalisation fonctionne sur un mode addictif : elle procure une jouissance immédiate (comblement fantasmatique de la béance narcissique), suivie inévitablement d'une chute (confrontation au réel de l'objet, qui ne peut incarner indéfiniment la projection).
Cette alternance génère un cycle infernal : idéalisation → surinvestissement → désillusion → dévalorisation (parfois haine) → nouvelle quête d'un objet idéal. Le sujet passe d'une relation à l'autre, reproduisant le même scénario, sans jamais interroger la structure qui le sous-tend. La répétition est ici au service du déni : chaque nouvel objet est censé être « le bon », celui qui enfin comblera la faille.
Manifestations cliniques : Les visages du mirage
Le tableau de la dépendance affective
Cliniquement, l'idéalisation pathologique se présente souvent sous le masque de la « dépendance affective ». Le sujet rapporte une impossibilité de vivre sans l'autre, des angoisses d'abandon massives, une jalousie envahissante, des comportements de contrôle et de surveillance. Il décrit son partenaire en termes hyperboliques, niant systématiquement ses défauts ou les minimisant.
Le discours révèle une confusion identitaire : « sans lui, je ne suis rien », « il est toute ma vie », « je ne sais plus qui je suis quand il n'est pas là ». Le sujet ne se perçoit pas comme entité autonome mais comme fragment d'un tout fantasmatique dont l'autre serait l'autre moitié (mythe de l'androgyne, utilisé défensivement).
Les avatars du masochisme relationnel
L'idéalisation pathologique conduit fréquemment à des configurations masochistes. Le sujet tolère l'intolérable — maltraitance, infidélités répétées, mépris — au nom de l'amour. Mais cette tolérance n'est pas altruiste : elle sert à préserver l'objet idéalisé coûte que coûte, quitte à se détruire soi-même.
Le masochisme ici n'est pas recherche de la souffrance pour elle-même mais conséquence logique d'une économie où la survie psychique est vécue comme dépendante du maintien de l'objet, quel qu'en soit le prix. Le sujet préfère souffrir que renoncer à l'illusion.
La violence du retournement
Lorsque l'idéalisation s'effondre — et elle s'effondre toujours, car aucun être réel ne peut soutenir indéfiniment une projection aussi massive — le renversement est brutal. L'amour se transforme en haine, l'objet idéalisé devient persécuteur, le même qui était « parfait » devient « le pire ».
Cette violence du retournement révèle que l'ambivalence n'avait jamais été intégrée. Le clivage se maintient, seul change le pôle investi. Le sujet oscille entre positions paranoïde (« il me veut du mal, il m'a trompé depuis le début ») et dépressive (« je suis nul, je n'ai rien compris, je mérite cette souffrance »), sans parvenir à une position intermédiaire de reconnaissance de la complexité de l'objet et de soi.
Conséquences : Le coût psychique et relationnel
L'appauvrissement du Moi
L'idéalisation pathologique appauvrit considérablement le Moi. Toute l'énergie psychique étant investie dans le maintien de l'illusion, les autres fonctions du Moi sont négligées : capacité de jugement, pensée autonome, créativité, investissements sociaux et professionnels. Le sujet se vide de sa substance propre au profit d'une existence par procuration.
Cet appauvrissement crée un cercle vicieux : plus le Moi s'appauvrit, plus il dépend de l'objet externe pour se sentir exister, plus l'idéalisation devient nécessaire. La dépendance se renforce au fil du temps, jusqu'à des états de décompensation grave lorsque l'objet fait défection.
L'impossibilité de la rencontre authentique
En figeant l'autre dans un rôle fantasmatique, l'idéalisation empêche toute rencontre véritable. L'autre réel — avec ses désirs propres, ses contradictions, sa finitude — ne peut exister. Il est réduit au statut d'objet partiel, support d'une projection. Cette négation de l'altérité empêche toute relation dialogique, au sens où Watzlawick pourrait l'entendre : il n'y a pas d'ajustement réciproque, pas de négociation, pas de reconnaissance mutuelle.
Le partenaire idéalisé se trouve assigné à une place impossible. Il doit incarner le fantasme du sujet tout en restant « naturel ». Toute tentative d'affirmer sa propre subjectivité est vécue comme trahison, abandon, preuve qu'il n'est « pas le bon ». Cette situation génère chez lui culpabilité, confusion, parfois même effondrement identitaire.
La répétition compulsive et l'échec thérapeutique
L'idéalisation pathologique s'inscrit dans une compulsion de répétition particulièrement résistante. Le sujet répète inlassablement le même scénario relationnel, cherchant dans chaque nouvelle relation à effacer l'échec de la précédente. Mais la structure demeurant inchangée, l'issue est prévisible.
Les risques de décompensation
Lorsque l'objet idéalisé se dérobe définitivement — rupture, décès, révélation de sa « vraie nature » — le risque de décompensation est majeur. Le sujet peut basculer dans des états mélancoliques graves (avec risque suicidaire élevé), des décompensations persécutives (l'objet perdu devient persécuteur), ou des agirs violents (passage à l'acte contre l'objet ou contre soi).
La mélancolie post-idéalisation est particulièrement grave car l'objet perdu emporte avec lui tout ce que le sujet avait projeté de valorisant. Le Moi, déjà appauvri, se retrouve confronté à sa vacuité. Les auto-reproches mélancoliques (« je suis nul, je ne vaux rien ») sont en réalité des reproches adressés à l'objet intériorisé.
Comment sortir du mirage
La confrontation progressive au fantasme
Il est nécessaire de ne pas conforter l'idéalisation. Face à une personne qui décrit son partenaire en termes dithyrambiques, on doit introduire le doute, questionner, pointer les contradictions. Non pour détruire brutalement l'illusion — ce serait traumatique — mais pour ouvrir un espace de questionnement.
Le travail sur les assises narcissiques
Il faut aider la personne à développer des sources de valorisation internes, indépendantes du regard de l'autre. Bergeret insisterait sur la nécessité de consolider le Moi par un étayage analytique patient, permettant au sujet d'intérioriser progressivement des fonctions auparavant externalisées.
Cela passe par la reconnaissance de ses affects, de ses désirs, de ses pensées propres, souvent niés ou confondus avec ceux de l'autre idéalisé.
La tolérance de l'ambivalence
Il est nécessaire que la personne puisse intégrer l'ambivalence. Tout objet est à la fois bon et mauvais, aimable et détestable, satisfaisant et frustrant. Cette réalité, évidente pour un sujet sain, est insupportable pour celui qui fonctionne sur le mode du clivage.
Progressivement, la personne peut apprendre que l'ambivalence n'est pas destruction, que l'on peut aimer quelqu'un tout en voyant ses défauts.
De l'illusion à la rencontre
L'idéalisation narcissique pathologique n'est pas une forme extrême de l'amour — c'est son antithèse. Là où l'amour reconnaît l'altérité et accepte la vulnérabilité, l'idéalisation nie et contrôle. Là où l'amour tolère l'ambivalence, l'idéalisation clive. Là où l'amour accepte le manque, l'idéalisation exige la complétude.
Comprendre cette pathologie exige d'en saisir les racines structurales : faille narcissique primitive, défaut de triangulation œdipienne, identifications défaillantes. Elle impose aussi d'analyser ses mécanismes économiques : choix d'objet narcissique, projection massive, déni du réel, surinvestissement exclusif. Les conséquences sont graves : appauvrissement du Moi, impossibilité de la rencontre, répétition compulsive, risques dépressifs majeurs.
Peut-être faut-il, pour conclure, rappeler cette évidence : on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est lui, avec ses failles et ses contradictions. L'amour véritable commence là où l'idéalisation s'achève — dans la reconnaissance lucide et néanmoins bienveillante de l'altérité irréductible de l'autre.
Ce qui se paie « à tout prix » n'est jamais l'amour — c'est toujours la défense contre son impossibilité.
Pourquoi rester immobile vous rend fou ?
Le 26/10/2025
Vous avez sans doute remarqué ce paradoxe : les gens qui passent des mois à "réfléchir" avant d'agir finissent souvent paralysés, enlisés dans leurs questionnements.
Pendant ce temps, ceux qui foncent "sans trop réfléchir" semblent bizarrement s'en sortir mieux. Ils pleurent un coup, se relèvent, et avancent.
Pourquoi cette injustice apparente ? Parce que votre psychisme n'est pas fait pour la contemplation pure. Il est fait pour l'action. Et quand vous le privez de mouvement, il se venge.
Le mythe de la pensée pure
On nous a vendu une belle histoire : d'abord on pense, ensuite on agit. Le bon vieux "je pense donc je suis" cartésien. Réfléchir avant d'agir serait la marque de l'intelligence, de la maturité. Sauf que c'est une inversion complète de la réalité biologique.
Vous n'êtes pas un cerveau sur pattes qui a accessoirement un corps. Vous êtes un organisme d'action qui a développé la capacité de penser pour mieux agir. Darwin l'avait compris : votre cerveau n'est pas un salon philosophique, c'est un organe de survie. Il est là pour vous permettre de fuir le prédateur, trouver de la nourriture, vous reproduire, vous adapter. La pensée n'est qu'un outil au service de l'action, pas une fin en soi.
Regardez ce qui se passe quand vous passez trois heures à débattre intérieurement pour savoir si vous allez à cette soirée qui ne vous emballe pas. Vous pesez le pour, le contre, vous imaginez des scénarios, vous anticipez des conversations.
Résultat : migraine, épuisement, et vous n'y allez pas. Mais vous n'êtes pas soulagé pour autant. Vous êtes encore plus mal que si vous y étiez allé franchement ou si vous aviez décliné en cinq minutes.
Pourquoi ? Parce que votre corps était en mode alerte pendant trois heures. Votre système nerveux sympathique s'est activé (préparation à l'action), mais aucune action n'est venue. L'énergie mobilisée n'a pas trouvé d'issue. Elle stagne, elle pourrit sur place.
C'est exactement ce qui se passe avec l'anxiété moderne. Vous êtes allongé dans votre lit dimanche soir, vous "réfléchissez" à votre semaine de boulot qui vous angoisse. Votre corps entre en mode fight or flight : accélération cardiaque, tension musculaire, vigilance accrue. Sauf qu'il n'y a rien à fuir, rien à combattre. Juste votre tête qui tourne dans le vide. Votre organisme prépare une action qui ne viendra jamais. Bienvenue dans l'insomnie.
Prenez l'exemple de la rupture amoureuse. Celui qui passe six mois à "analyser" s'il doit rompre, à peser les avantages et les inconvénients, à consulter ses amis, à relire ses journaux intimes, finit généralement dans un état psychique déplorable.
Pendant ce temps, celui qui rompt sur un coup de gueule, pleure pendant deux semaines, et commence à reconstruire sa vie, s'en sort objectivement mieux. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a agi. Il a fermé la boucle.
Ce que le corps sait et que la tête ignore
Freud, dans ses travaux sur les névroses actuelles, avait repéré quelque chose de fondamental : quand la pulsion ne trouve pas d'issue motrice, elle s'enkyste. Elle ne disparaît pas. Elle se transforme en symptôme.
Votre collègue vous pourrit la vie depuis des mois. Vous "gérez". Vous vous dites que "c'est pas grave", que "ça va passer", que vous êtes "au-dessus de ça". Pendant ce temps : troubles du sommeil, tension permanente dans la nuque, colopathie fonctionnelle, irritabilité avec vos proches. Votre tête fait semblant que tout va bien. Votre corps, lui, sait qu'il y a un problème à régler. Et il le crie par tous les moyens dont il dispose.
L'inhibition de l'action est pathogène. Pas tout de suite, pas spectaculairement, mais sûrement. Parce qu'un organisme vivant fonctionne sur un principe simple : tension → décharge → retour à l'équilibre.
Quand vous bloquez la décharge, la tension s'accumule. Elle trouve d'autres chemins : somatisation, rumination, syndrome anxio-dépressif.
Regardez la différence entre deux personnes qui ont des angoisses existentielles. L'une écrit un roman. L'autre fait des insomnies en se demandant "quel est le sens de ma vie". Les deux ont le même matériau de base : angoisse, questionnement, tension psychique. Mais l'écrivain transforme cette tension en action (écriture). C'est ce que Freud appelait la sublimation : transformer une pulsion en œuvre socialisée. L'autre personne laisse la tension tourner en boucle dans sa tête. Même angoisse, issue radicalement différente.
Même chose pour le deuil. Quelqu'un meurt. Ceux qui participent aux rituels — enterrement, tri des affaires, repas de famille, visite au cimetière — traversent leur peine. Ça fait mal, mais ça circule. Ceux qui "ne veulent pas y penser", qui s'isolent, qui évitent tout ce qui rappelle le mort, restent bloqués pendant des années. Le chagrin ne s'évapore pas par magie. Il a besoin d'être agi.
Attention : je ne dis pas qu'il faut tout transformer en action immédiate et impulsive. Il y a une différence fondamentale entre l'action adaptée et l'acting out. Si vous êtes en colère contre votre patron et que vous en venez aux mains avec lui, c'est un passage à l'acte destructeur. Si vous écrivez une lettre de démission bien sentie ou si vous allez courir dix kilomètres pour décharger la tension, c'est une action adaptée. La première détruit, la seconde régule.
Le piège de l'inaction : quand la solution devient le problème
Paul Watzlawick avait cette formule : "On ne peut pas ne pas communiquer." Même votre silence est un message. Même votre absence parle. J'ajouterais : on ne peut pas ne pas agir. L'immobilisme n'est pas neutre. C'est déjà une action, mais une action qui, la plupart du temps, aggrave le problème.
Vous avez peur des soirées, donc vous déclinez toutes les invitations. Votre raisonnement est imparable : "Si j'y vais, je vais être mal, donc je n'y vais pas." Sauf que trois mois plus tard, vous avez perdu l'habitude de socialiser, votre anxiété a triplé, et les prochaines invitations sont encore plus terrifiantes. Votre "solution" (éviter) est devenue votre prison. C'est l'exemple classique de l'évitement phobique : vous pensiez vous protéger, en fait vous avez renforcé la phobie.
Ou cette thèse que vous repoussez depuis six mois parce que "ce n'est pas le bon moment", "il faut que je lise encore trois bouquins avant", "je ne suis pas prêt". Pendant ce temps, l'angoisse monte, vous procrastinez davantage, vous culpabilisez. La culpabilité nourrit la procrastination qui nourrit la culpabilité.
Le non-agir n'était pas une pause, c'était un agir toxique.
Même chose dans les couples. Les disputes s'accumulent, mais "on va laisser passer, c'est pas le moment d'en parler". Sauf que le silence EST une communication. Il dit : "Je ne veux pas te parler", "Ce que tu as fait ne mérite pas qu'on en discute", "Je te fais la gueule passivement". Six mois plus tard, vous ne vous parlez plus du tout. Vous pensiez que ne rien faire était neutre ? Mauvaise nouvelle : c'était une stratégie, et elle était nulle.
Le cercle vicieux est simple : l'évitement produit un soulagement immédiat (vous n'affrontez pas ce qui vous fait peur), donc il est renforcé. Mais à moyen terme, il augmente le problème. Vous vous retrouvez coincé dans une boucle où votre "solution" est devenue votre problème principal.
L'écologie de l'action : ni hyperactivité ni léthargie
Maintenant, attention au malentendu. Je ne suis pas en train de vous vendre le "hustle culture" ou l'injonction à la productivité permanente. Action ne veut pas dire agitation compulsive.
Regardez ce manager en burn-out qui enchaîne quatorze réunions par jour, répond aux mails à 23h, fait du sport à 6h du matin. Il "agit" sans arrêt. Sauf que c'est une fuite. Il s'agite pour ne pas penser. Ne pas sentir que son couple se casse la gueule, que son boulot n'a plus de sens, qu'il ne sait plus qui il est.
L'hyperactivité comme anesthésie.
C'est ce qu'on appelle en psychanalyse la défense maniaque : se maintenir dans un état d'excitation permanente pour éviter l'effondrement dépressif.
Différence fondamentale : l'action saine répond à un besoin réel et boucle une tension. L'agitation tourne dans le vide.
Exemple concret : dimanche après-midi, vous avez les "sunday scaries", cette angoisse diffuse avant le lundi. Vous consultez compulsivement vos réseaux sociaux, vous lancez une série, vous grignotez. C'est de l'agitation stérile. Vous ne réduisez pas la tension, vous la fuyez.
Résultat : à 22h, vous êtes aussi angoissé qu'à 15h, avec en bonus la culpabilité d'avoir "perdu votre journée".
Alternative : vous préparez votre sac pour le lendemain, vous préparez votre lunch, vous appelez un ami pour parler de ce qui vous tracasse. Ce sont des actions qui réduisent réellement la source d'anxiété. Elles ferment des boucles ouvertes.
Le repos véritable existe. Après une semaine intense, vous vous posez dans votre canapé avec un bouquin que vous avez envie de lire. Vous décidez consciemment de ne rien faire d'autre. C'est du repos. Vs : vous êtes dans votre canapé mais vous scrollez anxieusement LinkedIn en vous disant que vous "devriez" bosser sur ce dossier. Ce n'est ni du repos ni de l'action. C'est un entre-deux toxique où vous n'êtes nulle part.
Certains caractères sont naturellement portés à l'action, d'autres à la contemplation.
Le caractériologue René Le Senne avait fait de l'activité/non-activité une des dimensions fondamentales du tempérament. Mais même les tempéraments "non-actifs" ont besoin d'action pour maintenir leur équilibre psychique. La différence, c'est le dosage, pas le principe.
Prescription pratique : la petite action qui rompt l'inertie
Je ne vais pas vous faire une liste débile genre "10 tips pour vous bouger". Mais il y a un principe simple et efficace : commencer par la plus petite action possible.
Pourquoi ça marche ? Parce que l'inertie psychique obéit aux mêmes lois que l'inertie physique. Un corps au repos tend à rester au repos. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. Une fois que vous avez brisé l'immobilisme, même par une action minuscule, la suite devient plus facile.
Vous êtes déprimé ? Ne vous fixez pas comme objectif de "faire du sport". C'est trop gros, trop vague, trop intimidant. Décidez de mettre vos chaussures de sport. Juste les chaussures. C'est tout. Vous les mettez, et si vous avez envie de les retirer tout de suite après, vous les retirez. Mais souvent, une fois les chaussures aux pieds, vous sortez faire un tour. L'action en appelle une autre.
Vous devez écrire un rapport qui vous terrorise depuis trois semaines ? N'ouvrez pas Word avec l'objectif de "le finir". Ouvrez Word et écrivez le titre. Juste le titre. Puis fermez le document. Demain, vous écrirez la première phrase. C'est tout.
Vous fractionnez l'insurmontable en minuscule. Chaque petit bout d'action réactive le circuit de récompense dans votre cerveau. Vous retrouvez un sentiment d'agentivité : "je peux agir sur ma vie".
Vous voulez quitter votre job toxique mais l'idée est trop effrayante, trop grosse ? Ne posez pas votre démission aujourd'hui. Mettez à jour une ligne de votre CV. Une seule ligne. Demain, vous en mettrez une autre. C'est une action, elle compte. Elle dit à votre psychisme : "Je ne suis pas coincé, je me prépare à bouger."
Vous êtes fâché avec votre frère depuis deux ans et l'idée d'une "grande discussion de réconciliation" vous paralyse ? N'organisez pas cette discussion. Envoyez un SMS : "Salut, comment tu vas ?" Trois mots. C'est suffisant pour redémarrer. L'action précède souvent la motivation, pas l'inverse. On ne se sent pas motivé, puis on agit. On agit, et la motivation suit.
Conclusion
L'action n'est pas l'ennemi de la pensée. Elle en est la condition. Un psychisme sain n'est pas un psychisme immobile qui "gère ses émotions" en les observant avec détachement. C'est un psychisme qui circule : tension, pensée, action, décharge, retour à l'équilibre. Puis recommence.
Vous connaissez cette sensation après avoir enfin fait ce truc que vous repoussez depuis des semaines ? Envoyer ce mail difficile, avoir cette conversation nécessaire, ranger ce placard qui vous culpabilise ? Ce soulagement physique, presque euphorique ? Ce n'est pas votre "mental" qui va mieux par magie. C'est votre organisme qui retrouve son équilibre. Vous avez fermé la boucle. L'énergie mobilisée a trouvé son issue.
Votre inconfort existentiel n'attend peut-être pas une révélation. Il attend que vous fassiez quelque chose.
Le sentiment d'utilité : un besoin fondamental porteur d'espoir
Le 19/10/2025
L'angoisse du vide
Dans nos relations, nous pouvons souvent entendre cette plainte : "Je ne sers à rien", "Ma vie est vide", "À quoi bon ?". Ce n'est pas un hasard si les statistiques sur l'épuisement professionnel, la dépression et la quête de sens au travail explosent dans les sociétés occidentales. Derrière ces maux contemporains se cache une question fondamentale : comment exister quand on ne se sent utile à rien ni personne ?
Le sentiment d'inutilité n'est pas qu'un inconfort passager. C'est une menace existentielle qui peut mener à l'effondrement psychique. À l'inverse, se sentir utile - avoir l'impression que notre présence au monde produit quelque chose de valable - constitue un rempart puissant contre l'angoisse. Plus encore : c'est porteur d'espoir, car contrairement à d'autres besoins fondamentaux, nous disposons d'une certaine capacité à agir sur ce sentiment.
Explorons pourquoi l'utilité est un besoin psychique fondamental, comment elle se construit, quels pièges elle recèle, et surtout comment cultiver un sentiment d'utilité sain qui donne du sens à notre existence sans nous enfermer dans des défenses rigides.
L'utilité comme besoin fondamental
- Deux niveaux distincts
Il faut d'abord distinguer deux choses qui se confondent souvent : *être utile* et *se sentir utile*. Le premier relève d'une réalité objective - j'accomplis des tâches, je produis des effets, j'ai une fonction dans un système. Le second est une construction subjective - je me perçois comme ayant de la valeur à travers mes actions.
Ces deux dimensions ne se recouvrent pas toujours. On peut être objectivement utile (un soignant qui sauve des vies) tout en se sentant vide et insignifiant. À l'inverse, on peut se sentir profondément utile dans des activités dont l'utilité objective est questionnable. Ce qui compte pour l'équilibre psychique, c'est avant tout le sentiment subjectif, l'expérience vécue d'être agent productif dans le monde.
- Une perspective évolutionniste
D'un point de vue darwinien, la contribution au groupe a toujours représenté un avantage adaptatif majeur. Nos ancêtres qui participaient activement à la survie collective - chasse, cueillette, protection, soin aux enfants - avaient plus de chances de transmettre leurs gènes. Le besoin de se sentir utile pourrait donc être ancré dans notre architecture psychique comme mécanisme favorisant la coopération.
Cette lecture évolutionniste explique pourquoi l'exclusion du groupe, l'inutilité sociale, provoque une souffrance si intense. Être inutile, c'était historiquement être éjecté du groupe, donc condamné. L'angoisse que nous ressentons face à notre propre inutilité n'est peut-être que l'écho lointain de cette menace primordiale.
- Une défense mature
Du point de vue psychanalytique, l'utilité peut fonctionner comme une défense mature contre l'angoisse existentielle. Freud parlait de sublimation : transformer nos pulsions en réalisations socialement valorisées. Faire quelque chose d'utile, c'est donner forme à notre énergie psychique, la canaliser vers des buts constructifs plutôt que de la laisser se retourner contre nous en symptômes.
Bergeret distinguerait probablement les organisations de personnalité selon leur rapport à l'utilité. Une personnalité bien structurée peut investir des projets utiles avec souplesse, en tirant satisfaction de l'action elle-même. Une organisation plus fragile risque de faire de l'utilité un rempart désespéré : "je n'existe que si je sers". Dans le premier cas, c'est une défense mâture. Dans le second, une défense rigide qui peut se retourner en pathologie.
- Le caractère et ses projets
René Le Senne, philosophe du caractère, voyait dans les projets et réalisations le moyen par lequel la personne se construit et se définit. Le caractère n'est pas une essence figée, mais une structure dynamique qui se forge à travers ce que nous faisons du monde et ce que le monde fait de nous.
Être utile, dans cette perspective, c'est inscrire sa marque dans le réel. C'est sortir de soi pour agir sur l'environnement, et en retour être transformé par cette action. Le sentiment d'utilité serait alors le témoin subjectif de cette inscription réussie : je ne suis pas un spectateur passif, je suis acteur de ma propre existence et, modestement, de celle du monde.
- La transition nécessaire
Ces cadres théoriques - darwinien, psychanalytique, caractérologique - convergent vers une idée centrale : l'utilité répond à un besoin psychique profond. Mais ils ne disent pas comment, concrètement, on construit ce sentiment. Comment passe-t-on du besoin d'être utile à l'expérience effective de l'utilité ? C'est là qu'intervient un concept plus opérationnel : l'agentivité.
L'agentivité : le moteur de l'utilité
- Bandura et le sentiment d'efficacité personnelle
Le psychologue Albert Bandura a introduit un concept qui éclaire puissamment notre propos : l'agentivité (agency en anglais), ou sentiment d'efficacité personnelle (self-efficacy). Il s'agit de la capacité à se vivre comme cause de ses propres actions et de leurs effets sur le monde.
Ce n'est pas exactement "être utile aux autres". C'est plus fondamental : c'est produire des effets voulus, transformer le réel par son action, se percevoir comme agent causal plutôt que comme objet passif des événements. Vous pouvez être agent sans être utile à quiconque - un ermite qui construit sa cabane dans les bois fait preuve d'agentivité. Et inversement, vous pouvez être utile sans aucune agentivité - un esclave est utile à son maître mais ne choisit ni ses actions ni leurs finalités.
L'utilité devient porteuse de sens quand elle s'articule avec l'agentivité. Non pas "on se sert de moi", mais "je choisis d'agir et mes actions produisent des effets que je valorise". C'est cette combinaison - action + intention + effet + valeur - qui nourrit le sentiment d'utilité profond.
- Les quatre sources du sentiment d'efficacité
Bandura identifie quatre sources qui construisent notre sentiment d'efficacité personnelle :
- Les expériences de maîtrise : la plus puissante. J'ai réussi à faire quelque chose, j'en ai vu les résultats concrets. Cette expérience s'inscrit en moi et renforce ma conviction que je peux agir efficacement. Un parent qui voit son enfant progresser grâce à son accompagnement, un artisan qui contemple l'objet qu'il a fabriqué, un bénévole qui constate l'amélioration du lieu qu'il a nettoyé - toutes ces expériences nourrissent l'agentivité.
- Les expériences vicariantes : j'observe quelqu'un qui me ressemble réussir. Si elle y arrive, pourquoi pas moi ? C'est pourquoi les modèles identificatoires sont cruciaux. Voir d'autres personnes ordinaires accomplir des choses utiles élargit notre champ des possibles et stimule notre propre désir d'agir.
- La persuasion verbale : quelqu'un en qui j'ai confiance me dit que je suis capable, que mon action a de la valeur. Ce feedback externe peut renforcer temporairement le sentiment d'efficacité, à condition d'être crédible et étayé par des faits. Les encouragements vides ont peu d'effet ; la reconnaissance précise et ajustée, beaucoup.
- Les états physiologiques et émotionnels : quand je me sens calme, énergique, confiant, mon sentiment d'efficacité augmente. À l'inverse, l'anxiété, la fatigue, le stress le diminuent. C'est un facteur souvent sous-estimé : prendre soin de son état physique et émotionnel est une condition de l'agentivité.
- Le cercle vertueux action-maîtrise
Bandura décrit un cercle vertueux : le sentiment d'efficacité conduit à l'action, l'action à la maîtrise, la maîtrise renforce le sentiment d'efficacité. À l'inverse, le sentiment d'impuissance conduit à l'évitement, l'évitement à la perte de compétences, qui renforce l'impuissance. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise.
Le sentiment d'utilité s'inscrit dans cette dynamique. Quand je me vis comme agent efficace, j'ose entreprendre des actions utiles. Quand ces actions produisent des effets positifs, mon sentiment d'utilité se renforce. Quand ce sentiment est fort, j'ose davantage. Et ainsi de suite.
- L'antidote à la rumination
Pourquoi l'agentivité protège-t-elle de l'angoisse ? Parce que l'action structure, oriente, ancre dans le présent. L'angoisse, à l'inverse, se nourrit de rumination, d'anticipation catastrophique, de ressassement. Quand j'agis - vraiment, avec intention et attention - je sors de ma tête. Je suis confronté au réel, à ses résistances, à ses réponses. Je ne peux pas ruminer en même temps que je construis, répare, crée, soigne, enseigne.
Paul Watzlawick, théoricien de la communication, affirmait qu'on ne peut pas ne pas communiquer. De même, on ne peut pas ne pas agir - même l'inaction est une forme d'action. Mais l'agentivité, c'est agir *avec intention*, pas subir passivement le cours des choses. C'est ponctuer la séquence des événements en se positionnant comme sujet actif plutôt que comme objet passif.
- Du besoin à la pratique
L'apport de Bandura est de rendre opérationnel ce qui pourrait rester abstrait. Le besoin d'utilité ne se satisfait pas par décret ou par introspection. Il se construit par l'action répétée, par l'accumulation d'expériences de maîtrise, par le feedback du réel. Ce n'est pas "penser qu'on est utile", c'est *faire des choses utiles et en constater les effets*.
Cette perspective est libératrice : elle sort du registre du jugement moral ("tu devrais te sentir utile") pour entrer dans celui de la pratique ("que peux-tu faire aujourd'hui qui te donnera cette expérience ?"). C'est en cela qu'elle est porteuse d'espoir.
Les pièges et dérives
Mais attention. Le sentiment d'utilité, comme tout besoin psychique, peut déraper en pathologie quand il devient rigide, exclusif, désespéré. Il faut examiner les pièges pour mieux les éviter.
- Le paradoxe de la quête désespérée
Cliniquement, on observe un paradoxe cruel : ceux qui cherchent le plus désespérément à se sentir utiles deviennent souvent contre-productifs. Le codépendant qui anticipe tous les besoins de l'autre avant même qu'ils ne s'expriment, le collègue qui s'impose dans tous les projets pour "aider", le parent qui surprotège son enfant au point de l'étouffer - tous cherchent à se sentir indispensables et tous créent, à terme, de la dépendance, du rejet, de l'inefficacité.
Pourquoi ? Parce que leur "utilité" ne sert pas vraiment l'autre, elle sert leur propre besoin de se sentir nécessaires. L'autre le sent, consciemment ou non, et finit par fuir ou se rebeller. Certains ont tellement besoin de se sentir utiles qu'ils deviennent l'équivalent humain d'un spam : techniquement présents, objectivement superflus, subjectivement agaçants.
Le vrai service, l'utilité ajustée, suppose une écoute de l'autre, une conscience de ses besoins réels, et surtout l'acceptation qu'on n'est pas toujours nécessaire. Paradoxalement, ceux qui sont les plus utiles sont ceux qui peuvent tolérer de ne pas l'être tout le temps.
- L'utilité comme tyrannie
Autre dérive : faire de l'utilité une condition d'existence. "Je ne vaux que ce que je produis", "je n'ai le droit d'exister que si je sers à quelque chose". Cette croyance sous-tend le workaholisme, le syndrome du sauveur, l'épuisement professionnel.
On rencontre souvent cette configuration chez des personnalités qui ont intériorisé très tôt qu'elles ne seraient aimées que pour ce qu'elles apportent, pas pour ce qu'elles sont. L'utilité devient alors une monnaie d'échange désespérée contre la reconnaissance et l'amour. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais en faire assez. La dette est infinie. L'épuisement guette.
Bergeret parlerait peut-être d'une défense contre l'angoisse abandonnique : "si je suis indispensable, on ne pourra pas me quitter". Mais cette défense est coûteuse. Elle ne laisse aucun répit, aucun espace pour simplement être, sans faire. Elle transforme la vie en performance anxieuse.
- La confusion valeur et fonction
Troisième piège, sociétal celui-là : confondre notre valeur avec notre fonction. Les sociétés productivistes nous poussent dans ce sens. On nous juge à notre CV, notre rendement, notre employabilité. Quand on perd son travail, on dit qu'on "n'a plus rien" - comme si notre emploi épuisait notre identité.
Cette confusion a des conséquences ravageuses. Elle rend insupportable toute période d'inactivité - retraite, maladie, chômage. Elle disqualifie tous ceux qui ne produisent pas selon les critères dominants - personnes handicapées, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de précarité. Elle alimente le sentiment d'inutilité et, par extension, la honte et le désespoir.
Or nous ne sommes pas réductibles à notre fonction. Notre valeur en tant qu'êtres humains est inconditionnelle, elle ne dépend pas de notre productivité. Distinguer "ce que je fais" et "ce que je suis" est une nécessité psychique. On peut perdre sa fonction sans perdre sa valeur. On peut être utile de mille manières qui ne passent pas par l'utilité économique.
- Les limites objectives
Dernier point, crucial : ne pas nier les déterminismes et les limites objectives. Tout le monde ne dispose pas des mêmes ressources pour développer son agentivité. Une personne en dépression sévère, par exemple, n'a tout simplement pas l'énergie psychique disponible pour s'engager dans l'action. Lui dire "il suffit d'agir pour aller mieux" relève du déni cruel.
De même, les contextes sociaux, économiques, les discriminations, les handicaps, les traumatismes créent des obstacles réels à l'agentivité. On ne peut pas ignorer ces réalités au nom d'un optimisme béat. L'agentivité n'est pas que affaire de volonté individuelle, elle dépend aussi des possibilités objectives qu'offre l'environnement.
Reconnaître ces limites n'est pas du fatalisme, c'est de la lucidité. Cela permet d'ajuster nos attentes, de chercher des marges de manœuvre réalistes, et d'éviter la culpabilisation toxique de ceux qui ne parviennent pas à "se sentir utiles" parce que leur contexte de vie ne le permet tout simplement pas.
Comment cultiver un sentiment d'utilité sain
Passons maintenant à la dimension pratique. Comment développer un sentiment d'utilité qui nourrisse sans dévorer, qui structure sans rigidifier ?
- Commencer petit : les micro-actions
L'erreur courante est de viser trop grand : "je vais sauver le monde", "je vais révolutionner mon entreprise". Ces projets grandioses échouent souvent et renforcent le sentiment d'impuissance. Bandura insiste sur l'importance des expériences de maîtrise progressives.
Commencez par des actions minuscules dont vous pouvez constater les effets rapidement. Préparer un repas équilibré et le savourer. Ranger un espace qui était en désordre. Répondre attentivement à un message d'un proche. Arroser une plante. Réparer un objet cassé. Ces micro-actions produisent des effets mesurables, immédiats, tangibles.
L'accumulation de ces petites expériences de maîtrise reconstruit peu à peu le sentiment d'efficacité. C'est comme un muscle atrophié qu'on réhabilite doucement. On commence par soulever des poids légers avant d'augmenter progressivement la charge. L'utilité se cultive de même : par petites touches, jour après jour.
- Diversifier les sources
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si toute votre utilité repose sur votre travail, que se passe-t-il en cas de licenciement, de retraite, de burnout ? Si elle repose exclusivement sur votre rôle parental, que se passe-t-il quand les enfants partent ?
Diversifiez vos domaines d'investissement : travail, famille, activités associatives, créations personnelles, transmissions de compétences, engagement citoyen, soin à l'environnement, pratiques artistiques ou manuelles... Plus vos sources d'utilité sont variées, plus vous êtes résilient face aux aléas de la vie.
Cette diversification a un autre avantage : elle permet de nourrir différentes dimensions de votre identité. Vous n'êtes pas seulement un professionnel, un parent, un ami. Vous êtes tout cela à la fois, et chaque rôle peut être investi de manière utile.
- Accepter l'imperfection
L'utilité relative vaut mieux que l'inutilité absolue. Vous n'avez pas besoin de changer le monde, de guérir tous les maux, de résoudre toutes les souffrances pour vous sentir légitimement utile. Faire un petit pas dans la bonne direction, c'est déjà beaucoup.
Cette acceptation de l'imperfection protège du découragement. Beaucoup de personnes abandonnent leurs projets utiles parce qu'elles constatent que leur action ne règle pas tout. Mais c'est un critère absurde. Personne n'a ce pouvoir. Ce qui compte, c'est l'orientation, le mouvement, la contribution modeste mais réelle.
Un exemple clinique : une patiente dépressive se reprochait de ne pas être "assez présente" pour ses amis. En thérapie, nous avons redéfini ce qu'était une présence suffisamment bonne - répondre aux messages quand elle le pouvait, même brièvement. Pas besoin d'être toujours disponible 24h/24. Cette redéfinition réaliste lui a permis de se sentir à nouveau utile dans ses amitiés, au lieu de s'enfermer dans la culpabilité et le retrait.
- Distinguer contrôle et influence
Nous ne contrôlons pas tout, mais nous influençons beaucoup. Cette distinction, popularisée par les thérapies cognitivo-comportementales, est fondamentale pour maintenir un sentiment d'agentivité sain.
Je ne contrôle pas si mon enfant réussira sa vie, mais j'influence ses chances en l'éduquant avec attention. Je ne contrôle pas l'issue d'une crise écologique, mais j'influence marginalement les choses par mes choix quotidiens. Je ne contrôle pas si mon action sera reconnue, mais j'influence la probabilité en communiquant clairement.
Accepter qu'on ne contrôle pas tout évite le sentiment de toute-puissance et la culpabilité démesurée en cas d'échec. Reconnaître qu'on influence quand même maintient l'agentivité et le désir d'agir. C'est un équilibre subtil, mais essentiel.
- Des exemples concrets
Quelles actions concrètes nourrissent le sentiment d'utilité ? Voici une liste non exhaustive, pour stimuler votre réflexion :
- Transmission de compétences : enseigner quelque chose que vous savez faire, formellement ou informellement. Mentorat, tutorat, partage de savoir-faire.
- Soin aux autres : écouter un proche en difficulté, accompagner une personne âgée, soutenir un collègue. Attention : sans tomber dans le piège du sauveur.
- Engagement associatif ou citoyen : bénévolat, participation à des projets collectifs, implication dans la vie de la cité.
- Création : écrire, dessiner, composer, construire. Toute création laisse une trace dans le monde, produit quelque chose qui n'existait pas.
- Maintien et soin de l'environnement : jardiner, nettoyer un espace public, trier ses déchets, réparer plutôt que jeter. Ces gestes modestes inscrivent notre action dans le réel.
- Travail bien fait : quelle que soit votre profession, la faire avec conscience et compétence. L'utilité ne réside pas nécessairement dans la grandeur de la tâche, mais dans la qualité de l'exécution.
- Cuisiner : préparer des repas sains pour soi et ses proches. Geste humble, quotidien, mais profondément nourricier au sens propre et figuré.
- Écoute active : simplement être présent à l'autre, sans jugement, sans chercher à tout résoudre. C'est une forme d'utilité souvent sous-estimée.
L'essentiel est de trouver ce qui résonne avec votre tempérament, vos compétences, vos contraintes. Il n'y a pas d'utilité noble et d'utilité indigne. Toute action qui produit du sens pour vous et un effet positif dans le monde mérite d'être valorisée.
- Le rôle du feedback
Bandura insiste sur l'importance du feedback - ces informations qui nous reviennent sur les effets de nos actions. Sans feedback, impossible de savoir si on est efficace, donc impossible de développer le sentiment d'efficacité.
Cherchez activement ce feedback. Demandez à vos proches, vos collègues, les bénéficiaires de vos actions comment ils perçoivent votre contribution. Pas pour quémander des compliments, mais pour ajuster votre action et en mesurer les effets réels.
Apprenez aussi à vous auto-évaluer de manière réaliste. Qu'ai-je accompli aujourd'hui ? Quel effet cela a-t-il eu ? Tenir un journal peut aider : noter chaque jour trois actions utiles accomplies. Cette pratique simple renforce la conscience de sa propre agentivité.
Attention toutefois à ne pas dépendre exclusivement du feedback externe. Certains environnements sont avares en reconnaissance. Si vous attendez toujours qu'on vous dise que vous êtes utile, vous risquez l'épuisement et la frustration. Il faut aussi développer une capacité à reconnaître soi-même la valeur de ses actions, indépendamment du regard d'autrui.
- Créer des boucles de rétroaction positives
Enfin, pensez systémiquement. Comment créer des situations où votre action utile produit des effets qui, en retour, vous encouragent à continuer ? C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive.
Exemple : vous commencez à jardiner. Vous voyez les plantes pousser grâce à vos soins. Cette croissance visible vous encourage à continuer. Vous apprenez, vous progressez, votre jardin s'embellit. Des voisins vous complimentent. Vous leur donnez des conseils. Ils jardinent à leur tour. Le quartier se végétalise. Vous vous sentez partie prenante d'un mouvement positif. Votre sentiment d'utilité s'approfondit.
Ces boucles vertueuses ne se créent pas toujours spontanément. Parfois, il faut les amorcer consciemment : choisir des actions dont on pourra constater les résultats, s'entourer de personnes qui valorisent le type d'utilité qu'on cherche à déployer, s'inscrire dans des collectifs où l'entraide et la reconnaissance mutuelle sont la norme.
L'utilité comme espoir
Revenons à l'intuition initiale : pourquoi le sentiment d'utilité est-il porteur d'espoir ?
Parce que, contrairement à d'autres besoins psychiques fondamentaux - être aimé, être reconnu, être valorisé - qui dépendent largement des autres et échappent en grande partie à notre contrôle, l'agentivité et le sentiment d'utilité relèvent en partie de nous.
On ne peut pas *décider* d'être aimé. On ne peut pas *forcer* les autres à nous reconnaître. Mais on peut *agir* pour se sentir utile. On peut choisir des actions, constater leurs effets, ajuster, recommencer. C'est un domaine où nous disposons d'une marge de manœuvre réelle.
Cette marge de manœuvre est précisément ce qui fonde l'espoir. Pas un espoir naïf du type "tout dépend de moi", mais un espoir réaliste : "je ne suis pas totalement impuissant, je peux faire quelque chose, même modeste, et cela compte".
Face à l'absurde, face à la finitude, face aux multiples sources d'angoisse qui traversent l'existence humaine, l'action utile est une réponse. Elle ne résout pas tout, elle ne supprime pas l'angoisse existentielle, mais elle la rend supportable. Elle donne une direction, un sens, une raison de se lever le matin.
C'est en cela que le sentiment d'utilité est un besoin fondamental : il nous permet de sortir de la position victimaire, de la passivité désespérée, pour retrouver une posture d'agent. Non pas tout-puissant, mais capable. Non pas contrôlant, mais influent. Non pas sauveur du monde, mais contributeur modeste au bien commun.
L'espoir, dans cette perspective, n'est pas l'attente passive que les choses s'arrangent. C'est la conviction active que nous pouvons, à notre échelle, participer à ce que les choses s'arrangent. Ou au moins, à ce qu'elles ne s'arrangent pas trop mal.
Et peut-être, finalement, est-ce là la définition d'une vie réussie : non pas une vie exceptionnelle, admirée, spectaculaire, mais une vie où l'on s'est senti, la plupart du temps, utile à quelque chose ou à quelqu'un. Une vie où l'on a agi plutôt que subi. Une vie où l'on a laissé, ici et là, de petites traces positives.
Ce n'est pas grand-chose, direz-vous. C'est tout, répondrai-je.
Cet article n'a pas la prétention d'épuiser la question du sentiment d'utilité, ni de fournir des recettes miracle. Il vise simplement à ouvrir une réflexion sur un besoin psychique trop souvent négligé, et à suggérer quelques pistes praticables. Si une seule idée vous inspire une action, même minuscule, alors cet article aura été utile. Ce qui, vous en conviendrez, serait satisfaisant.
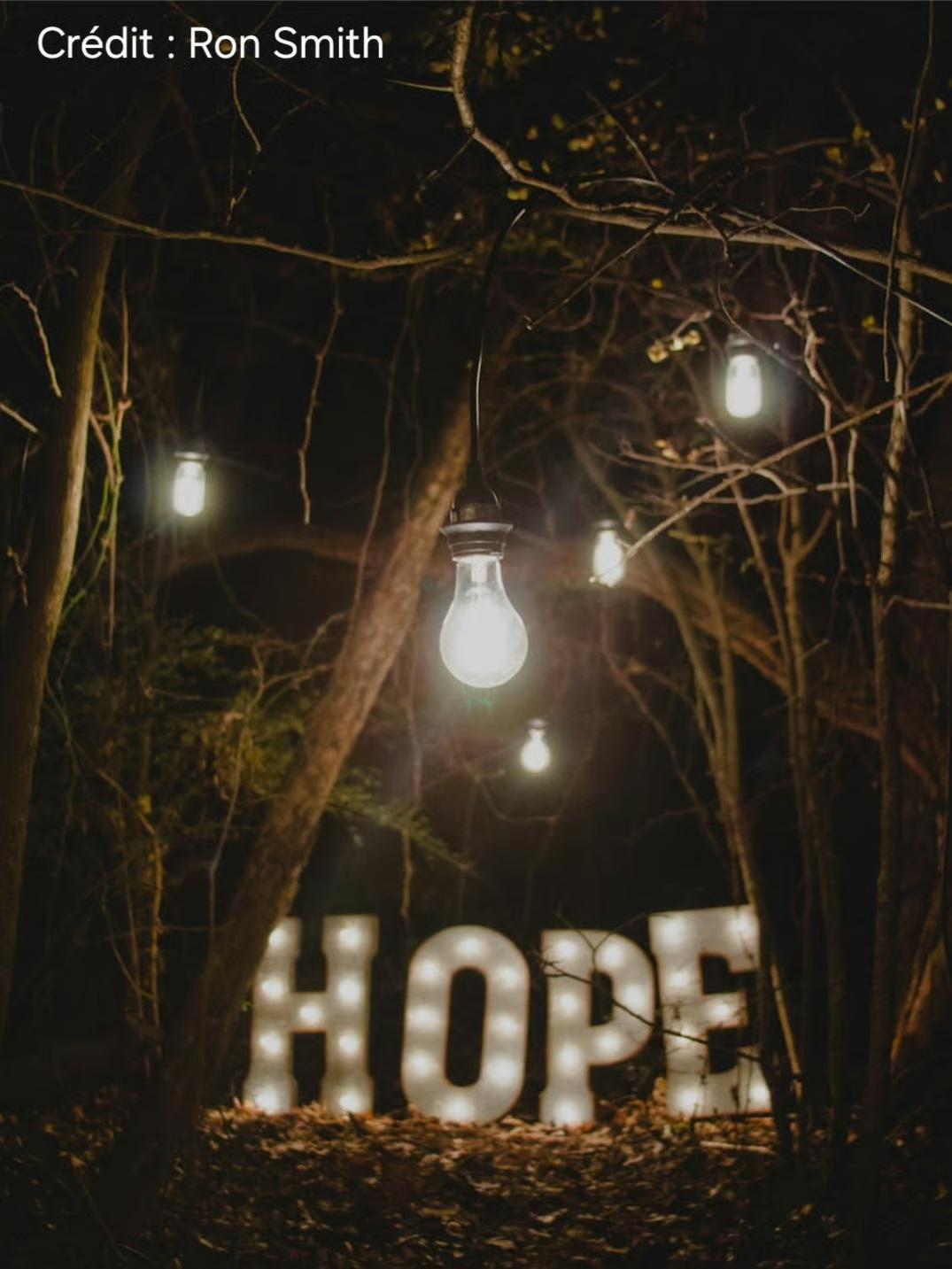
Lire ses équipes sans se tromper
Le 12/10/2025
Le mythe qui coûte cher
Un collaborateur croise les bras pendant que vous présentez vos chiffres hebdomadaires.
Conclusion rapide instinctive : résistance, fermeture, désaccord. Vous notez mentalement de surveiller ce collaborateur.
Sauf qu'il avait froid. Ou mal au dos. Ou c'est sa position naturelle quand il réfléchit intensément, quand il est à l’écoute.
Ce petit exemple résume le problème : nous interprétons la gestuelle comme si elle était une langue univoque, un dictionnaire où chaque geste = une signification. C'est rassurant. C'est aussi faux et ça coûte cher en décisions RH mal fondées, en relations dégradées, en talents perdus.
Les managers lisent du "body language" comme on lisait jadis les horoscopes : on y voit ce qu'on veut y voir. Et puis on agit dessus.
Cet article propose une approche différente. Une qui s'appuie sur la biologie (Darwin), mais qui refuse le déterminisme simpliste. Une qui reconnaît que la gestuelle communique toujours quelque chose, mais que ce "quelque chose" dépend entièrement du contexte relationnel (Watzlawick).
Le résultat ? Vous lirez mieux vos équipes. Mais surtout, vous arrêterez de mal les interpréter.
Darwin : ce qu'on sait vraiment de nos gestes
Charles Darwin, dans ses observations sur l'expression des émotions, a établi un point crucial : certains gestes et expressions faciales transcendent les frontières culturelles. Un enfant aveugle-né fait la grimace de dégoût sans jamais avoir vu quelqu'un d'autre le faire. La peur produit les mêmes micro-expressions chez un japonais, un brésilien, un suédois.
Pourquoi ? Parce que l'évolution a gravé certains comportements dans notre neurobiologie. Ces gestes servaient à la survie : se faire petit quand on a peur, montrer les dents en agressivité, se détendre quand le danger passe.
Ce que cela signifie pour vous, manager :
Il existe des indicateurs biologiquement fondés de l'état émotionnel. Un collaborateur en stress chronique va présenter des patterns observables : tension dans les épaules, respiration courte, micro-contractions faciales. Ces signaux ne mentent pas, ils reflètent un état physiologique réel.
Un exemple concret : lors d'une réunion difficile, vous remarquez qu'une collaboratrice évite le contact visuel, se tortille dans sa chaise, a les mains crispées. Ce ne sont pas des "mensonges", c'est son système nerveux qui crie. Elle est en détresse, point. C'est factuel. Et vous devez lui demander pourquoi elle est en tension, qu’est-ce qui la perturbe, l’interroge.
Voici le piège : Darwin montre que ces gestes existent et qu'ils reflètent quelque chose de réel. Mais il ne dit pas ce qu'ils signifient exactement. C'est là que les managers se trompent.
Le même évitement du regard peut être : de la peur, de la honte, de la culpabilité, de la concentration, de l'autisme, de la dépression, ou simplement une préférence culturelle (dans certaines cultures, regarder le chef dans les yeux est irrespectueux).
Darwin nous donne les briques. Pas la maison.
Watzlawick : quand le contexte remet tout en question
Paul Watzlawick, en observant les systèmes relationnels, a démontré que la communication n'est jamais une transmission simple d'information. C'est une danse où les deux partenaires créent continuellement le sens, ensemble.
Son premier axiome est implacable : "On ne peut pas ne pas communiquer." Mais cela signifie aussi : on ne peut pas faire de communication hors contexte. Tout geste communique « quelque chose », mais ce « quelque chose » émerge de la situation relationnelle, pas du geste lui-même.
Transposons cela au management.
Le silence en réunion.
Vous posez une question. Un collaborateur reste silencieux. Darwin vous dit : peut-être qu'il réfléchit (respiration calme, posture stable). Ou peut-être qu'il est anxieux (micro-tremblements, regard baissé).
Mais Watzlawick vous pose des questions autrement plus utiles :
- Quelle est sa relation à vous ? Est-ce qu'il a peur de vous ?
- Quel est le contexte ? Y a-t-il déjà eu des représailles contre ceux qui ont parlé ?
- Qui d'autre est dans la salle ? Est-ce qu'il va parler ensuite en privé ?
- Quel est son tempérament ? Certaines personnes pensent à voix haute, d'autres réfléchissent en silence.
Le même silence peut vouloir dire : réflexion profonde, désaccord muet, peur, dépression, introversion, dévalorisation ("mon avis ne compte pas"), ou simplement que la question n'a pas déclenché sa curiosité.
La posture fermée.
Un commercial croise les bras lors d'une confrontation sur ses résultats. Vous pensez : il est sur la défensive, fermé, craint la critique.
Watzlawick demande : qu'avez-vous fait avant qu'il croise les bras ? Lui avez-vous déjà fait des remarques négatives en réunion ? Avez-vous une histoire relationnelle où vous l'avez mis en danger psychologiquement ? Si oui, alors oui, il se ferme—parce que vous avez créé un système où c'est nécessaire.
Mais si c'est son premier jour dans votre équipe et que c'est simplement sa posture naturelle ? Alors vous lisez de l'hostilité là où il n'y a que de la neutralité.
L'engagement apparent.
Une collaboratrice vous regarde droit dans les yeux pendant que vous parlez, opine du chef, prend des notes. Darwin dit : elle est engagée, intéressée. Watzlawick demande : d'où vient ce comportement ? Est-ce qu'elle se sent obligée de faire du spectacle parce que vous êtes son responsable ? Est-ce qu'elle a appris que c'était le comportement attendu pour être inclue au sein de l’équipe ? Ou est-ce qu'elle est réellement intéressée ?
Vous ne pouvez pas le savoir juste en regardant son non-verbal.
Le tempérament change la lecture
René Le Senne a proposé que les individus possèdent des tempéraments constitutifs : sensibilité, réactivité, résonance affective différentes. C'est génétique, c'est stable, et cela influence profondément comment chacun communique non-verbalement.
Un tempérament nerveux (émotif, secondaire chez Le Senne) va gesticuler davantage, parler plus vite, montrer plus de micro-expressions. La même anxiété interne va s'exprimer différemment chez lui que chez un tempérament flegmatique (non-émotif, primaire).
Exemple : Vous avez deux collaborateurs stressés avant une présentation importante.
Le premier (tempérament sanguin/nerveux) : parle vite, se lève et s'assoit, gesticule, change de couleur faciale, demande plusieurs fois si tout va bien.
Le second (tempérament apathique/flegmatique) : parle peu, bouge à peine, expression faciale neutre, semble impassible.
Si vous lisez le non-verbal naïvement, vous pensez : le premier est paniqué, le second est calme. Faux. Tous deux sont stressés. Ils l'expriment juste différemment.
Le manager compétent sait que le même état interne peut produire des gestualités radicalement opposées selon le tempérament. Cela signifie : vous ne pouvez pas utiliser un seul indicateur non-verbal pour conclure quelque chose.
Vous devez construire une baseline pour chaque personne. Comment se comporte-t-elle normalement ? Qu'est-ce qui change quand elle est anxieuse, contente, concentrée ? Puis vous pouvez détecter les écarts.
La relation managériale : un système où le non-verbal s'échange
Watzlawick insiste : dans une relation, les deux parties façonnent continuellement le comportement l'une de l'autre. C'est un système.
En management, cela veut dire : votre gestuelle affecte la gestuelle de votre équipe. Ce n'est pas une voie à sens unique.
Si vous entrez dans une réunion les bras croisés, le sourire crispé, regardant à peine votre équipe, vous créez un système où les gens vont se fermer aussi, parce qu’ils croient eux-aussi que les bras croisés sont un signe de fermeture. Vous n'avez pas lu leur fermeture—vous l'avez créée.
Inversement, si vous vous asseyez ouvert, que vous faites contact visuel, que vous vous penchez légèrement en avant quand quelqu'un parle, signe qui montre que vous vous intéressez, vous installez un système où la communication s'ouvre.
Exemple concret : Un manager remarque que son équipe ne parle jamais en réunion. Il conclut : ils sont passifs, démotivés, désengagés. Il intensifie sa critique. L'équipe se ferme davantage.
Watzlawick dirait : c'est un système. Le manager a créé, sans le savoir, un contexte où parler = danger. Peut-être qu'il interrompt. Peut-être qu'il critique celui qui s'exprime. Peut-être qu'il a l'air pressé. Le non-verbal du manager a configuré le système.
Pour casser le cercle, il faut que le manager change « sa » gestuelle en premier. S'il ralentit, s'il crée du silence confortable après ses questions, s'il hoche la tête quand quelqu'un parle, il invite un nouveau système.
C'est Watzlawick pur : on ne change pas le problème en le critiquant, on le change en transformant le système.
Ce que le manager compétent fait réellement
Armé de cette compréhension, voici comment vous devriez procéder.
- Observez sans juger
Ne confondez pas observation et interprétation. "Il a les épaules tendues" est une observation. "Il est stressé" est une interprétation. "Il est stressé donc il cache quelque chose" est une interprétation sur une interprétation—c'est où les erreurs se reproduisent.
- Cherchez les patterns, pas les gestes isolés
Un geste seul ne signifie rien. Une succession de comportements, sur du temps, signifie quelque chose. Si un collaborateur est toujours tendu, parle moins, évite les réunions collectives, alors oui, il se passe quelque chose. Mais vous devez le vérifier.
- Connaissez la baseline individuelle
Comment se comporte normalement cette personne ? Un introverti va paraître "fermé" comparé à un extraverti. Ce n'est pas qu'il est hostile—c'est sa baseline, son comportement habituel.
- Tenez compte du contexte relationnel
Si vous avez une histoire de confiance avec quelqu'un, vous pouvez interpréter son non-verbal différemment que si vous venez d'être nommé manager. Si la personne vient d'une culture différente, les règles changent.
- Vérifiez verbalement
C'est le point clé : posez des questions. "Je remarque que tu parles moins depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se passe ?" Ne concluez pas, demandez.
Cette simple action transforme l'interprétation en dialogue. Elle crée un système où la communication devient possible.
- Modifiez votre propre gestuelle intentionnellement
Si vous voulez que votre équipe s'ouvre, commencez par vous ouvrir. Votre non-verbal configure le système relationnel. Utilisez-le comme outil de management.
- Acceptez l'ambiguïté
Parfois, vous ne saurez pas ce que signifie réellement un geste. C'est OK. C'est même honnête. "Je ne suis pas sûr de comprendre, explique-moi" est plus utile que de faire des hypothèses.
Les pièges à éviter
- Le biais de confirmation : Vous avez décidé que votre collaborateur est paresseux. Maintenant, chaque geste le confirme à vos yeux. S'il regarde son téléphone = preuve de désengagement. S'il parle peu = preuve de manque de motivation. Vous ne voyez que ce qui confirme votre hypothèse. Watzlawick l'appelle la "prédiction qui se réalise" : vous créez par votre comportement ce que vous prédisiez.
- La projection culturelle : Vous venez d'une culture où regarder le patron dans les yeux signifie respect. Vous interprétez celui qui regarde vers le bas comme manquant de confiance. Mais dans sa culture, c'est l'inverse. Vous vous trompez.
- L'interprétation clinique : Un collaborateur n'est pas votre patient. Ne diagnostiquez pas. "Tu es déprimé" basé sur un comportement non-verbal est une violation. Vous n'êtes pas qualifié et ce n'est pas votre rôle.
- Le monologue non-verbal : Vous "lisez" quelqu'un pendant toute une réunion et vous ne lui parlez jamais. Résultat ? Vous avez une version complète construite mentalement, qui n'a aucun rapport avec la réalité. Dialoguez.
Conclusion : une fenêtre, pas un miroir
La gestuelle communique. Darwin l'a prouvé : c'est enraciné biologiquement. Mais Watzlawick a prouvé qu'on ne peut pas lire la gestuelle en dehors du système relationnel.
En tant que manager, vous n'êtes pas un "lecteur de corps". Vous êtes un observateur humble et curieux. Vous remarquez des patterns. Vous posez des questions. Vous créez un système où la communication verbale et non-verbale peuvent s'aligner.
Cela demande plus d'effort que de lire un "dictionnaire du body language". Mais c'est aussi infiniment plus efficace. Et c'est la seule approche honnête.
Vos collaborateurs ne sont pas des énigmes à déchiffrer. Ce sont des humains complexes, avec des tempéraments différents, des histoires relationnelles avec vous, des contextes culturels propres.
Regardez-les. Observez-les. Mais surtout, parlez-leur.
Les matrices de compatibilité caractérielle sont-elles une impasse ?
Le 05/10/2025
Précision liminaire
Je pratique une branche de la psychologie - la caractérologie - notamment celle de Le Senne. Mais il faut être clair sur ce qu'elle apporte par rapport aux tests conventionnels de personnalité.
Les tests standardisés (MBTI, Big Five, DISC, etc.) produisent des profils statiques et descriptifs. Ils photographient un état supposé stable, catégorisent, et souvent promettent de prédire les comportements. Leur logique est celle du catalogue : vous êtes ceci, donc vous êtes susceptibles de faire cela.
La caractérologie fonctionne autrement. Elle n'est pas prédictive mais compréhensive.
Elle offre un langage pour saisir les tendances d'une personne – son rapport à l'émotion, à l'action, au temps – non pas pour l'enfermer dans une case, mais pour comprendre comment elle se défend, comment elle entre en relation, comment elle souffre. C'est un outil d'intelligibilité du fonctionnement psychique, pas un verdict.
Surtout, la caractérologie que je pratique n'est jamais isolée du contexte relationnel et systémique. Savoir qu'un sujet est "colérique" ou "sentimental" ne dit rien de sa relation à l'autre tant qu'on n'analyse pas « comment » ces tendances s'actualisent dans l'interaction concrète. C'est une grille de lecture parmi d'autres, pas une vérité finale.
L'appel du catalogue
La tentation est compréhensible. Face à un couple en crise ou une équipe dysfonctionnelle, pouvoir consulter une matrice croisant les profils psychologiques pour prédire qui "fonctionne" avec qui procurerait une illusion rassurante de maîtrise. Les tests de personnalité en recrutement, les applications de rencontre basées sur des algorithmes de compatibilité, les conseils conjugaux simplistes oscillant entre "les opposés s'attirent" et "qui se ressemble s'assemble" témoignent de ce fantasme prédictif.
Le marché regorge de ces outils : MBTI, ennéagramme (j’y suis formé moi-même), DISC (j’y suis moi-même certifié), et même des réappropriations sauvages de typologies cliniques comme celle de Le Senne. Tous promettent la même chose : anticiper le fonctionnement relationnel en additionnant des caractéristiques individuelles. C'est séduisant, c'est vendeur, et c'est fondamentalement erroné.
Bergeret : la structure se révèle dans le lien
Jean Bergeret nous rappelle que la structure de personnalité n'est pas un objet fixe qu'on "apporterait" dans la relation comme un bagage préexistant. Elle se révèle, se mobilise et se transforme *dans* l'interaction.
Prenons un exemple : un sujet à fonctionnement obsessionnel ne "sera" pas le même avec un partenaire hystérique qu'avec un autre obsessionnel. Ce n'est pas une simple addition de traits (obsessionnel + hystérique = X). C'est un processus relationnel où chacun convoque chez l'autre certaines défenses, certains modes de fonctionnement plutôt que d'autres.
Avec un partenaire hystérique, l'obsessionnel pourra se rigidifier davantage pour contenir l'émotion débordante de l'autre, ou au contraire découvrir une souplesse insoupçonnée face à la séduction. Avec un autre obsessionnel, il pourra entrer dans une compétition féroce pour le contrôle, ou trouver un confort dans la prévisibilité partagée. Ce qui émerge n'est pas prédictible par une matrice mais par l'analyse du système défensif activé « entre » ces deux personnes-là, dans ce contexte-là.
La personnalité se co-construit dans le lien. Vouloir prédire la relation à partir des individus isolés, c'est comme vouloir prévoir la mélodie en examinant séparément chaque note.
Darwin : l'adaptation contextuelle prime
Charles Darwin nous enseigne que la sélection naturelle ne favorise pas « le meilleur » ou le plus « fort » en absolu, mais l'adéquation au milieu. Transposé aux relations humaines : il n'existe pas de combinaison caractérielle universellement fonctionnelle.
Un couple formé de deux sujets "colériques" (au sens de Le Senne : émotifs, actifs, primaires) peut être parfaitement adapté dans un contexte d'adversité nécessitant de l'action rapide et de l'intensité – gérer une entreprise en crise, affronter une maladie grave, traverser une période d'instabilité sociale. Le même couple, placé dans un contexte de stabilité et de routine quotidienne, peut devenir dysfonctionnel par surinvestissement énergétique sans exutoire.
Inversement, deux « flegmatiques » (non-émotifs, actifs, secondaires) excelleront dans la consolidation tranquille d'un projet à long terme mais risquent l'enlisement face à une urgence requérant réactivité émotionnelle.
L'environnement – matériel, social, temporel – détermine quelle configuration relationnelle sera adaptative. Une matrice de compatibilité fige ce qui est par nature évolutif et contextuel. Elle présuppose un essentialisme des caractères là où règne le mouvement adaptatif.
Watzlawick : la circularité contre la causalité linéaire
Paul Watzlawick et l'école de Palo Alto démolissent définitivement l'idée qu'on pourrait prédire une interaction en additionnant des caractéristiques individuelles. Leur apport majeur : substituer la causalité circulaire à la causalité linéaire.
La pensée linéaire dit : "A est dominateur, donc B devient soumis". La pensée circulaire dit : "A et B co-créent un pattern complémentaire de domination/soumission, chacun renforçant le comportement de l'autre dans une boucle sans origine assignable". Qui a commencé ? Question absurde. Le système interactionnel précède les positions individuelles.
Les patterns relationnels – complémentaires (différence acceptée) ou symétriques (égalité revendiquée) – émergent de l'interaction. Ils ne préexistent pas dans les "caractères" des protagonistes. Un même individu développera des patterns radicalement différents selon son interlocuteur et le contexte communicationnel.
Le paradoxe devient alors évident : chercher LA bonne combinaison de profils empêche précisément de voir COMMENT fonctionne le système relationnel réel. On cherche la cause dans les individus alors qu'elle réside dans la structure de leur interaction.
Vouloir établir une matrice de compatibilité, c'est comme vouloir prédire une partie d'échecs en examinant séparément les pièces blanches et noires, sans considérer le jeu lui-même.
Implications pratiques
En thérapie conjugale
Le couple qui consulte en disant "nous ne sommes pas compatibles" exprime souvent un renoncement à comprendre ce qui se joue entre eux. Le travail thérapeutique consiste alors à déplacer la question : non pas "sommes-nous faits l'un pour l'autre ?" mais "que jouons-nous ensemble et pouvons-nous jouer autrement ?"
Explorer les patterns circulaires, identifier les double-liens, mettre au jour les bénéfices secondaires des dysfonctionnements : voilà le travail clinique. Une matrice de compatibilité court-circuite cette élaboration en offrant un verdict pseudo-scientifique là où il faudrait une analyse.
En intervention systémique (équipes, organisations)
En contexte professionnel, l'illusion est encore plus prégnante. Les outils RH promettent de composer "l'équipe idéale" en croisant des profils. Résultat : on constitue des groupes sur le papier harmonieux qui dysfonctionnent dans la réalité, parce que personne n'a pensé à la régulation systémique nécessaire.
Une équipe n'est pas une collection d'individus mais un système avec ses règles implicites, ses coalitions, ses boucs émissaires, ses non-dits. La vraie question n'est pas "qui avec qui ?" mais "quelles régulations mettre en place pour que la diversité devienne ressource plutôt que handicap ?"
Un sujet à structure limite peut être toxique dans une équipe sans cadre, et précieux dans une équipe fortement structurée où son intensité émotionnelle apporte du liant. Un obsessionnel sera paralysant dans un contexte exigeant de la réactivité, et salvateur dans un projet nécessitant rigueur et anticipation.
Conclusion : de la carte au territoire
Les outils typologiques – que ce soit Le Senne, le Big Five, le MBTI ou tout autre système classificatoire – ont leur utilité comme « cartes heuristiques » pour penser. Ils permettent de nommer, de différencier, de conceptualiser des tendances caractérielles. Ce sont des instruments d'intelligibilité, pas des GPS prédictifs.
L'erreur catastrophique consiste à les transformer en matrices de compatibilité, c'est-à-dire en instruments prédictifs d'appareillage relationnel. C'est confondre la carte avec le territoire, le concept avec le réel, la typologie avec la clinique.
La vraie expertise du praticien – thérapeute, coach, consultant – ne réside pas dans la maîtrise d'un catalogue de profils, mais dans sa capacité à analyser finement ce qui se joue « ici et maintenant » entre CES personnes-là, dans CE contexte-là. C'est plus exigeant intellectuellement, plus inconfortable pour le praticien/consultant et pour le patient ou client, mais c'est la seule voie cliniquement honnête.
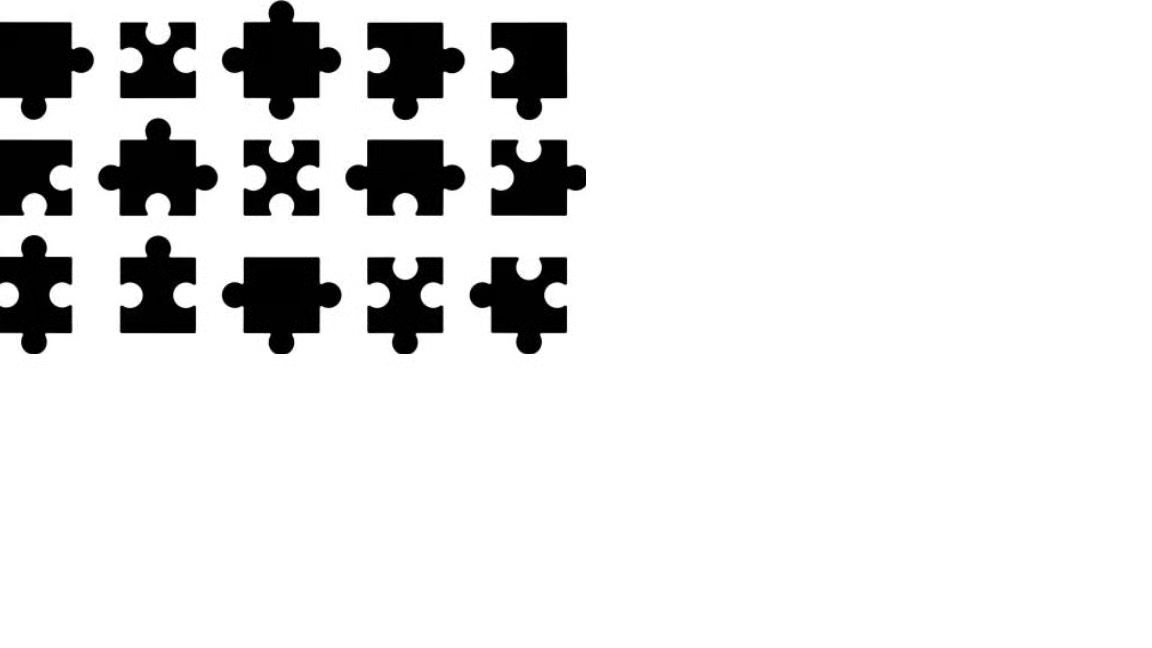
Le 27/09/2025
Pourquoi il devient si difficile d’échanger ?
Échanger, dialoguer, confronter ses idées : ces gestes qui paraissaient naturels sont aujourd’hui devenus complexes, parfois impossibles. La discussion se transforme en succession de monologues, chacun cherchant à convaincre plutôt qu’à comprendre, à imposer sa vérité plutôt qu’à risquer d’être transformé par celle de l’autre. Cette difficulté n’est pas anecdotique : elle dit quelque chose de profond sur notre rapport à l’altérité, sur la manière dont nous supportons – ou refusons – la contradiction.
La logique du miroir
Nos sociétés modernes, hyperconnectées, ont démultiplié les occasions de communication. Pourtant, jamais l’impression d’un véritable dialogue n’a semblé aussi fragile. Les réseaux sociaux, censés nous relier, agissent souvent comme des miroirs déformants : on ne rencontre pas l’autre, mais une version de soi-même validée, confortée ou caricaturée.
Dans ces espaces numériques, l’algorithme favorise la confirmation plutôt que la contradiction. L’échange devient une recherche de validation narcissique, où l’autre n’existe plus comme sujet autonome mais comme prolongement ou menace. La conversation se réduit à un « like » ou à un affrontement polarisé, sans nuance ni effort dialectique.
Qu’est-ce que l’altérité ?
Reconnaître l’altérité, c’est accepter que l’autre existe dans sa différence irréductible, avec ses arguments, ses affects et sa logique propres. C’est se laisser déplacer, se voir obligé de questionner sa propre certitude. Freud parlait du « travail de civilisation » : supporter que son désir ne soit pas absolu, que la réalité et autrui imposent une limite.
Psychologiquement, cela demande une tolérance à la frustration, une capacité à ne pas réduire l’autre à une menace pour l’ego. L’altérité oblige à reconnaître que la vérité n’est pas possession privée, mais processus partagé. Elle est donc un exercice d’humilité et d’ouverture, profondément exigeant pour le psychisme.
La place de l’erreur dans l’échange
Admettre l’altérité, c’est aussi accepter l’idée que l’on puisse se tromper. Se tromper dans une argumentation, reconnaître une faille dans son raisonnement ou découvrir que l’autre a raison sur un point, ce n’est pas une défaite mais un apprentissage.
Or, dans un contexte où l’image de soi est fragile et surexposée, l’erreur est vécue comme une humiliation. Reconnaître « je me suis trompé » est risqué, car cela suppose de faire confiance à l’autre : confiance qu’il ne nous rejette pas, qu’il ne transforme pas cette vulnérabilité en arme de disqualification.
Accepter son erreur, c’est donc aussi réhabiliter la valeur du doute et la dignité du tâtonnement. C’est reconnaître que la vérité se construit par essais et rectifications, et que la confrontation avec l’autre nous offre une occasion de progresser plutôt qu’un terrain de disqualification.
Les résistances caractérologiques
Du point de vue de la caractérologie de René Le Senne, chacun réagit à l’altérité selon son profil :
Le caractère émotif et instable vit la contradiction comme une agression, y répond avec colère, susceptibilité, fuite ou surenchère émotionnelle.
Le caractère rigide et non émotif se ferme à toute remise en question, opposant une muraille rationnelle ou morale infranchissable.
Les caractères expansifs cherchent à dominer la discussion, transformant l’échange en démonstration de force.
Les caractères introvertis se replient, refusant le conflit au prix de l’absence de dialogue réel.
Ainsi, chaque type de personnalité montre ses défenses particulières contre le danger que représente la différence de l’autre. Mais toutes convergent vers une difficulté croissante à laisser place à la véritable confrontation constructive.
Les conséquences sociales
La disparition progressive de l’altérité a des effets multiples :
Rigidification des identités : chacun s’enferme dans son camp, son groupe de pensée, son « biais de confirmation ».
Appauvrissement de la pensée : sans contradiction, la réflexion s’éteint dans le confort de l’évidence.
Radicalisation des positions : l’absence de dialogue nourrit l’extrême, puisqu’on ne rencontre plus que des caricatures de l’autre camp.
Fragilisation du lien social : si discuter devient impossible, vivre ensemble se réduit à cohabiter dans des bulles hermétiques.
Au fond, c’est le collectif qui s’érode : une société sans altérité est une société sans véritable débat, donc sans transformation possible.
Réapprendre à dialoguer
Sortir de cette impasse suppose de réhabiliter le doute et la dialectique. Cela demande d’accepter que la contradiction ne soit pas une attaque, mais une chance de penser autrement. La philosophie comme la psychanalyse rappellent que c’est dans le frottement, parfois douloureux, des idées et des désirs, que se construit la vérité humaine.
Réapprendre à dialoguer, ce n’est pas chercher l’harmonie immédiate, mais reconnaître la fécondité du conflit bien mené. C’est aussi valoriser le droit à l’erreur : pouvoir se tromper sans honte, et accueillir la remise en question comme une expérience d’apprentissage partagé.
L’altérité est ce qui nous oblige à sortir de nous-mêmes, à grandir en rencontrant ce qui nous résiste. Sa disparition n’est pas seulement un appauvrissement du langage : c’est une mutilation du rapport humain.

Le masque social, entre idéalisation et confiance en soi
Le 20/09/2025
Dans un monde saturé d’images et d’attentes sociales, chacun d’entre nous apprend à porter un masque. Ce masque social n’est pas seulement un artifice : il est une construction psychologique et comportementale, un outil d’adaptation, mais aussi une source de tensions. Lorsqu’il se combine avec l’idéalisation de soi et la quête de confiance, il révèle des mécanismes profonds de notre psychisme, de notre caractère et de notre histoire évolutive.
Le masque social : une nécessité psychologique
Freud distinguait deux pôles fondamentaux : le Moi idéal, qui représente l’image valorisée de soi que l’on désire atteindre, et l’Idéal du Moi, qui correspond aux exigences et normes intériorisées. Le masque social oscille entre ces deux dimensions : il nous permet de répondre aux attentes d’autrui tout en cherchant à nous rapprocher de l’image que nous aimerions donner.
En pratique, ce masque est nécessaire. Sans lui, il serait impossible de vivre en société. Nous ajustons notre langage, nos comportements, nos émotions selon le contexte — un entretien professionnel, un dîner de famille, une rencontre amoureuse. Mais cette adaptation permanente peut devenir un poids lorsque l’écart entre le « vrai moi » et le masque devient trop important.
La perspective caractérologique : qui porte quel masque ?
René Le Senne montrait que notre caractère détermine en partie la façon dont nous gérons ce décalage.
L’émotif-secondaire (sensible, introverti, souvent anxieux) vit le masque comme une aliénation : il a le sentiment de trahir son authenticité, ce qui nourrit une culpabilité ou une inhibition sociale.
Le non-émotif-primaire (adaptable, pragmatique, peu enclin à l’introspection) se sert du masque comme d’un outil. Pour lui, l’authenticité n’est pas une valeur centrale, seule compte l’efficacité.
L’actif-émotif (battant, énergique, passionné) idéalise volontiers son image pour séduire, convaincre, rallier les autres à ses projets. Ici, le masque devient un prolongement du moi.
L’inactif-secondaire (réfléchi, réservé, centré sur la continuité) privilégie la cohérence et peut refuser d’endosser des rôles sociaux trop éloignés de son être profond.
Ainsi, le masque social n’est pas vécu de la même manière selon les structures caractérielles : pour certains il est protecteur, pour d’autres oppressant.
L’idéalisation de soi et de ses performances : un héritage évolutif
Darwin avait déjà noté l’importance des comportements de parade et de séduction dans le monde animal. L’humain n’y échappe pas. Dans nos sociétés, l’idéalisation de soi — se présenter plus compétent, plus séduisant, plus fort qu’on ne l’est réellement — est une stratégie ancestrale. Elle servait autrefois à assurer la survie et la reproduction ; aujourd’hui, elle alimente la compétition sociale et professionnelle.
Les réseaux sociaux amplifient cette logique. La mise en scène permanente des réussites crée une pression de performance qui pousse à surjouer son image. On ne se contente plus de porter un masque : on vit dans un théâtre permanent, où la valeur perçue l’emporte souvent sur la réalité vécue.
Mais cette idéalisation a un coût psychique. Plus l’écart est grand entre l’image projetée et l’expérience intime, plus surgissent anxiété, sentiment d’imposture et perte de sens.
La confiance en soi : entre façade et solidité intérieure
La confiance en soi semble souvent confondue avec l’assurance affichée. Or, dans une lecture comportementale, elle ne résulte pas du masque ni de l’idéalisation, mais de l’expérience. C’est en affrontant des situations, en réussissant ou en échouant puis en ajustant, que l’individu construit une sécurité intérieure.
La caractérologie éclaire ici un point essentiel : certains tempéraments s’appuient davantage sur l’expérience vécue (les actifs, les primaires), d’autres sur la réflexion et l’intégration des normes (les secondaires, les émotifs). La confiance se bâtit différemment : soit par l’action répétée et la maîtrise progressive, soit par la consolidation intérieure et la cohérence avec ses valeurs.
Du point de vue évolutionniste, la confiance en soi est un signal honnête. Un individu sûr de lui attire la coopération, inspire le respect, augmente ses chances de survie et de reproduction. Mais l’évolution a aussi favorisé le bluff : feindre la confiance peut suffire à obtenir un avantage. C’est cette dualité qui explique nos ambiguïtés actuelles.
Le paradoxe moderne
Nous vivons dans une société où le masque social est indispensable, où l’idéalisation est encouragée, mais où chacun recherche la confiance véritable. Le paradoxe est le suivant :
Le masque social protège, mais enferme si on ne sait pas s’en défaire.
L’idéalisation séduit, mais crée un gouffre intérieur si elle devient excessive.
La confiance en soi se développe lorsque l’individu parvient à intégrer ces deux dimensions sans s’y réduire.
En d’autres termes, la confiance naît lorsque l’on accepte ses limites, que l’on reconnaît ses échecs et que l’on trouve un équilibre entre rôle social et authenticité.
Conclusion : un équilibre à inventer
Le masque social est un héritage évolutif et une nécessité sociale. L’idéalisation de soi est une stratégie de séduction, mais elle devient toxique si elle écrase l’expérience vécue. La confiance véritable ne surgit que lorsqu’on cesse de dépendre du masque pour se sentir exister.
Dans cette lecture croisée, Freud rappelle la tension entre le moi et ses idéaux, Le Senne montre que notre caractère détermine notre rapport au masque, et Darwin explique pourquoi nous avons besoin d’impressionner nos semblables. Mais c’est l’articulation de ces trois approches qui nous permet de comprendre ce paradoxe : être authentiquement soi, c’est savoir jouer le jeu social sans jamais s’y perdre.